Extrait de Julius Evola, Masques et visages du spiritualisme contemporain, 1971
Nous avons déjà souligné qu’une des causes qui ont favorisé la diffusion du néo-spiritualisme doit être recherchée dans le caractère même de la religion qui a fini par prédominer en Occident, à savoir dans le caractère du christianisme et, en particulier, du catholicisme. En se présentant essentiellement, d’une part comme un système théologico-rituel, d’autre part comme une pratique dévotionnelle et moralisante, le catholicisme a donné l’impression de ne pouvoir satisfaire que dans une faible mesure le besoin de surnaturel ressenti, ces derniers temps, par de nombreuses personnes ; aussi bien celles-ci ont-elles été attirées par d’autres doctrines qui paraissaient promettre quelque chose de plus.
Naturellement, dans le cas dont nous parlons on avait en vue l’expérience du surnaturel ; car, pour le reste, on sait que le catholicisme est caractérisé par la prétention de posséder, plus que toute autre religion, une vraie théologie du surnaturel, en rapport avec sa conception d’un Dieu personnel détaché de tout le monde naturel et surplombant ce monde. Mais ce n’était pas d’une quelconque théologie que l’on s’était mis en quête ; par ailleurs, la conception théiste-catholique du Dieu-personne semblait être inappropriée dès le départ, du seul fait qu’elle n’admet, en principe, qu’un rapport « dual », de « Moi » à « Toi », entre la créature et le Créateur.
Il est vrai qu’il existe aussi une mystique chrétienne et que le catholicisme a connu des Ordres monastiques désireux de mener une vie purement contemplative. Mais en dehors du fait que cela suppose des vocations assez spécifiques et que d’ailleurs toute abolition de la distance dérivant de la conception du Dieu-personne a été considérée par l’orthodoxie comme une dangereuse hérésie, y compris dans la vie mystique (la notion d’unio mystica ou de « vie unitive » s’en trouvant assez limitée), concrètement le catholicisme des temps modernes a de moins en moins mis tout cela en relief.
Le « soin pastoral des âmes » est devenu sa principale préoccupation, pour ne pas parler des plus récents tournants post-conciliaires dans le sens de la « modernisation » et de « l’ouverture à gauche », toutes choses qui ont fait venir au premier plan de simples exigences sociales et socialisantes, nourries des misérables ingrédients bien connus d’inspiration humanitaire, pacifiste et démocratique.
Inversement, tout ce qui pouvait présenter un caractère de vraie transcendance, a été mis de côté, ou, du moins, n’a jamais été encouragé. D’où un vide qui, parallèlement à la crise du monde moderne, a conduit de nombreux esprits à chercher ailleurs, plus ou moins dans le territoire du néo-spiritualisme contemporain, s’exposant ainsi au risque de voir leurs plus hautes aspirations perverties par des forces obscures.
Mais une analyse objective oblige à reconnaître certains points.
Le premier christianisme se présente à nous comme une religion typique du kali-yuga de « l’âge sombre », époque qui correspond, dans la formulation occidentale du même enseignement, à l’« âge de fer », où selon Hésiode le destin de la plupart des hommes serait « l’extinction sans gloire dans l’Hadès ». La prédication chrétienne, s’adressant surtout, à l’origine, à la masse des déshérités et des sans-tradition de l’œcumène romain, a eu pour base un type humain très différent de celui auquel s’adressaient des traditions d’un niveau plus élevé, un type humain qui se trouvait dans une situation désespérée pour ce qui concernait l’accès au divin.
Aussi cette prédication prit-elle la forme d’une doctrine tragique du salut. Le mythe du « péché originel » fut affirmé ; on posa l’alternative entre un salut éternel et une perdition éternelle qui se joue une fois pour toutes sur cette terre ; on exaspéra cette alternative par des représentations impressionnantes de l’au-delà et par des visions apocalyptiques. C’était une façon de susciter, chez certaines natures, une tension extrême qui, surtout lorsqu’elle était associée au mythe de Jésus comme « Rédempteur », pouvait aussi porter ses fruits : sinon dans cette vie, du moins au moment de la mort ou dans le post mortem, dès lors que ces moyens indirects agissant sur l’émotivité humaine étaient parvenus à modifier en profondeur la force basique de l’être humain.
Tourné vers de plus vastes multitudes, le catholicisme successeur du christianisme a voilé, dans une certaine mesure, la radicalité extrémiste de ces vues, se souciant de fournir des soutiens à la personne humaine, dont il a reconnu la destination surnaturelle, et d’exercer une action subtile sur son être le plus profond grâce au pouvoir du rite et du sacrement.
C’est dans ce contexte qu’on peut montrer la possible raison d’être pragmatique, pratique, de certains aspects du catholicisme. Il est permis de penser que certains principes de la morale catholico-chrétienne, comme ceux de l’humilité, de la caritas et du renoncement à la volonté propre, lorsqu’ils sont compris de façon juste et appliqués là où ils doivent l’être, furent formulés pour corriger la fermeture et l’auto-affirmation individualiste auxquelles l’homme occidental était souvent enclin.
Compte tenu de l’existence d’une même limitation sur le plan intellectuel et de « l’humanisation » subséquente de toute capacité de vision, il put être opportun de présenter sous la forme du dogme et de l’autorité ce qui se trouve au-dessus de l’intellect commun, mais qui peut devenir, à un niveau plus élevé et pour une élite, connaissance, évidence directe, gnose. Il est possible qu’on ait jugé opportun de parler, pour la même raison, de « révélation » et de « grâce », soulignant ainsi le caractère de relative transcendance du vrai surnaturel par rapport aux potentialités d’un type humain plus ou moins déchu et qui allait s’avérer de plus en plus disposé à toutes les prévarications rationalistes et humanistes. Enfin, nous avons déjà signalé que les rapports fondés sur la seule « foi » dans un cadre théiste, avec la distance qu’ils laissent subsister, s’ils sont certainement limitatifs (raison pour laquelle certaines traditions plus complètes ne les ont jugés appropriés que pour les couches inférieures d’une culture), peuvent néanmoins garantir l’intégrité de la personne. Car celle-ci, répétons-le, peut se retrouver sans point d’appui solide lorsqu’elle se livre à des mystiques panthéistes ou franchit les bornes du suprasensible.
Ces limitations de la doctrine catholique peuvent jouer un rôle positif et s’avérer salutaires pour la grande masse des hommes et en vue, répétons-le, des conditions négatives du dernier âge, de « l’âge sombre ». Sous réserve qu’on se tienne à ce niveau, certaines idées, telles celles de catholiques comme Henri Massis et même Jacques-Albert Cuttat, possèdent une indéniable justesse : il est exact que le catholicisme représente une défense de l’homme occidental alors que toute forme de spiritualité non plus dualiste ni théiste (dans ce domaine on songe volontiers à l’Orient) peut s’avérer, pour lui, un danger.
Mais si l’on ne s’arrête pas à ce niveau, les choses changent : elles changent même beaucoup. Si l’on cherche des ouvertures positives sur le surnaturel et si l’on se fixe comme but ce qu’on pourrait appeler la supra-personnalité, c’est-à-dire la personnalité intégrée par-delà les conditionnements humains courants, alors la référence au catholicisme (ne parlons pas, d’ailleurs, de celui de nos jours) n’est plus une limitation qui protège et préserve, mais un facteur de pétrification qui se juge lui-même à travers les réactions que son intolérance et sa partialité peuvent provoquer et provoquent chez tous ceux qui cherchent cette autre réalisation d’eux-mêmes et qui se sont penchés sur des traditions ou doctrines non occidentales et non chrétiennes dans lesquelles un contenu métaphysique ou initiatique est plus visible que la réduction religieuse, dogmatique ou rituélique de ce contenu à une rigide mythologie théiste.
Aujourd’hui, il est difficile de réactualiser la potentialité du christianisme des origines comme « doctrine tragique du salut », sinon à titre exceptionnel chez certains et en rapport avec des crises existentielles périlleuses. Quand ces conditions sont remplies, le problème ne se pose pas et nous dirons d’ailleurs, sans réticences, que si des personnes qui n’ont connu que les très vaines constructions de la philosophie et de la culture profane plébéo-universitaire d’aujourd’hui, ou bien les contaminations des différents individualismes, esthétismes et romantismes contemporains, se « convertissaient » au catholicisme et vivaient vraiment au moins la foi, dans un engagement total et, si possible, dans un sens « sacrificiel », il ne s’agirait pas pour elles d’une abdication, mais déjà, en dépit de tout, d’un progrès.
Cependant, nous devons nous attacher ici à la problématique spéciale que nous avons indiquée en songeant à un autre type humain et à une vocation différente. En fonction de cela, on pourrait se poser la question suivante : peut-on envisager une conception et une interprétation du catholicisme qui n’obligent pas à chercher ailleurs une voie ?
Il existe des milieux spiritualistes qui ont considéré cette possibilité dans le cadre de ce qu’on appelle l’ésotérisme chrétien et le « traditionalisme intégral ». Voyons comment les choses se présentent à cet égard.
À titre préliminaire, il est bon de distinguer la notion d’ésotérisme chrétien de celle d’initiation chrétienne : le premier a un caractère doctrinal, la seconde un caractère opératif et expérimental. Qu’une initiation chrétienne ait, en principe, existé, c’est là une question controversée qui concerne plutôt d’autres époques et qui, à notre avis, doit recevoir une réponse essentiellement négative.
Si l’on se rappelle bien clairement ce qu’est l’initiation au sens intégral et authentique du terme, on ne peut pas ne pas relever, en règle générale, une opposition entre le christianisme comme doctrine centrée sur la foi, et la voie initiatique. Aux origines, il est possible que les deux phénomènes aient été mêlés, en vertu des interférences du christianisme avec les anciennes traditions des Mystères et à cause de sa proximité par rapport à elles ; c’est ainsi qu’on trouve des traces de ces traditions chez les Pères grecs.
En traitant du théosophisme, nous avons fait allusion par exemple à la distinction posée par Clément d’Alexandrie entre le gnostikos, qui partage certains traits avec l’initié, et le pistikos, celui qui simplement croit. Mais, à ce sujet, toute vérification rétrospective précise est difficile à faire ; elle est même impossible, et tout ce que certains ont allégué pour soutenir l’existence d’une hypothétique initiation chrétienne se rapportant surtout à l’Église d’Orient et non au catholicisme romain, ne semble pas tant relever de l’initiation que de la simple donation de « bénédictions ». Ceux qui sont d’opinion différente ont également été amenés à estimer que des rites chrétiens ayant à l’origine un caractère initiatique, n’ont survécu ensuite et ne se sont transmis que sous une forme réduite ou transcrite purement religieuse et symbolique et ce dès le concile de Nicée. Autrement dit, il ne reste que l’univers de la mystique. Dans le cadre de l’Église, il n’y a aucune trace d’une transmission initiatique, laquelle, de par sa nature même, devrait être rigoureusement supra-ordonnée à la transmission assurée par les hiérarchies apostoliques existantes.
Quant aux prétendues initiations chrétiennes qui auraient lieu dans des milieux se tenant en dehors de l’Église et aujourd’hui, elles ont pour fondement, lorsqu’il ne s’agit pas de mystifications, des combinaisons hétérogènes dans lesquelles le christianisme n’est plus qu’un des ingrédients, sans aucune vraie racine de transmission traditionnelle. On peut en dire autant de ceux qui se sont eux-mêmes qualifiés, de nos jours encore, de Rose-Croix.
Le problème reste néanmoins ouvert pour ce qui concerne non une initiation chrétienne vérifiable ne serait-ce que dans le passé, mais un « ésotérisme chrétien », donc pour la possibilité d’insérer ce qui est présent au sein du catholicisme (et non au sein d’un vague christianisme) dans un système plus vaste, chose qui permettrait aussi de saisir la dimension et le sens les plus profonds de certains rites, symboles et structures. L’insertion, redisons-le, présente un caractère avant tout doctrinal. Il est à peine besoin de souligner que le plan auquel il faut alors se référer n’est pas celui du « christianisme ésotérique » de Besant et de Leadbeater, pour ne pas parler des exégèses des Évangiles dues à Steiner et remplies d’énormités incroyables.
Ce qui doit entrer en jeu ici, c’est ce que peut fournir le courant du « traditionalisme intégral », qui a trouvé en René Guénon son principal chef d’école. L’idée fondamentale, c’est ici celle d’une tradition primordiale métaphysique unitaire au-delà de chaque tradition ou religion particulière. En l’occurrence, le terme « métaphysique » n’est pas pris au sens abstrait qu’il a en philosophie, mais se rapporte à un savoir relatif à ce qui n’est pas « physique » dans l’acception la plus large du terme, et à une réalité qui transcende le monde purement humain et toutes ses constructions. Cette tradition aurait connu, à travers les différentes traditions historiques particulières, autant de manifestations plus ou moins complètes, avec des adaptations aux conditions du milieu, historiques et raciales, adaptations réalisées par des voies qui échappent à la recherche profane. Grâce à cette présupposition, il serait possible de retrouver des éléments constants ou homologables au sein des enseignements, symboles et dogmes de ces traditions historiques particulières et de se référer à un plan supérieur, objectif et universel.
Des idées de ce genre étaient apparues aussi dans le théosophisme et dans certains milieux maçonniques, mais sous une forme inadéquate ; c’est précisément l’école guénonienne qui a su les présenter et les développer de manière sérieuse et rigoureuse, en soutenant notamment la thèse de « l’unité transcendante des religions » (expression forgée par Frithjof Schuon, qui en a fait également le titre d’un livre intéressant). Il faut souligner qu’il ne s’agit pas ici d’un « syncrétisme », ni même des correspondances, parfois effectives mais toujours empiriques et extérieures, qui peuvent être relevées par l’histoire des religions la plus courante. La prémisse est ici formée par une méthode opposée, déductive, s’appuyant sur des connaissances fondamentales et sur des principes qui, de même qu’on peut déduire de la définition du triangle des théorèmes valables pour les différents cas, permet de comprendre comment, sous certaines conditions et en fonction de plusieurs formes possibles d’expression, ainsi qu’en vue de différentes exigences, on arrive, à partir de certains contenus et symboles de la tradition une, à tel ou tel corpus d’enseignements, croyances, dogmes, mythèmes et même superstitions, ces « constantes » demeurant en dépit de toutes les diversités et même de toutes les oppositions apparentes.
Or, la première intégration « ésotérique » du catholicisme devrait consister en ceci : sur la base des doctrines et des symboles de l’Église, il faudrait savoir percevoir ce qui, en eux, est vraiment « catholique », donc universel (katholikos signifie « universel ») ; autrement dit, savoir percevoir ce qui va au-delà du catholicisme, en saisissant aussi des relations éclairantes de caractère pour ainsi dire « intertraditionnel ». Cela n’impliquerait aucune altération des doctrines catholiques, mais permettrait d’en faire ressortir les contenus essentiels sur un plan supérieur à ce qui est simple religion, sur un plan métaphysique et avec des perspectives de réalisation qui pourraient répondre au besoin de ceux qui aspirent à la transcendance. Il importe toutefois de veiller à ne pas inverser le procédé comme cela, malheureusement, est déjà arrivé, assumant comme élément premier les doctrines catholiques avec leurs limitations spécifiques, pour y juxtaposer quelques références « traditionnelles ». Ce sont au contraire ces références qui devraient constituer l’élément premier, le point de départ.
Il est à peine besoin d’ajouter que l’axiome de l’Église, « Quod ubique, quod ab omnibus et quod semper », n’a de validité que dans cette perspective « traditionnelle » (ou supratraditionnelle, si l’on préfère). Il n’en a certes pas dans la perspective d’une certaine apologétique catholique qu’on pourrait qualifier de « moderniste », puisque dès le début elle a insisté fanatiquement sur le caractère de nouveauté et d’unicité du christianisme, se bornant à voir avant lui des anticipations et des « préfigurations », qui se rapporteraient surtout, d’ailleurs, au peuple juif en tant que peuple élu par Dieu.
La « nouveauté » n’est concevable qu’en ce qui concerne une adaptation particulière de la doctrine, adaptation qui n’est nouvelle que parce qu’elle tient compte de conditions existentielles et historiques inédites (lesquelles imposèrent d’ailleurs la divulgation de l’enseignement sous une forme qui n’a rien de supérieur). Afin de pouvoir affirmer de façon sensée l’axiome catholique rappelé plus haut, il faudrait en fait adopter l’attitude opposée : au lieu d’insister sur la « nouveauté » des doctrines, comme s’il s’agissait d’un titre de gloire, il faudrait chercher à en mettre en relief l’archaïsme et la pérennité, et ce précisément pour montrer dans quelle mesure elles peuvent être rattachées, en leur fond, à un corpus supérieur d’enseignements et de symboles qui est vraiment « catholique », à savoir universel. Ce corpus ne se laisse enfermer dans aucune époque ni aucune formulation particulière, tout en restant à la base de chacune de ces formulations, tant dans le monde préchrétien que dans le monde non chrétien, occidental et non occidental, ainsi que dans des traditions éteintes ou ayant pris des formes involutives et nocturnes, comme c’est le cas de certaines croyances qui se sont souvent conservées chez les peuplades sauvages.
Le catholicisme admet l’idée d’une « Révélation primitive » ou « patriarcale » faite au genre humain avant le Déluge et la dispersion des peuples. Mais, de cette vue, il n’a fait aucun usage qui lui eût permis de surmonter ses propres limitations. La seule exception, peut-être, est constituée par un ethnologue catholique, le Père W. Schmidt, qui a précisément appliqué cette vue à l’ethnologie dans son important ouvrage intitulé L’Idée de Dieu. Le catholicisme courant, lui, reste donc caractérisé par une fermeture, associée à un exclusivisme sectaire.
Parlons maintenant des contenus qui, dans le catholicisme, sont susceptibles d’une intégration « traditionnelle » et du caractère singulier de nombreuses correspondances en fait de mythèmes, noms, symboles, rites, fêtes et ainsi de suite — avec beaucoup d’autres traditions dispersées dans le temps et l’espace. Tout cela répond à quelque chose de plus fort que le simple hasard et dépasse les conclusions auxquelles peuvent aboutir les recherches empiriques et historiques.
Sur ce point, l’explication des théosophes, qui voient partout à l’œuvre des « Maîtres » et autres « Grands Initiés », est par trop simpliste. Il est au contraire nécessaire de tenir compte aussi d’une action imperceptible, sans relation avec des personnes, d’une influence « subliminale » qui, sans que ceux qui ont formé la tradition catholique le soupçonnent, peut avoir fait d’eux les instruments de la conservation de la tradition, alors même qu’ils pensaient faire tout autre chose ou qu’ils étaient poussés par des circonstances extérieures.
Il se peut donc qu’ils aient servi à transmettre certains éléments d’une sagesse primordiale et universelle qui sont présents dans le catholicisme à « l’état latent », comme disait Guénon, cachés sous la forme religieuse, mythique et théologico-dogmatique. Du reste, un tel point de vue pourrait même être partiellement accepté par l’orthodoxie catholique, à condition qu’elle interprète plus concrètement l’action de l’Esprit Saint, qui, tout au long de l’histoire de l’Église, aurait développé la « Révélation primitive » et inspirerait invisiblement chaque Concile. Dans la formation de tous les grands courants d’idées, ce qui peut être dû à des influences de ce genre (mais d’une autre nature dans ce cas) compte plus que ce que l’homme commun peut imaginer.
Dans la perspective du catholicisme courant, un grave obstacle à l’intégration traditionnelle dont nous parlons concerne le fondateur de cette religion, Jésus-Christ. En effet, l’idée que sa personne, sa mission, son message présentent un caractère unique et décisif dans l’histoire universelle (d’où, précisément, la prétention exclusiviste du catholicisme), ne saurait être acceptée, alors qu’elle constitue le premier article de foi du christianisme en général.
La conception même de la fonction de sauveur ou de rédempteur du Christ historique, dans la mesure où elle est formulée dans les termes d’une « expiation vicariante », à savoir de l’expiation, par un innocent, de fautes commises par d’autres (en l’occurrence du « péché originel » pesant sur la descendance d’Adam), présente une absurdité intrinsèque.
La prémisse, ici, n’est autre, évidemment, qu’une conception en fin de compte matérialiste et déterministe du suprasensible. En effet, la théorie selon laquelle une faute ne peut pas être effacée si elle n’est pas expiée par quelqu’un, implique la reconnaissance d’une espèce de déterminisme ou fatalisme, d’une sorte de karma : comme si la faute avait créé une manière de fardeau dont on doit se décharger dans tous les cas, sinon sur l’un, du moins sur l’autre, au point que le sacrifice d’un innocent ou d’une personne étrangère à la faute peut avoir la même valeur objective que l’expiation dans la personne du coupable. Tout cela appartient à un ordre d’idées très éloigné de la religion de la grâce et de la liberté surnaturelle que voudrait être le christianisme, par opposition à l’ancienne religion judéo-pharisaïque de la Loi.
Dès les premiers siècles de l’histoire du christianisme, ses adversaires soulignèrent à juste titre que si Dieu avait voulu racheter les hommes, il eût pu le faire par un acte simple de grâce et de puissance, sans être contraint de sacrifier, à titre d’expiation vicariante, son Fils, fournissant ainsi aux hommes l’occasion d’accomplir un nouveau crime horrible, comme si la rémission était une loi inexorable, quasi physique, contre laquelle Dieu même ne peut rien. Cela en dit long sur les difficultés qui surgissent lorsqu’on s’en tient, envers l’histoire du Christ, au point de vue exotérique et religieux et lorsqu’on ne sait pas séparer le côté interne et essentiel de la doctrine de thèmes qui proviennent de conceptions inférieures et qui n’ont pu venir au premier plan et s’affirmer comme autant d’« articles de foi » au sein du catholicisme qu’en s’appuyant sur des facteurs sentimentaux (sacrifice divin pour l’humanité, amour, etc.).
Relativement aux récits évangéliques, le problème de la réalité historique est, au fond, insignifiant. Du point de vue envisagé ici, il serait important, plutôt, d’établir dans quelle mesure la vie de Jésus de même que différents mythes se rapportant à des demi-dieux ou « héros » du monde païen peut être interprétée aussi comme une série de symboles qui se réfèrent à des étapes, états et actions du développement de l’être conforme à une voie donnée. Nous avons dit « aussi », car dans le cas de certains événements ou de certaines figures de l’histoire, des convergences occultes peuvent faire en sorte que la réalité soit symbole et le symbole, réalité. Aussi la vie d’un être réel peut-elle valoir simultanément comme dramatisation ou sensibilisation d’enseignements métaphysiques, à la façon des représentations dramatiques des Mystères gréco-romains, destinées à éveiller chez les impétrants des émotions profondes capables de les amener à accomplir certaines transformations de leur être propre.
Mais, du point de vue ésotérique, ce qui importe le plus dans les éventuelles rencontres du symbole et de la réalité, ce n’est pas l’aspect « réalité » — qui, dans cette perspective, présente un caractère instrumental et contingent —, mais bien l’aspect « symbole », à travers lequel on peut parvenir à quelque chose d’universel, de méta-historique et d’illuminant.
Les Pères de l’Église avaient déjà conçu une interprétation symbolique de la matière des Évangiles et, en partie, de l’Ancien Testament également. Mais cette interprétation s’arrêta au plan moral et, au mieux, au plan mystique-dévotionnel. Cela a aussi été le cas de « l’imitation de Jésus », où, abstraction faite des données historiques, le Christ est précisément présenté comme un modèle à reproduire, comme celui qui indique une voie. Il faut néanmoins noter que l’attribution de cette qualité à Jésus, négligeant sa réalité historique et la croyance en son action magique de rédemption de l’humanité, a été déclarée hérétique. Par ailleurs, même au sujet de « l’imitation du Christ » et de l’utilisation de cette figure sub specie interioritatis, il faut toujours garder à l’esprit la distinction entre le plan mystique-dévotionnel et le plan d’une réalisation métaphysique, auquel on peut aussi s’élever, selon les perspectives du « traditionalisme intégral ». Le fait demeure, cependant, qu’en général, dans le christianisme, l’idéal le plus haut est toujours celui, au fond moral et non ontologique, du Saint, de la sanctificatio, et non de la deificatio, à laquelle fit encore parfois allusion la patristique grecque : l’idéal du « salut » et non de la « Grande Libération ».
Quant à l’interprétation ésotérique, dans les termes d’une « science spirituelle », elle est inexistante dans l’orthodoxie, et ce depuis les origines, seuls des contenus moraux et allégoriques ayant été envisagés. La signification de la « Vierge », de « l’Immaculée Conception » et de la naissance de l’Enfant Jésus ; l’attente du « Messie » ; la curieuse correspondance entre Bethléem, lieu de naissance du Christ, et Bethel, nom donné par Jacob à l’endroit où, endormi sur une pierre, il eut, comme on sait, la vision et la connaissance de la « porte des cieux » ; le « cheminement sur les Eaux » (non sans relation avec saint Christophe qui fait traverser le « fleuve » à l’Enfant Jésus) ; le changement de l’eau en vin ; la retraite au « désert » ; l’ascension de la « montagne » et le discours depuis la « montagne » ; le fait, encore, que le Christ ait revêtu un manteau royal avant qu’on le lui enlève ; sa crucifixion au milieu d’une double croix ; le coup de lance au cœur, d’où s’écoulent eau et sang rouge ; l’obscurcissement du « ciel » et l’ouverture de la « terre » ; « l’enfer » dans lequel Jésus descend pour rendre visite, tel Énée, aux « morts » ; le fait qu’aucun cadavre ne fut retrouvé dans le sépulcre, la résurrection et l’Assomption du Christ, suivies d’une descente de l’Esprit sanctifiant (Pentecôte), et le don des langues ; le fait de ne pas avoir les « os brisés » et la puissance de « juger les vivants et les morts » ; les nombres symboliques : douze disciples de Jésus, trois rois mages (sans oublier le véritable sens de ces derniers), les quarante jours et nuits de la retraite au désert et de nouveau les quarante heures passées dans le sépulcre, etc. — fournir une explication de tout cela sub specie interioritatis en rattachant systématiquement ces éléments à un corps de doctrine ésotérique, voilà une tâche impossible à remplir tant qu’on s’en tient aux limitations de la foi, de la dévotion et de tout ce qui caractérise la simple conscience religieuse.
Peut-être une brève mise au point au sujet des « miracles » sera-t-elle opportune, puisque pour le spiritualisme moderne, ce qui importe, c’est surtout ce qui est « miraculeux ». Admettre la réalité des miracles, à commencer par ceux de Jésus, ce n’est pas tomber dans l’excès. On sait que les représentants de la vieille tradition romaine n’étaient ni étonnés ni scandalisés par les miracles attribués à Jésus.
En effet, les cultures antiques ont toujours reconnu certaines possibilités extra-normales, susceptibles même de faire l’objet d’une science sui generis (d’une magie au sens strict du terme), en vue de la production de certains « phénomènes ». Il n’y a guère eu que les « libres penseurs », hier encore, pour faire de ce genre de choses un grand problème, de même qu’il n’y a que le petit peuple pour tirer du miracle un motif de croyance. Mais le catholicisme, à juste titre, ne se contente pas de si peu. Il distingue entre miracles et miracles, et ne pose pas comme critère le « phénomène », mais sa cause ; or, nous l’avons déjà fait remarquer à propos du spiritisme, un même phénomène peut avoir des causes très différentes.
Néanmoins, quant au critère de distinction, le catholicisme campe sur une position faible. Dire que les phénomènes « occultes » sont dus à des forces diaboliques ou à des énergies latentes, mais toujours « naturelles », de l’homme ou des choses, alors que le vrai miracle est dû à « Dieu », n’est pas une façon de fournir concrètement un critère sûr. Entre autres choses, il faudrait commencer par préciser objectivement les limites de la « nature », et ne pas rappeler en même temps ce que disent les Évangiles, à savoir que l’Antichrist sera capable de produire des « signes » aussi puissants que ceux du « Fils de l’Homme ». Par ailleurs, poser comme condition que le phénomène ait des buts éthiques ou soit produit à des fins de conversion, c’est s’enfermer dans un domaine assez bas. Le seul élément d’une certaine consistance, c’est la revendication d’une signification, d’une force d’illumination qui soit liée de manière essentielle au phénomène, ainsi que la relation avec une personnalité vraiment supérieure.
Cela conduit au critère propre au point de vue métaphysique, selon lequel un phénomène est vraiment « surnaturel » quand il présente simultanément, comme autant de parties indissociables d’un tout, trois aspects : un aspect magique, un aspect symbolique et un aspect de transfiguration intérieure. On peut expliquer ce point par un exemple. La « marche sur les Eaux » est un symbole ésotérique, dont le christianisme n’a pas l’exclusivité, et qui renvoie à un contenu précis et à une condition d’existence précise. Se tenir au-dessus des « eaux », c’est se tenir au-dessus de « l’écoulement des formes », au-dessus du mode d’être des natures sujettes au devenir, à un désir qui en altère la vie et qui les prive de toute stabilité. Or, il est permis de penser qu’en certaines circonstances la réalisation intégrale du contenu de ce symbole par un être humain s’accompagne de la possession d’un pouvoir magique, lequel confère la possibilité effective de marcher sur l’eau sans couler, de sorte que le symbole se change en un fait, qui à son tour est symbole, signe et attestation illuminante d’une réalité et d’une loi d’ordre supérieur. On sait que l’exemple choisi correspond à l’un des miracles rapportés dans les Évangiles.
On pourrait trouver mention d’autres miracles du même type soit dans les Évangiles, soit dans les textes d’autres traditions. Ceux qui veulent découvrir le contenu métaphysique latent dans « l’histoire sainte » enseignée par le catholicisme et parvenir à comprendre ce qui, dans cette histoire, est vraiment « surnaturel » et non phénoménique, devraient s’élever à l’intelligence de ces choses. Ils pourraient alors apprendre à lire d’un autre point de vue non seulement les Évangiles et la Bible, mais de nombreux dogmes et de nombreuses doctrines théologiques catholiques ; ils pourraient aussi saisir, comme l’a souligné Guénon, l’essentiel de ce que la théologie affirme sur les anges, à savoir que cela désigne métaphysiquement les états transcendants de la conscience auxquels peuvent mener l’ascèse, l’Éveil et la renaissance intérieure ; ils comprendraient alors que les « démons » symbolisent des forces et états inférieurs au niveau humain.
Un examen du catholicisme devrait en outre rendre compte de tout ce qui, en lui et au-delà de son aspect doctrinal, possède une portée et un sens objectifs, de tout ce qui, en lui, renverrait à la magie au sens strict. La magie repose sur l’existence de forces subtiles, de caractère psychique et vital, et sur une technique qui peut agir sur elles et avec elles aussi nécessairement et impersonnellement, aussi indépendamment des qualités morales de l’objet et du sujet, que la technique appliquée aux forces matérielles.
Or ces caractères sont visibles dans ce que l’orthodoxie catholique attribue aux rites et aux sacrements. En vérité, rien n’est « arbitraire » ni « formel » dans ceux-ci. Qu’on songe au rite du baptême, réputé capable d’induire un principe de vie surnaturelle chez celui qui le subit, quel que soit le mérite ou l’intention de ce dernier ; qu’on songe à la qualité du prêtre fixée par l’ordination, qualité qui n’est pas effacée même quand le prêtre est souillé par une indignité morale ; enfin, qu’on songe au pouvoir de l’absolution, ordinaire et in extremis, pouvoir qui n’est autre, en fait, que celui de dominer et de suspendre ce que la tradition hindoue appelle la loi du karma. Ce ne sont là que quelques points qui permettraient de rattacher le catholicisme à un plan d’objectivité spirituelle, supérieur à l’irréalisme de la sentimentalité et de la moralité humaines : au plan, précisément, de la magie. En l’absence d’une référence de ce genre, la défense du catholicisme contre ceux qui, imbus de mentalité moderne, profane et rationaliste, dénoncent le côté superstitieux et même « immoral » des sacrements catholiques, ne peut être que très fragile.
Mais il est difficile pour un catholique d’adopter un tel point de vue. On est plutôt enclin à penser que tout ce qui est rite et sacrement, à supposer que cela ait eu une véritable potentialité « magique », l’a perdue et qu’on reste, dans le catholicisme, au niveau d’ersatz religieux qui ne reprennent que formellement la structure des rites magiques ou initiatiques.
C’est précisément dans ce contexte qu’il faut examiner la doctrine catholique des effets ex opere operato. En toute rigueur de termes, cette doctrine, si on la comprend correctement, affirme le caractère objectif des forces qui agissent dans le rite. Une fois que les conditions réclamées sont remplies, ces forces agissent d’elles-mêmes, provoquent un effet nécessaire, indépendamment de l’opérateur (non ex opere operantis), comme dans le cas d’un phénomène naturel. Mais, de même que pour la production des phénomènes naturels, ainsi il faut que là aussi certaines prémisses soient présentes. Les structures du rite, en elles-mêmes, sont aussi inefficaces que les fonctions et les mécanismes d’un moteur privé d’énergie électrique. Pour agir, c’est-à-dire pour entraîner certains effets psychiques conscients ou infraconscients, il faut que le rite soit vitalisé, qu’il existe un rapport avec le plan suprasensible, lequel fournit simultanément la connaissance des symboles primordiaux et non humains, ainsi que la force magique qui rend précisément efficaces les opérations rituelles. Il ne s’agit pas d’autre chose pour un aspect de cette force, pour la notion d’« Esprit Saint », du moins si l’on se réfère aux origines, donc à une époque où elle n’avait pas encore été « théologisée ». Sans cela, le corpus rituel et sacramentel est une pure et simple superstructure, auquel cas on peut mettre au premier plan, comme l’a fait avec cohérence le protestantisme en abandonnant tout le reste, ce qui relève seulement de la religion, de la « foi » et de la moralité.
Le rapport avec le plan métaphysique, de manière irrégulière et sporadique, peut se produire à travers des états d’exaltation, d’« enthousiasme sacré » de l’âme, pourvu que soit maintenue une droite orientation, capable de protéger contre l’évocation de forces invisibles, mais de caractère inférieur. Dans un cadre régulier et lorsqu’il s’agit d’une tradition, il est en revanche nécessaire que soient présents ceux qui servent de ponts stables et conscients entre le visible et l’invisible, entre le naturel et le surnaturel, entre l’humain et le divin. Selon l’étymologie même du terme, tel était le pontifex (= constructeur de ponts).
Le pontifex représentait précisément le point de jonction qui rendait possible la manifestation d’influences supérieures, efficaces et réelles, dans le monde des hommes. Et la succession des pontifes qui ne faisait qu’un, dans les formes supérieures et plus archaïques de la civilisation traditionnelle, avec la chaîne des représentants de la « royauté divine », garantissait la continuité et la pérennité de ce contact, constituait l’axe de la tradition au sens littéral du terme, donc de la transmission d’une « présence » et d’une force sacrée vivifiante et illuminante, dont pouvait bénéficier, par participation, un corps sacral régulièrement ordonné : sans cette force, redisons-le, tout rite est inopérant et tombe au rang de la simple cérémonie « symbolique ».
Nominalement, le pontificat, institution déjà présente dans la Rome antique, qui est au cœur de l’Église, se tient au sommet de sa hiérarchie. Mais il y a lieu de se demander ce qui subsiste, en lui, de sa fonction originelle et de l’ensemble traditionnel auquel il appartient. L’espérance prophétique d’un Joachim de Flore dans la venue du « pape angélique » ayant quasiment les traits d’un initié et inaugurant un nouveau « Règne », celui de l’Esprit Saint vivant, agissant et vivificateur, est malheureusement restée une utopie. Et si l’on songe aux contingences des dernières décennies, et surtout aux papes Jean XXIII et Paul VI, ainsi qu’à l’atmosphère d’« aggiornamento » et de modernisation, à l’aversion croissante pour « l’intégralisme » catholique et pour les « résidus moyenâgeux », il semble qu’il faille dresser définitivement un bilan désastreux.
Les conditions qui permettraient de donner une quelconque réponse positive à la question que nous avons posée en commençant — dans quelle mesure le catholicisme est susceptible de fournir à beaucoup d’esprits ce qu’ils ont cherché ailleurs et qui les a si souvent plongés dans les confusions et les erreurs du néo-spiritualisme — apparaissent donc inexistantes, du moins si l’on envisage le problème dans un cadre global. Il est problématique que l’Église, « corps mystique du Christ », soit porteuse et détentrice d’une vraie puissance surnaturelle agissant objectivement à travers les rites et les sacrements, dont pourraient tirer profit ceux qui en deviendraient membres, tout en aspirant à des expériences dépassant ce qui est religion confessionnelle et tout en ne voyant pas dans la « sainteté » la fin ultime.
Nous avons reconnu que le catholicisme contient malgré tout des traces d’une sagesse qui peuvent servir de base à une interprétation « ésotérique » de différents contenus par telle ou telle personne, dans le cadre du « traditionalisme intégral », la direction à suivre étant alors indiquée par ces paroles d’un représentant du courant en question : « Le fait que les responsables de l’Église catholique comprennent si peu leurs propres doctrines [il est fait référence à la dimension interne de celles-ci] n’entraîne pas que nous devions faire preuve de la même incompréhension. » Dans le cas contraire se présentent toutes les limitations et tous les empêchements, difficiles à écarter, que nous avons considérés précédemment.
Abstraction faite du catholicisme séculier, on pourrait se référer à l’ascétique catholique, notamment dans son rapport avec de vieilles traditions monastiques, pour ce qui concerne sinon une initiation, du moins une discipline intérieure qui envisage une orientation vers la transcendance, une approche du surnaturel. Mais alors un pénible travail de purification pour aller à l’essentiel s’imposerait, étant donné la coprésence d’éléments dévotionnels et de cadres spécifiquement chrétiens. Aussi est-il peut-être difficile de réunir des instruments valables pour l’action intérieure sans connaître également ce qu’offrent d’autres traditions.
Un catholicisme qui s’élèverait au niveau d’une tradition vraiment universelle, unanime et pérenne, où la loi pourrait être intégrée à la réalisation métaphysique, où le symbole deviendrait voie d’Éveil, où le rite et le sacrement seraient un acte de puissance, où le dogme traduirait une connaissance absolue et infaillible parce que non humaine et, comme telle, vivante chez des êtres libérés du lien terrestre à travers une ascèse, où le pontificat recouvrerait sa fonction médiatrice originelle — un tel catholicisme pourrait supplanter tout « spiritualisme » présent et futur.
Mais quand on observe la réalité, n’a-t-on pas le sentiment que ce n’est là qu’un rêve ?
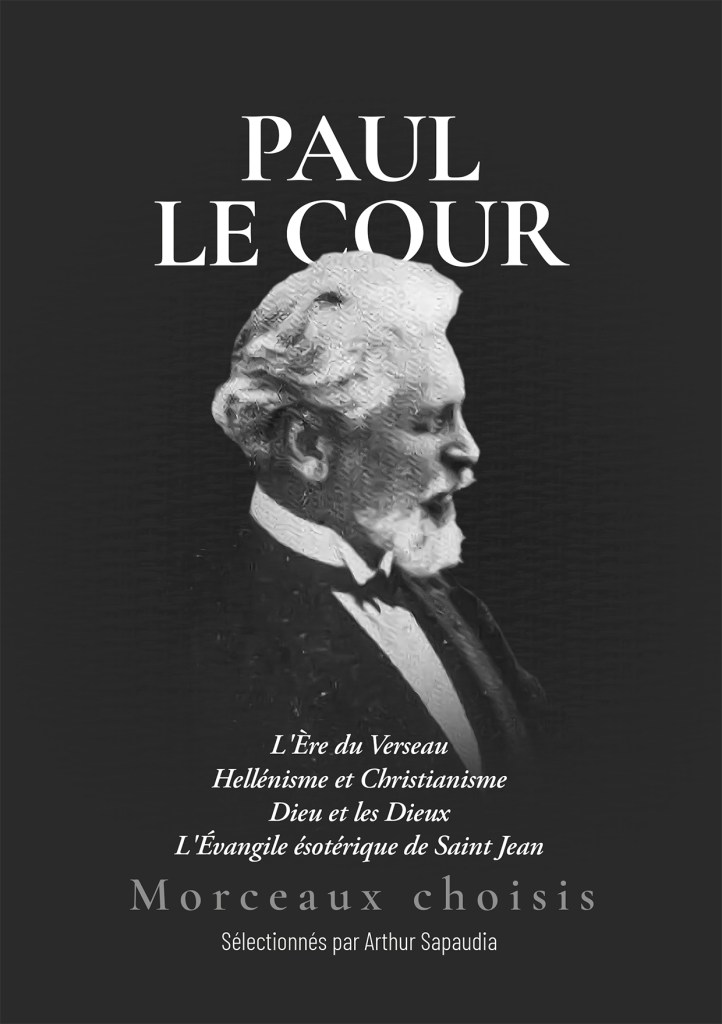


Merci pour cet extrait, toujours choisi avec pertinence.
Connaissez-vous des auteurs qui ont justement tenté de ré-interpréter différents aspects du catholicisme, en comparaison avec d’autres courants religieux, afin de les rattacher à une éventuelle tradition primordiale ?
Merci de votre réponse.
J’aimeJ’aime