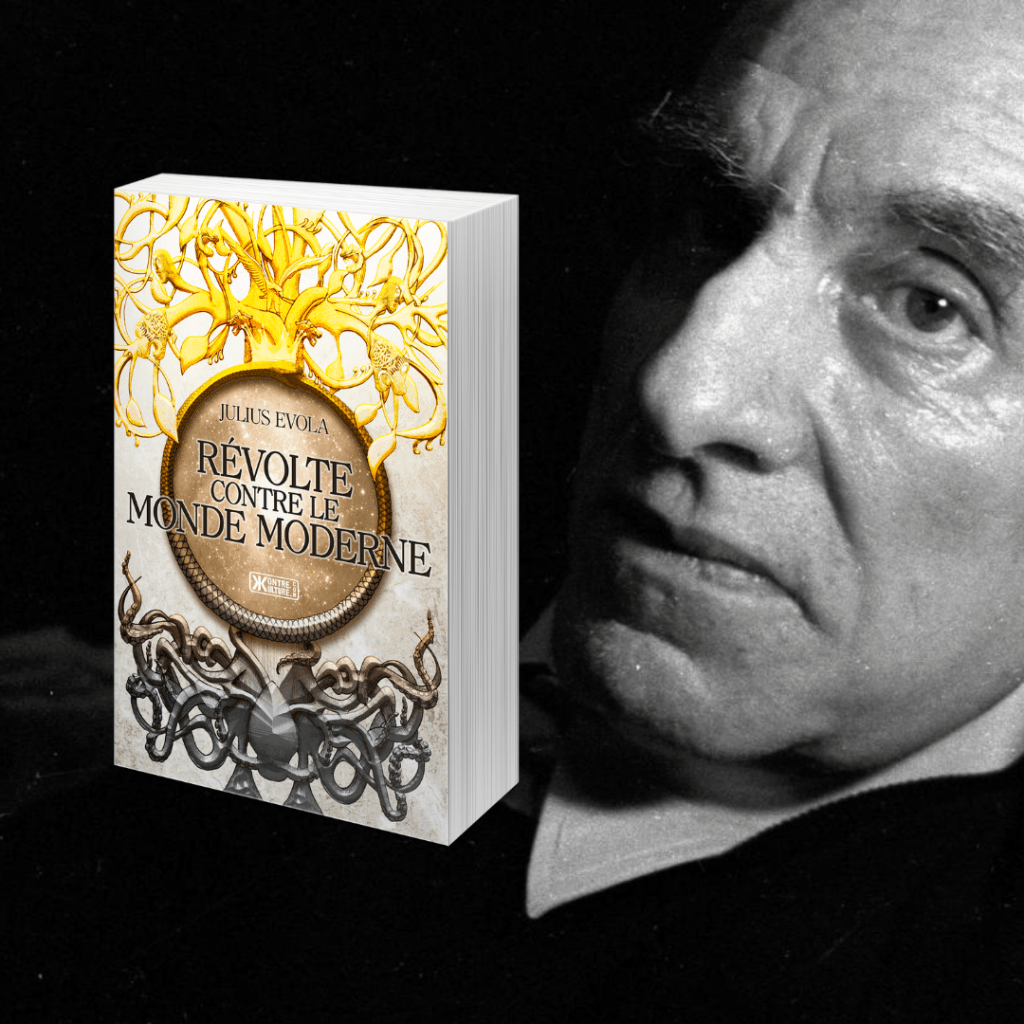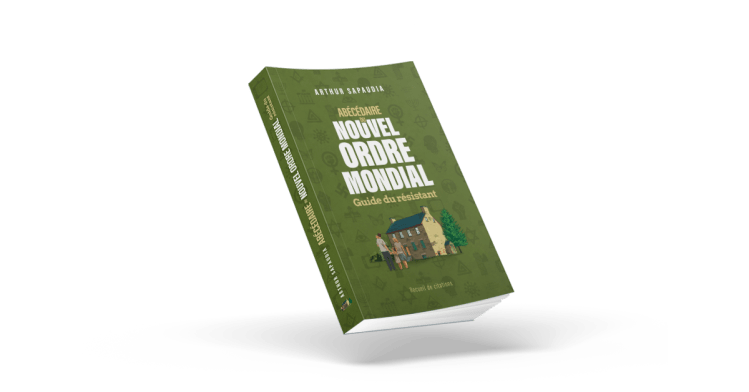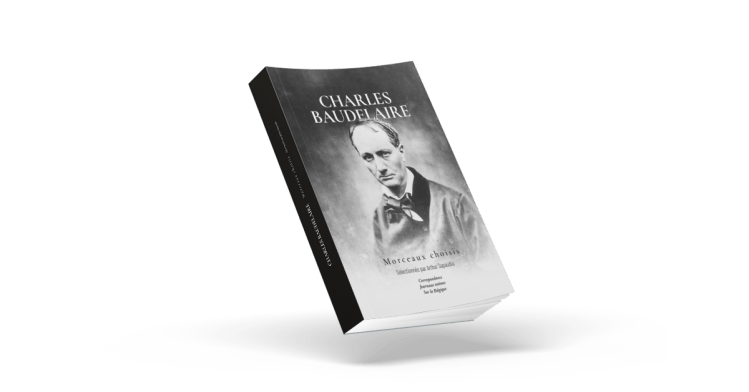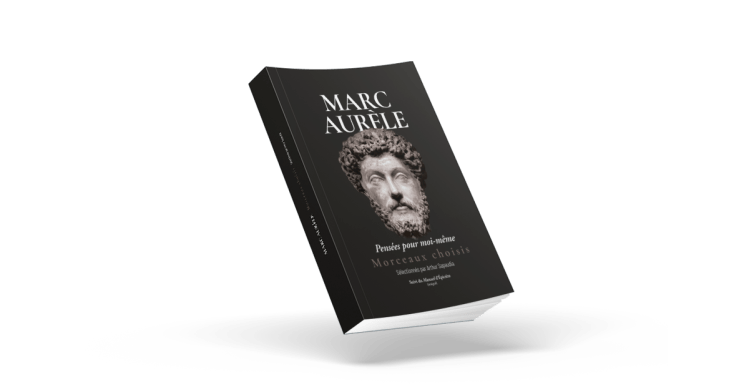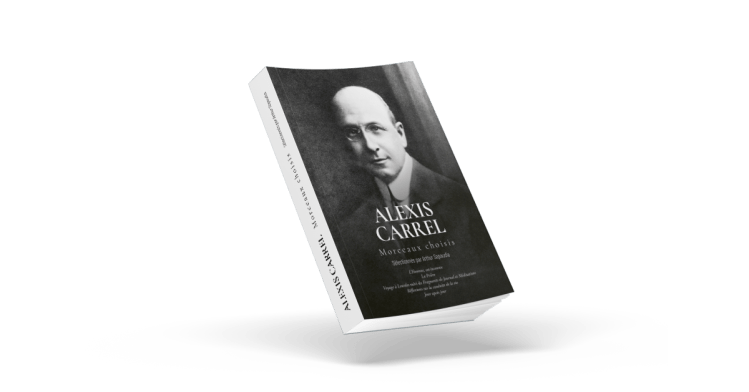Extrait d’Adriano Romualdi, Julius Evola, L’homme et l’œuvre, 1968
Dans le fascisme ou le national-socialisme, dans la mesure où ils mettent en avant leurs axiomes mythico-raciaux, Evola voit la possibilité d’un nouveau rattachement des peuples au monde de la Tradition, le point de départ d’une histoire authentique grâce à une nouvelle légitimation des relations existant entre l’esprit et la puissance. C’est ainsi que, grâce à l’apport doctrinal d’Evola, apparaît en pleine lumière ce que de tels mouvements possèdent de plus profond pour marquer de leur sceau une époque.
Voici comment Gottfried Benn, l’un des plus grands poètes allemands contemporains, saluait, dans la revue Die Literatur, l’édition allemande de Révolte contre le monde moderne. Un peu plus loin, il écrivait :
(…) Ce livre embrasse tous les grands problèmes européens dans des directions jusqu’ici ignorées ou masquées, et quiconque le lit regardera ensuite l’Europe avec des yeux neufs », dans la mesure où « après l’avoir lu, on se sent transformé.
Il pourrait sembler étrange qu’en 1935 déjà, lorsque Benn écrivait ceci, la pensée d’Evola, bien que mûrie à l’écart de la politique, ait pu apparaître à certains comme une sorte de dimension « en profondeur » du fascisme.
Un observateur superficiel pourrait également penser qu’entre les prémisses libertaires de « l’individu absolu » et le fascisme, il y a une certaine contradiction.
Contradiction en apparence seulement : la liberté évoquée par Evola n’est pas la liberté de l’homme mais celle d’un surhomme. Il y a finalement, dans la pensée d’Evola, la logique du « rien n’est vrai, tout est permis » : le monde physique n’est pas plus vrai que le rêve d’un esprit plus fort que lui ; et « tout est permis », car il n’y a pas d’autre « Dieu » que le Moi. Mais cette formule s’adresse à celui qui a atteint un degré de réalisation de soi propre à le porter au-delà même des limites du monde physique. Pour les autres, la voie de la liberté passe par la mortification des instincts, des sentiments et des inclinations qui empêchent d’être libre, de comprendre que « je est un autre ». C’est par la discipline que l’on devient libre, seigneur de son propre chaos, et ceux qui se laissent vivre sont simplement des esclaves en liberté, des gens qui n’ont aucun droit, même pas celui de vivre.
La discipline militaire plaisait à Evola qui, en appendice aux Saggi sull’idealismo magico, citait déjà cette formule d’Otto Braun, adolescent allemand mort au champ d’honneur :
Discipline d’un esprit brûlant intérieurement de passion mais extérieurement rigide et trempé comme l’acier, renfermant avec magnificence la démesure de l’infini.
Ailleurs, il a rapporté l’exemple de cet Ordre ismaélien de l’époque des Croisades où l’on distinguait six grades : dans les quatre premiers, il fallait obéir (au point de se jeter du haut d’une tour sur un signe du Maître), dans les deux derniers, on jouissait d’une liberté égale à celle des Dieux.
Ces éclaircissements apportés, on comprend mieux pourquoi Evola a fini par se retrouver non pas au milieu des anarchistes mais aux côtés de l’Ordre Noir.
Tandis qu’il se consacrait à l’art et à la philosophie, défilaient en Europe les années vingt, les roaring twenties.
La Grande Guerre avait révélé au monde et à eux-mêmes des individus épris d’une mystique de l’action et de la lutte politique, en quête d’un monde où, comme disait l’ancien combattant anglais Oswald Mosley, « les héros eux aussi pourraient vivre ». Lawrence d’Arabie, Jünger, Codreanu, von Salomon, Hitler, Mussolini, Balbo, Muti — des hommes appartenant à un monde qui n’était plus celui des assemblées et des parlements, mais celui des soldats et des sections d’assaut.
Alors qu’en Italie s’affirme et se consolide le régime fasciste, Evola, tout en repoussant l’épithète de fasciste et en ne s’inscrivant pas au parti, ne s’en trouve pas moins, par vocation, aux côtés des hommes de la révolution nationale.
Bien des choses les séparaient, notamment le pathos nationaliste, mais d’autres les rapprochaient : en premier lieu, leur commun refus de la démocratie. Ne s’agissait-il pas de la première tentative d’imposer à une Europe privée d’épine dorsale la nouvelle Rangordnung prophétisée par Nietzsche ?
La première apparition d’Evola sur la scène politique eut lieu dans Critica Fascista, sur l’invitation de Bottai, un ancien camarade du front du même âge que lui. Dans une série d’articles, Evola affirme que le fascisme, pour être réellement en conformité avec l’éthique guerrière et « romaine » qui est la sienne, doit distinguer ses objectifs de ceux du christianisme :
« Nous avons posé par hypothèse un pur rapport de cause à effet : si certaines prémisses sont acceptées, en ce cas certaines conséquences s’imposent également. Notre article dans Critica Fascista, et qui fit scandale, commençait ainsi :
« La prémisse, c’est que le fascisme en sa force la plus pure s’identifie à une volonté d’empire ; que son évocation de l’Aigle et du Faisceau ne peut pas être d’ordre simplement rhétorique ; que, de toute façon, telle est la condition pour qu’il représente quelque chose de nouveau : non pas une révolution pour rire, mais une résurrection héroïque ».
« À l’intention de tous ceux qui, ayant adopté ces prémisses, veulent rester en accord avec la logique, nous répétons avec une totale indifférence au nouveau tollé que ceci pourra éventuellement susciter dans les rangs catholiques et chrétiens — la conclusion de l’article en question, mot pour mot :
« Si le fascisme est volonté d’empire, c’est en renouant avec la tradition païenne qu’il sera vraiment lui-même, qu’il pourra brûler de cette tension qui aujourd’hui lui fait défaut et qu’aucune croyance chrétienne ne pourra jamais lui donner ».
Cette prise de position tombe à un mauvais moment : nous sommes à la veille du Concordat et l’on y suspecte une action de sabotage. Devant les protestations de L’Osservatore Romano, Bottai finit par désavouer Evola.
Paraît alors Imperialismo pagano qui, traduit en allemand, va faire connaître Evola comme le chef de file d’un courant païen à l’intérieur du fascisme.
Une seconde apparition d’Evola, avec la revue La Torre, ne reçoit pas meilleur accueil. Il y écrivait : « Nous ne sommes ni fascistes, ni antifascistes — d’ailleurs, l’antifascisme n’est rien ». Et aussi : « Nous voudrions un fascisme plus radical, plus intrépide, un fascisme vraiment absolu, fait de force pure, inaccessible à tout compromis ». Il suffit d’obscures manœuvres, orchestrées par des médiocres que protégeait la carte du parti, pour faire interdire la revue dès le numéro dix…
Evola finit cependant par obtenir une espèce d’immunité à l’intérieur du fascisme grâce à Farinacci, dont il fut l’ami et dont il loua toujours la loyauté et l’honnêteté. Farinacci n’était pas précisément un « intellectuel », mais c’était un homme intelligent qui avait compris ce qu’Evola pouvait lui apporter dans le combat qu’il avait choisi de mener pour un fascisme plus intransigeant, moins dépendant de la Cour et du Vatican, plus proche du national-socialisme. C’est ainsi qu’Evola obtint une page du Regime Fascista consacrée à la discussion des « problèmes de l’éthique fasciste ».
Dans ces colonnes eut lieu, pendant des années, une confrontation du plus haut intérêt entre des collaborateurs aussi différents qu’Othmar Spann et A.E. Günther ; le prince de Rohan et René Guénon ; Karl Wolfskehl, juif émigré d’Allemagne, et le chef de la SS, Himmler.
D’une façon générale, l’écho rencontré par Evola en Italie fut minime.
Sous la protection de Gentile s’y perpétuait une culture neutre, bourgeoise, implicitement antifasciste. Et le fascisme lui-même ne possédait pas une véritable conscience idéologique de Droite.
En Allemagne, par contre, régnait un climat très différent né de ce que l’on a appelé la konservative Revolution, qui accompagna la naissance du nazisme. Il y avait la morphologie antiprogressiste de l’histoire, le mythe du césarisme et du prussianisme militant d’un Spengler. L’idée de la « mobilisation totale » et le rêve d’un type humain « prussien, spartiate, bolchevique » d’un Jünger. Il y avait le Cercle de Vienne, qui défendait l’idée d’un État organique et d’un système hiérarchique des connaissances. Il y avait, enfin, le national-socialisme, avec ses courants racistes et néopaïens, avec la SS, nazisme à l’intérieur du nazisme, conçue à l’image de l’Ordre Teutonique.
Dans ces milieux ne manquait pas non plus l’intérêt pour les sciences occultes, comme le souligne Le matin des magiciens, livre par ailleurs truffé d’erreurs et d’exagérations. C’est précisément à Pauwels et Bergier que l’on doit la définition suivante du nazisme : « Guénon + les Panzerdivisionen ».
Mais c’est surtout des milieux conservateurs qu’Evola se rapprocha : de l’Herrenklub, devant lequel il prononça plusieurs conférences, et de certains instituts de la SS tels que l’Ahnenerbe, qui se consacrait à l’étude des races et des origines aryennes. Il se lia d’amitié avec Heinrich von Gleichen, Ferdinand Clauss, Johann von Leers, mais également avec Franz Altheim. Traduits en allemand, Imperialismo pagano et Révolte contre le monde moderne furent lus, recensés, discutés, suscitant beaucoup plus d’intérêt qu’en Italie. À cet égard, on a pu dire que c’étaient les prémisses culturelles elles-mêmes qui, en Italie, faisaient défaut.
En Allemagne, le rôle joué par Evola ne fut pas politique, même s’il contribua à dissiper bien des équivoques et à préparer le resserrement des liens entre fascisme et national-socialisme. Il précisa la signification des traditions dont ces régimes se réclamaient en Italie et en Allemagne : le symbole romain et le mythe nordique, le sens du classicisme et du romantisme, et il réfuta des oppositions artificielles comme, par exemple, celle de la romanité et du germanisme.
Au-delà de la rhétorique humaniste de la « barbarie teutonne » et de celle, opposée mais équivalente, du « formalisme romain », Evola souligne l’unité originelle des races aryennes. Rome n’est pas un mythe pour hommes de lettres italiotes ou latinisants, mais une expression de la positivité nordique qui créa aussi le style prussien. Au-delà de la légende d’une Rome bureaucratique à l’usage d’avocats napolitains et de celle d’un germanisme de « teutomanes » coiffés d’un casque à cornes, il y a la réalité de Rome — « élitisme, réalité olympienne et héroïque, ordre, lumière, virilité et action pure » — ainsi que la réalité de l’ancien monde nordique.
Günther, dans son essai Humanitas, avait rappelé à ceux de ses compatriotes qui voulaient germaniser l’école au détriment du grec ou du latin, que c’est précisément dans le monde grec et romain que s’exprima ce style de noble tranquillité, de sévère contenance intérieure et extérieure propre aux races blondes indo-européennes descendues du Nord. Evola insiste sur le caractère nordico-aryen de Rome ; la réactivation de certains éléments nordiques, « prussiens », dans le peuple italien, et le retour à un certain équilibre classique, « solaire », du peuple allemand, ne représentent pas du tout une dénaturation, mais, au contraire, une reconquête et une réintégration.
La signification de Rome pour l’esprit « olympien » germanique est précisément le titre d’une conférence tenue par Evola dans plusieurs villes d’Allemagne. Après avoir redéfini les concepts d’État et d’Empire, il transcende l’opposition entre romantisme et classicisme dans la vision de la rencontre des deux lumières, celle du Nord et celle du Sud :
Au cours de l’histoire, le Nord et le Sud ont été l’objet d’une double nostalgie qui n’a que rarement trouvé son équilibre. À cet égard, si la nostalgie du Sud est essentiellement ‘physique’ et sentimentale, celle du Nord est avant tout métaphysique et spirituelle. Aujourd’hui encore, l’homme d’Europe centrale et septentrionale a la nostalgie du Sud soit comme humaniste, soit parce qu’il recherche le soleil, le repos et une certaine atmosphère pittoresque qu’il assimile à de l’exotisme. La nature de la nostalgie du Nord que l’on rencontre ici et là chez les peuples méditerranéens à l’époque classique eut une autre teneur (…). Dans le Nord, le soleil de minuit leur offrit le symbole physique du plus haut mystère de l’antiquité méditerranéenne ; celui de la lumière intérieure qui se lève là où décline la lumière physique. Le Nord, avec son phénomène d’un jour quasiment privé de nuit, leur sembla la terre la plus proche de celle de la lumière éternelle (…).
Mais, pour l’homme du Nord aussi, la lumière du Sud peut devenir principe d’éveil, dès lors qu’il laisse derrière lui les perspectives unilatérales d’un « héroïsme tragique » avec ses complaisances romantiques et nocturnes :
Selon le Völuspá et le Gylfaginning, un ‘nouveau soleil’ et une ‘autre race’ se lèvent à l’issue du ragnarökkr ; les ‘héros divins’, ou Ases, retournent sur l’Idafels et retrouvent l’or qui symbolise la tradition primordiale du lumineux Asgard et l’état des origines. Par-delà les brouillards de la ‘forêt’ règne par conséquent une plus pure lumière. Il y a quelque chose de plus fort que le devenir et la destruction, que la tragédie, le feu, le gel et la mort. Qui ne se souvient de ce qu’écrivait Nietzsche : ‘Par-delà la glace, le Nord et la mort — là est notre vie, notre félicité’ ? Telle est l’ultime profession de foi de l’homme nordique, profession de foi qui, en dernière analyse, peut se dire aussi olympienne et classique (…). Cette nostalgie de l’âme nordique pour la luminosité méditerranéenne peut aussi dépasser le plan de l’esthétisme et du naturalisme pour acquérir le sens plus profond d’une tension spirituelle qui, déjà dans le domaine de la réalité physique, cherche à pressentir une réalité métaphysique.
Mais l’action d’Evola n’eut pas seulement pour théâtre l’Allemagne. C’est ainsi qu’ayant entrepris une série de voyages afin de prendre contact avec un certain nombre de personnalités des mouvements nationaux, il rencontra à Paris Monseigneur Mayol de Lupé, le futur aumônier de la division SS Charlemagne, et fit la connaissance à Bucarest de Mircea Eliade et surtout de Codreanu, le chef de la Garde de Fer.
Codreanu est la personnalité qui, dans ces milieux, a le plus profondément marqué Evola. Il le reçut dans la fameuse « Maison Verte », que les légionnaires avaient bâtie de leurs propres mains, après lui avoir offert l’eau et la confiture selon les traditions de l’hospitalité roumaine. Il lui exposa alors sa conception selon laquelle le fascisme italien prenait avant tout soin du corps (l’État), le national-socialisme de l’âme (la race), et la Garde de Fer, de l’esprit. En prenant congé, il lui offrit l’insigne légionnaire représentant une grille : « Ce sont les barreaux de nos années de prison », expliqua-t-il en souriant. Peu de temps après, il fut incarcéré puis étranglé sur ordre du roi Carol et de ses conseillers.
D’aucuns se demanderont pourquoi l’action menée par Evola n’exerça pas une influence très profonde. À vrai dire, s’il s’engagea résolument en tant qu’écrivain et propagandiste, Evola ne renonça jamais à ses véritables centres d’intérêt, qui étaient d’ordre personnel et spirituel. Il était inconcevable qu’un homme de sa trempe perde son temps à briguer une chaire d’université comme « philosophe », et tout aussi impensable qu’il aille faire antichambre chez les hiérarques pour tisser patiemment les fils de « sa » politique. On pourrait ajouter à cela l’absence, à l’intérieur du parti fasciste, de tout véritable débat ; le conformisme omniprésent ; l’arme commode, enfin, qu’offrait à ses détracteurs son intérêt pour la « magie ».
Le véritable Evola, c’est celui qui disparaît pendant des mois au milieu des glaciers pour écrire un livre, qui alterne les jolies femmes (et elles furent nombreuses) avec ses ascensions alpines vécues comme un entraînement spirituel :
La montagne est esprit en raison de tout ce qu’elle implique comme discipline des nerfs et du corps, comme hardiesse lucide en même temps qu’exacte mesure du danger, esprit de conquête et, en somme, élan vers l’action pure dans une atmosphère de force pure.
C’est celui qui partage son temps libre entre les cabarets de Vienne et les cloîtres alpins des Cisterciens, à la dure discipline desquels il se soumet pendant des mois ; c’est le voyageur qui frappe à la porte de la « Maison Verte » ou de l’Ordensburg Crössinsee, parmi les lacs poméraniens. C’est un homme qui ne peut sacrifier l’expérience à la publicité ni la recherche intérieure au succès.
Pourtant, la notoriété d’Evola alla lentement croissant, jusqu’à ce que l’on a appelé la « campagne pour la défense de la race », laquelle sembla indiquer le moment où le fascisme allait définitivement s’engager aux côtés du national-socialisme, y compris dans le domaine de la lutte pour la vision du monde et de la vie.