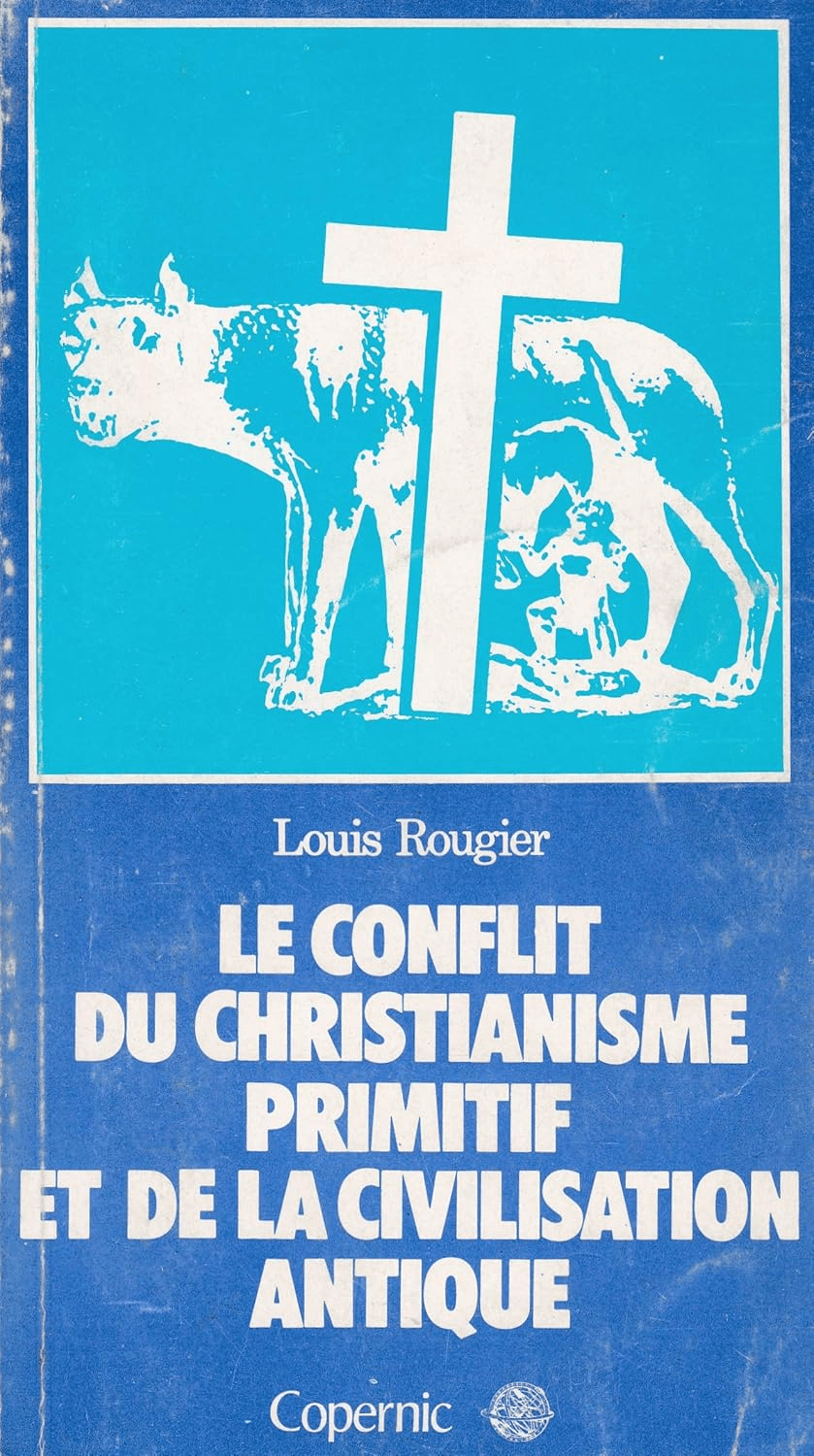Extrait de Louis Rougier, Le conflit du christianisme primitif et de la civilisation antique, 1977
M. Marcel Simon (…) montrait comment, considérée à l’origine par les païens comme une variété de la judaica superstitio, l’Eglise s’était détachée progressivement de la Synagogue jusqu’à revendiquer pour elle, auprès des autorités romaines, les immunités légales dont jouissait le judaïsme en tant que religio licita, sous prétexte qu’elle était devenue le « Verus Israël », les Juifs ayant été déboutés de la Promesse faite par Iahvé aux patriarches, en s’obstinant à ne pas reconnaître Jésus comme le Messie promis par les Ecritures. C’est lors de la guerre de Bar-Kochba, sous Hadrien, que fut définitivement tranché le cordon ombilical qui reliait le christianisme au judaïsme, les Juifs reconnaissant en Bar-Kochba le Messie qui, pour les chrétiens, était apparu un siècle auparavant.
(…) le christianisme est une religion qui s’est (…) diffusée fort lentement. Il lui a fallu quatre siècles pour s’imposer en Occident et devenir religion d’Etat, ce qui prouve la longue résistance qu’il a rencontrée. Quelle différence avec le manichéisme, par exemple. La lenteur de la diffusion du christianisme prouve l’opiniâtreté de la résistance païenne.
Le christianisme triompha, mais en se métamorphosant au point de devenir méconnaissable. Les désignations de Nazaréens (ou Nazoréens), de chrétiens, de catholiques marquent les principales étapes de cette mutation. La foi nouvelle naît en marge du zélotisme qui sévissait particulièrement en Galilée. En le reconnaissant comme Messie, les disciples de Jésus attendent de lui « la délivrance d’Israël » (Luc, XXIV, 37) et le rétablissement de la « Royauté en Israël » (Act. I, 6). Lors de son entrée à Jérusalem, les foules l’acclament comme « Roi venant au nom du Seigneur » (Luc, XIX, 38) et comme « Fils de David » (Matthieu, XXVII, 9). Jésus est arrêté comme agitateur politique. Le titulus sur la croix, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs », l’assimilation par le rabbin Gamaliel des disciples de Jésus à Theudas et à Judas de Gamala, celle de Paul à l’Egyptien par l’officiel romain qui le protège prouvent à l’évidence que les « Nazaréens » furent pris à l’origine par les autorités juives et romaines pour des résistants d’Israël conspirant contre l’ordre établi.
La première communauté de Jérusalem révèle un tout autre climat. Les apôtres, censés avoir reçu l’illumination de l’Esprit-Saint, comprennent par les Ecritures que le Messie attendu devait se révéler sous deux aspects différents : un aspect humilié et passible, l’identifiant au serviteur de Iahvé chanté par Isaïe et par les Psaumes, qui prend sur lui les péchés du monde et les rachète par ses souffrances, et une forme glorieuse, qui identifie Jésus ressuscité au Fils de l’homme des apocalypses de Daniel et d’Hénoch, siégeant à la droite de Dieu d’où il viendra sur les nuées pour juger les vivants et les morts. C’est la doctrine de la double Parousie, qui permet de transfigurer le Messie national chargé de libérer la Palestine du joug des Romains en un Messie eschatologique qui inaugurera le Royaume de Dieu quand les temps seront révolus.
La première communauté de Jérusalem vit dans l’attente de la seconde Parousie. Elle résume sa foi dans cette prière Maranatha : « Que le Seigneur vienne / Viens, Seigneur ! L’ajournement du retour attendu créa la nécessité de s’organiser. On attendait la Parousie, on eut l’Eglise », selon le mot célèbre de Loisy. Cette première Eglise eut été sans lendemain, si une persécution fomentée par l’autorité juive n’avait dispersé le petit groupe de ceux que les Actes appellent les hellénistes, dont le chef Etienne avait été lapidé pour avoir blasphémé le culte du Temple qu’il trouvait idolâtrique. Ce fut l’origine de la mission qui, en se détachant du culte jérusalémite, créa à partir d’Antioche, où le terme de « chrétiens » apparaît pour la première fois, un élargissement universaliste.
En substituant la justification par la foi à la justification par la Loi, Paul, considéré de son vivant comme un « faux apôtre », comme un « apostat », créa l’helléno-christianisme, ouvert au monde des Gentils.
Sans le paulinisme, le christianisme fut demeuré une petite secte juive sans avenir.
L’helléno-christianisme, plus ou moins pénétré de gnose, se fut lui-même volatilisé en un foisonnement de sectes rivales sans la formation d’Eglises, en rapports intimes les unes avec les autres, qui se réclamaient de leur origine apostolique. Celles-ci substituèrent une organisation hiérarchique de presbytres et d’épiscopes, imposant une doctrine, un rituel, une discipline, au pneumatisme, au prophétisme des premières assemblées. L’inspiration charismatique fut subordonnée au ministère ecclésias tique. Dès lors, l’histoire du christianisme fut dominée par l’histoire de l’Eglise.
À la veille de l’édit de Milan (312), les Eglises régionales hésitent encore entre l’épiscopalisme, suivant lequel chaque évêque est souverain dans son ressort, et la primauté doctrinale et disciplinaire du pontife de Rome appelée à devenir en Occident la papauté. L’Eglise constantinienne se transforme elle-même en catholicisme, lorsqu’en 378 l’évêque de Rome Damase obtient de l’empereur Gratien que le bras séculier soit mis au service de l’Eglise pour les affaires ecclésiastiques. Par un édit promulgué à Thessalonique le 28 février 380, Théodose décrète : « Tous nos peuples doivent se rallier à la foi transmise aux Romains par l’apôtre Pierre, à celle que professent le pontife Damase et l’évêque Pierre d’Alexandrie.. Ceux-là seuls qui l’observent ont droit au titre de chrétiens catholiques (christiani catholici) ».
Cela mit fin à l’édit de tolérance de Sirmium, pris par le même Gratien en 379, qui accordait la liberté de se tromper, securitas erroris humani. Il faudra attendre le XVIIIeme siècle pour voir revendiquer à nouveau la « liberté d’errance ». Ce que l’édit de Théodose établit, écrit Mgr. Duchesne, c’est « une orthodoxie d’Etat ».
Désormais l’Eglise catholique a seule une existence légale. Ayant mis le pouvoir temporel à son service, elle va pouvoir servir contre les païens, les apostats et les hérétiques. Le 10 janvier 381, un nouvel édit, précisant celui de Thessalonique, interdit aux hérétiques de se dire chrétiens et donne leurs églises aux nicéens. Le 8 mai, un nouvel édit frappe les manichéens : tout ce qu’ils ont reçu ou légué, depuis la loi de 372 qui les taxait d’infamie, est confisqué. Les édits se succèdent contre les ariens, les macédoniens, les pneumotomaques, les encratites, les apostats. En 382, Gratien supprime le budget des cultes païens. Le 27 février 391, le culte païen est interdit à Rome. Le 8 novembre, Théodose étend la proscription à tout l’Empire y compris les cultes domestiques : « Toute maison où l’encens a brûlé appartient au fisc ». Ambroise, dans son oraison funèbre de Théodose, applaudit avec enthousiasme à ces mesures.
L’Eglise se hérisse de dogmes que définissent synodes et conciles œcuméniques au prix de controverses, de luttes, de proscriptions réciproques entre nicéens, ariens, donatistes, nestoriens, monophysistes, ce qui fait dire à Ammien Marcellin : « Les bêtes sauvages ne sont pas plus ennemies des hommes que les chrétiens ne le sont les uns des autres» , et à Sulpice Sévère : « Maintenant, tout est troublé par les discordes des évêques. Partout la haine et la faveur, la crainte, l’envie, l’ambition, la débauche, l’avarice, l’arrogance, la paresse: c’est la corruption générale ».
L’orthodoxie ne triompha qu’au prix d’une série de coups de force ; mais en triomphant elle perdit les vertus héroïques de l’Eglise militante. L’adhésion aux dogmes prima la pratique de la fraternité, de la charité, du pardon, de la compassion qui avait fait la force conquérante des églises des trois premiers siècles. Le symbole d’Athanase stipule : « Quiconque veut être sauvé doit, avant tout, tenir la foi catholique : celui qui ne la garde pas entière et pure ira, sans aucun doute, à sa perte éternelles. La dogmatique l’emporte sur la pastorale.
Si Jésus fût revenu à la fin du IVème siècle, il eût été stupéfait de voir l’usage que l’on faisait de son nom. Croyant que la fin du monde allait venir « avant que cette génération ne passe », il ne songea jamais à fonder une Eglise. Il était hostile à l’establishment de son temps : aux scribes, aux pharisiens, aux sadducéens, à ce « renard » d’Hérode, au Sanhédrin. Si l’on peut saisir sa pensée au travers des travestissements des évangélistes, ses paroles à la Samaritaine semblent la résumer : « L’heure vient – et nous y sommes – où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérités. » Le Tu es Petrus est une interpolation évidente qui consacre une injustice, en substituant Pierre à Paul comme premier apôtre des Gentils. Le chef de la primitive Eglise de Jérusalem n’est pas Pierre, mais « Jacques, le frère du Seigneur ». Tous les évêques de la communauté de Jérusalem se recrutèrent parmi les membres de la famille de Jésus, ce que Stauffer a appelé le « Khalifata » chrétien, par analogie à ce qui se passa pour Mahomet.
L’Evangile n’est pas l’Eglise. L’Evangile annonce l’imminence du Royaume de Dieu, définit une morale d’attente qui ne se soucie du lendemain, prêche le détachement des biens du monde et ne sera praticable que dans la solitude des déserts ou à l’ombre des cloîtres où l’on pourra pratiquer, loin du tumulte du monde, l’imitation de Jésus-Christ. L’Eglise vit dans le temporel. Elle a besoin d’alliés puissants. Elle cherche à se concilier les maîtres du jour. Elle professe que « tout pouvoir vient de Dieu » et, par suite, que « celui qui résiste à l’autorité se rebelle contre l’ordre établi par Dieu ». De même, « chacun doit demeurer dans la condition où l’a trouvé l’appel de Dieu ». L’Evangile est virtuellement révolutionnaire et inspira tous les grands mouvements populaires au Moyen Age. L’Eglise est intrinsèquement conservatrice et professe un conformisme politique et social. Le christianisme n’arrivera jamais à éliminer la contradiction qui maintient en son sein une perpétuelle équivoque. Il y aura toujours l’Eglise triomphaliste et l’Eglise des pauvres, l’Eglise dogmatique et l’Eglise pastorale.

Quelles furent les raisons profondes de l’antagonisme de l’Empire romain et du christianisme ? Elles furent primordialement d’ordre politique. Les Romains reconnaissent à chaque peuple le droit d’adorer ses propres dieux : à ce titre, le judaïsme était reconnu comme religio licita. Mais les chrétiens ne formaient pas une ethnie : « On ne naît pas chrétien, on le devient » et leur prétention d’être le verus Israël ne fut pas reconnue. Aux différentes religions s’était superposé, sous le Principat, en vue d’unifier les peuples divers de l’oikouméné, le culte impérial adressé au génie de l’empereur, communément désigné dans la terminologie officielle du nom de Kyrios, Dominus, Seigneur, et, dans les provinces grecques, du nom de Sôter, Sauveur. Or, le terme de Kyrios désigne dans la Bible grecque (la Septante) lahvé et, dans les Actes, Jésus ressuscité, proclamé Kyrios et Söter..
Le culte impérial était l’équivalent du serment civique, du salut au drapeau. Mais jurer par le génie de l’empereur, brûler un grain d’encens devant sa statue équivalait pour un chrétien à apostasier : comment aurait-il pu conférer à César les titulatures qui ne revenaient qu’à Dieu et à son Christ ! Le culte impérial était obligatoire pour les fonctionnaires, les soldats, les témoins en justice. Le refus du serment civique rendait les chrétiens inaptes à tous les offices publics, civils, et militaires, et les mettait hors du droit commun en justice. Les chrétiens, déclare Origène, n’ont que faire des emplois publics, des magistratures municipales, « sachant que, dans chaque ville, il existe une autre organisation de patrie fondée sur le Verbe de Dieu ».
C’est assez dire que les chrétiens constituaient un Etat dans l’Etat. Par leur refus des fonctions publiques, ils fomentaient une immense grève perlée dans tout l’Empire, au moment même où la pression des Barbares sur les frontières nécessitait la mobilisation de toutes les énergies. C’est bien ce que leur reproche Celse : « Si tous vous imitaient, rien n’empêcherait que l’empereur demeurât seul et abandonné et que le monde devint la proie des Barbares les plus sauvages… Soutenez l’empereur de toutes vos forces, partagez avec lui la défense du droit ; combattez pour lui si les circonstances l’exigent ; aidez-le dans le commandement de ses armées. Pour cela, cessez de vous dérober aux devoirs civils et au service militaire ; prenez votre part des fonctions publiques, s’il le faut, pour le salut des lois et la cause de la piété ». (…)
À partir du IIIème siècle, ce sont les plus grands empereurs qui se font persécuteurs et ils ne le deviennent que dans les dernières années de leur règne, comme s’ils rencontraient un obstacle irréductible dont il fallait triompher si l’on devait survivre. Au IVème siècle, devant l’échec de leur tentative, ils n’eurent plus d’autre solution que de se convertir.
Les chrétiens apparaissent aux païens comme une société fermée, jalousement repliée sur elle-même. Leur refus de participer aux fêtes publiques les fait accuser de misanthropie. Ils sont en marge de la vie commune. L’épitre à Diognète formule très bien ce détachement, qui prend l’allure d’une scission : « Les chrétiens ont chacun une patrie mais ils y sont comme des voyageurs ; toute terre étrangère leur est patrie, toute patrie leur est étrangère. Ils habitent sur terre ; mais, en réalité, leur vraie patrie est le ciel ».
On peut se demander, dès lors, pourquoi le christianisme étend son audience, s’infiltre partout dans le tissu social jusque dans la cour des Césars ; comment finalement parvient-il à faire basculer la majorité en sa faveur ?
Pour le comprendre, il faut se souvenir des vers de Lucain : « L’humanité vit pour un petit nombre ». La civilisation gréco-romaine est essentiellement aristocratique. Elle repose sur l’inégalité d’origine des familles humaines, certaines prétendant des cendre des dieux et des héros, d’où pour les uns le droit à commander, pour les autres le devoir d’obéir. En proclamant que tous les hommes proviennent du même couple originel, que tous peuvent être sauvés par les mérites du sacrifice salutaire de Jésus, en réhabilitant le travail manuel, en donnant aux esclaves la dignité et la liberté des enfants de Dieu, le christianisme introduit une formidable révolution. Quel émerveillement pour l’esclave que l’exemple d’un Dieu qui a pris volontairement la condition de doulos, la condition servile, pour le sauver. Comment les déshérités du monde antique, qui deviennent de plus en plus nombreux à mesure que la situation se détériore, n’auraient-ils pas été subjugués par une religion qui leur garantissait que tous les torts seraient réparés à leur avantage dans une autre vie et dont les témoins prouvaient l’invincibilité de leur foi en la professant jusqu’au martyre ? Le paganisme avait élaboré d’admirables philosophies, mais qui ne s’adressaient qu’à une élite et qui mettaient le salut dans la connaissance. À la sagesse de ce monde, qui s’adressait à la raison, le christianisme substituait la folie de l’amour divin qui engageait toute la sensibilité jusqu’à l’extase.
Tant que l’Empire fut prospère et fit régner la paix romaine, la grande masse des païens demeura fidèle au mos majorum. Mais qu’adviennent l’anarchie et la guerre civile, la destruction des élites, l’agression des Barbares et des Perses qui assiègent et investissent l’Empire, les famines et les pestes qui ravagent les cités, la fiscalité qui écrase les provinces, les masses se tournèrent vers ceux qui leur enseignaient que ces maux sont insignifiants comparés aux félicités de la vie éternelle. Les nombreuses institutions d’assistance et de bienfaisance que les Eglises avaient fondées, alimentées par les donations des riches de leur vivant ou à leur mort, contribuèrent pour beaucoup au triomphe du christianisme. Dans sa lettre au grand prêtre Arsace, l’empereur Julien en fait l’aveu: « Ce qui a le plus contribué à développer l’athéisme (par quoi il faut entendre le christianisme) c’est l’humanité envers les étrangers… Voilà de quoi nous devons nous occuper… Il serait honteux, quand les Juifs n’ont pas de mendiants, quand les impies Galiléens, en plus des leurs, nourrissent les nôtres, qu’on voie les nôtres manquer des secours que nous leur devons ».
La philanthropie active des chrétiens éclipsa la misanthropie passive dont on les accusait. Au milieu de la tourmente du IIIème et du IVème siècle, l’Eglise apparut comme un port de salut, un havre de grâce. La Cité de Dieu sauva du désespoir la cité humaine.
Le triomphe du christianisme fut favorisé par le déclin de l’esprit critique faisant place à la superstition. Les Romains subordonnaient les joies de la connaissance aux vertus actives de l’action. L’enseignement des mathématiques, c’est-à-dire l’art de raisonner, qui fit la gloire des Grecs, était chez eux rudimentaire. « Quant à nous, écrit Cicéron, nous avons borné l’usage de cette discipline aux mesures et aux applications pratiques. Nous avons, par contre, aspiré de bonne heure à être des orateurs ».
Lorsque le jeune Romain a épuisé les leçons du grammaticus, il va à l’école du rhéteur qui lui enseigne l’éloquence. À ce régime, l’esprit scientifique qui s’était épanoui pendant la période hellénistique, décline à Rome et s’atrophie. Au IIIème et au IVème siècle, il fait place aux préoccupations religieuses qu’alimentent les religions de salut venues d’Orient : culte phrygien de Cybèle et d’Attis, culte égyptien d’Isis et de Sérapis, culte syrien d’Adonis, culte persan de Mithra. La dernière grande école philosophique, l’Ecole néo-platonicienne, fait place chez Porphyre, chez Jamblique, à des divagations mystiques qui font régresser l’esprit à l’âge de la magie et de la théurgie. Proclus, hiérophante de toutes les divinités de la Grèce et de l’Orient, professe pour les oracles une foi exclusive: « Si j’en avais le pouvoir, j’anéantirais tous les livres pour n’en conserver que deux : les Oracles des Chaldéens et le Timée de Platon ». Les pseudo-sciences, l’astrologie, la mantique, l’alchimie, les mirabilia font florès.
Un ouvrage dont on ne connaît pas l’auteur, l’Ambrosiater, nous donne un tableau vers 375 des cérémonies païennes qui se déroulaient encore à Rome. On y célébrait dans un déploiement orgiaque les Bacchanales. La statue cynocéphale d’Anubis était promenée dans les processions isiaques. Dans des cryptes obscures, les sectateurs de Mithra faisaient subir d’étranges épreuves aux initiés. Les Galbes, vêtus de robes de femmes, sacrifiaient à Cybele, la Grande Mère, leur virilité. Les mystères des dieux orientaux avaient pris la place dans les dévotions des Romains des anciens dieux nationaux. En l’an 376, le sénateur Ulpius Egnatius Faventinus « père et héraut sacré du dieu soleil, invincible Mithra, chef des Bouviers de Bacchus, prêtre d’Isis », fit graver une dédicace à la Grande Mère et à Attis, après avoir reçu le baptême sanglant du taurobole. Superstitions pour superstitions, mystères pour mystères, liturgies pour liturgies, le christianisme avait tous les droits à s’imposer.
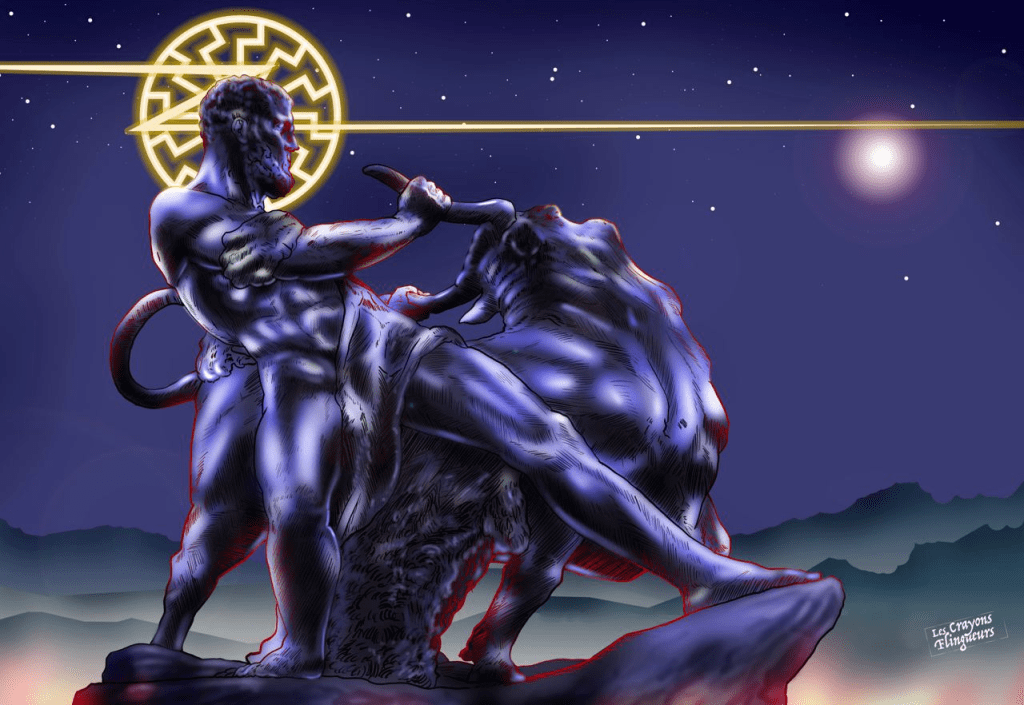
Il allait du reste s’imposer en se paganisant. Le culte impérial, dont le refus par les chrétiens avait fait couler le sang des martyrs, fut maintenu, à part les sacrifices interdits comme idolâtriques. Sous cette seule réserve, Constantin autorise qu’on lui élève des temples, qu’on célèbre des jeux en son honneur. Au lendemain de sa victoire sur Maxence, il accepte que le Sénat lui offre une statue, image de sa divinité, se contentant de placer une croix en sa main. Philostorge reproche aux chrétiens de Constantinople d’adorer la statue de Constantin, en lui offrant de l’encens, et de lui adresser des prières comme à un dieu. Le terme de sacré s’applique à tout ce qui touche à la personne de l’empereur, à ses actes, à ses édits, à son palais. Le rite de l’adoration que Dioclétien avait introduit dans l’étiquette de la cour impériale est conservé et minutieusement réglementé à la cour de Byzance. Le titre de Dominus, Dominus noster, que l’église militante avait voulu n’attribuer qu’à Dieu et au Christ, fut maintenu et renforcé par ceux de Divinitas et Aeternitas dans le protocole des empereurs. En dépit de leur vie souvent peu édifiante, la canonisation remplaça l’apothéose.
Bien qu’il se fût paganisé, le christianisme impose une civilisation originale fondée sur une nouvelle échelle des valeurs et sur de nouvelles motivations. Au souci de la Cité terrestre, il substitua l’obsession du salut personnel. Le monde n’est ici-bas qu’un lieu de passage, une hôtellerie de douleur, où l’homo viator se prépare par la pratique des sacrements et les bonnes œuvres à une mort édifiante. La passion du savoir est condamnée. Saint Paul déclare : « La science enfle et la charité édifie ». Parlant des recherches des astronomes, saint Basile les condamne : « L’ampleur même de leur sagesse profane requerra contre eux une condamnation plus lourde; doués, en effet, d’une vue si pénétrante pour des vanités, ils sont devenus volontairement aveugles lorsqu’il s’agit de comprendre la vérités. » Bossuet reprendra la même antienne : « Mortels misérables et audacieux, nous mesurons le cours des astres et après tant de recherches laborieuses, nous sommes étrangers à nous-mêmes ». L’Ecriture tient lieu de savoir.
Pour aller plus loin :