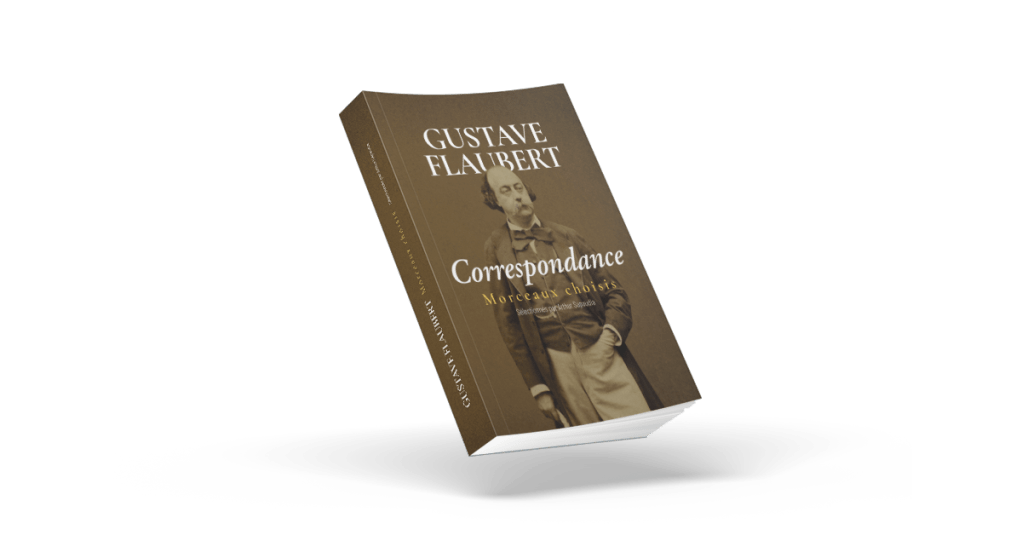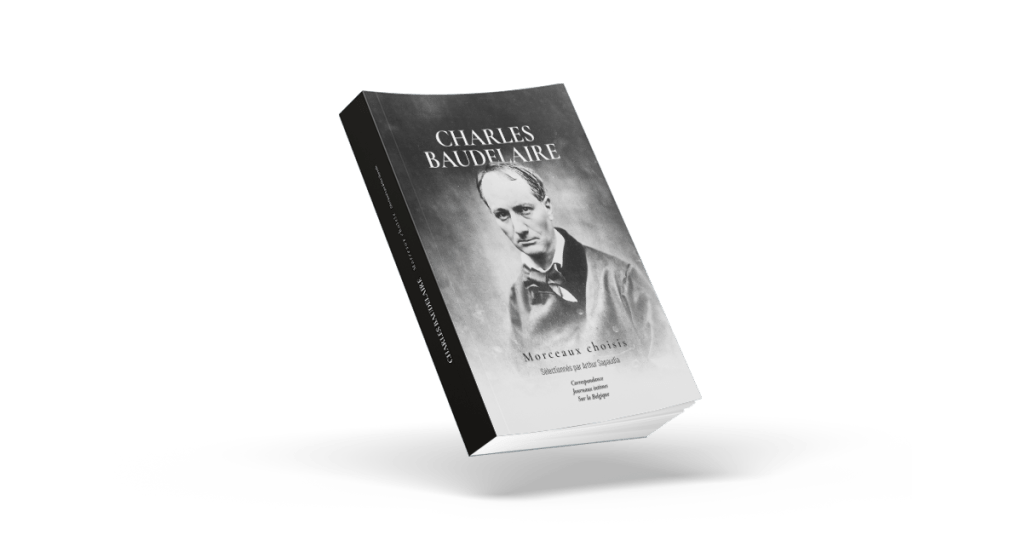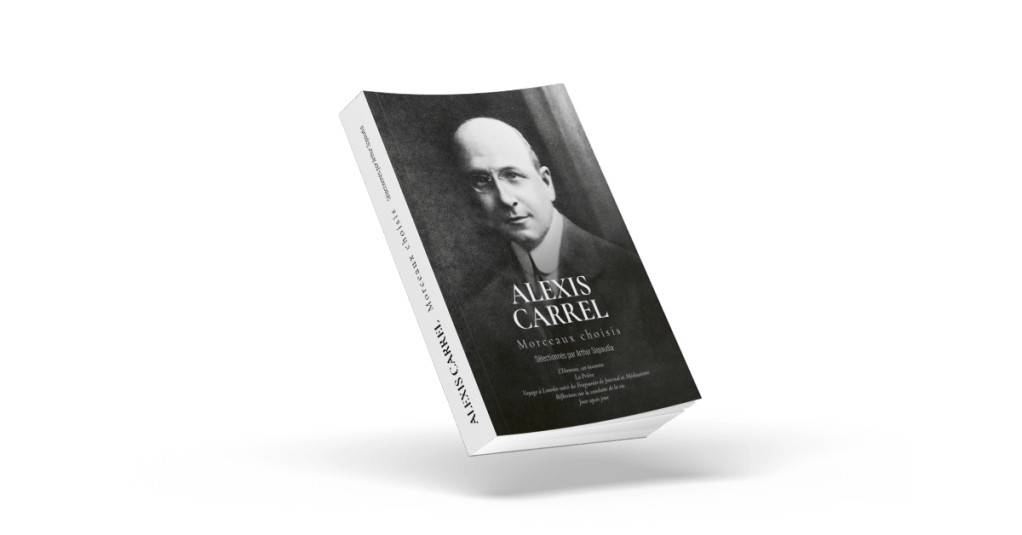Extrait du Cahier de l’Herne n°3, 1963
Années 1930 à 1945… Ce qui en restera, ce qui, alors, est la France, écrit hors de France ; cela nous vient du Danemark, du Brésil… Voilà un fait capital, qui mérite commentaire. Descartes, Voltaire, nous avaient réexpédié de Hollande ou de Suisse notre plus nourrissante pensée. De Claudel à Saint John Perse, ce qui fit l’autorité de la France nous vient d’outre-frontières. Notre pays égare ses enfants méritants ; y a-t-il à cela des raisons profondes ?
Céline, Bernanos. Deux prophètes, deux généreux, deux virils, deux solitaires, deux marqués, deux admirables invectifs, doués de la seule éloquence supportable, parce que, derrière les mots, le cœur ; s’il y a trop de mots, c’est qu’il y a trop de cœur.
Se durcissant par la vie, ridés, recousus, balafrés, les poches sous les yeux de Bernanos, le nez rougi de Céline, nous bouleversent, sur toutes leurs images ; nez brûlé par le froid, maculé de boue, quand Céline descendait de moto, à ma porte, dans l’hiver de 1941.
Si l’admiration se partage entre eux, la raison est forcée d’obéir à Céline. Tout a servi l’intransigeant Bernanos, de son vivant et après sa mort: les idéologies, la politique, la famille, les Bénédictins, les Dominicains, et ces puissants brise-lames : le dogme, le salut, la grâce. Ce solitaire ne sera jamais seul ; son plus noir pessimisme restera un désespoir habité. Ses zigzags, ses ruptures, ses replis, lui en sont facilités ; il pourra dénoncer tour à tour les perd-la-Victoire de 1918, Maurras, Drumont, récuser à la fois Franco et Claudel, se séparer enfin de la Résistance « volée ». Lorsqu’il voudra, vers 1937, passer de droite à gauche, Sept et les Dominicains lui offriront une passerelle (ne lui faisons pas l’injure de voir en lui un de ces prudents abbés Menou-Segrais, mais enfin la passerelle fut sous ses pieds et il a passé dessus, c’est un fait.)
Céline, lui, fut toujours seul ; ce n’est pas un médiéval qui a la nostalgie du XIIe siècle, c’est un homme moderne, dans la solitude des foules, puis des guerres, puis des migrations. Il n’a pas d’ancêtres, ne se réclame ni de Bloy, ni de Péguy, ni de Drumont. Il n’a pas d’amis, sur terre ni au ciel. Ce n’est qu’un médecin de quartier, et pas le quartier du paradis. Il ne possède que sa femme et son chat ; il n’a jamais eu à renier de parti, n’en ayant pas ; ni de maître, étant son maître. Son confesseur, c’est le lecteur. Il est l’homme parfaitement libre.
Un homme libre, cela se reconnaît à ce qu’il finit au cachot.
Sa vie fut un don continuel, plus total que toutes les vies du Curé de campagne, de l’abbé Donissan ou de sainte Chantal ; sans l’espoir d’être jamais cru, ou remercié que par des jets de pierres, par des menaces de mort. Le monde a le feu dans les soutes et va probablement sauter. Bernanos l’a dit, mais Céline l’a vécu, l’a hurlé, comme une bête blessée qui va mourir dans la neige de son exil. Que l’exil à gauche est doux, auprès du sien ; de Calvin à Genève, de Hugo à Guernesey, avec mains tendues et bras ouverts ; aucune université américaine pour offrir une chaire à Céline.
Le voici dans le silence posthume ; après l’autre, il ne suce pas ce sein rebondi qu’est la coupole du Panthéon ; c’est un pauvre chien d’aveugle qui s’est fait écraser, tout seul, pour sauver son maître infirme, cette France qui continue à tâter le bord du trottoir.
Lisez nos grands français !