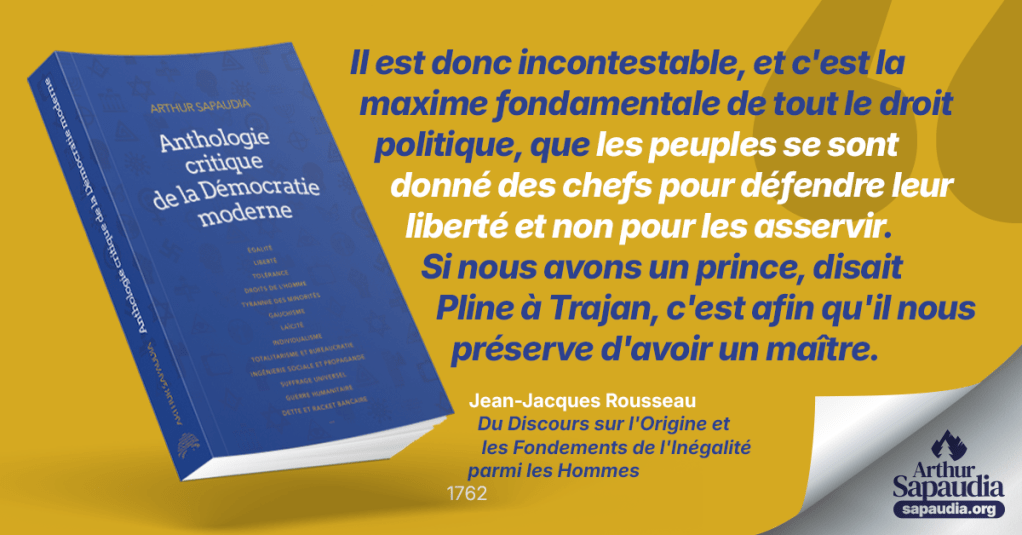Extrait de Pierre Gripari, Monoméron ou Je ne sais quantième consultation du Docteur-Noir sur la vraie religion du peuple français, 1990
— Un autre philosophe… Me faudra-t-il aussi deviner lequel ?
— Non, non, rassurez-vous, je vais vous le dire tout de suite. Il s’agit de Jean-Jacques Rousseau, dont nous avons déjà parlé d’ailleurs. Seulement son génie, à lui, ne figure pas parmi mes pensionnaires…
— Il n’est donc pas malade, celui-là ?
— Non, il se porte fort bien, et sa pensée, bien qu’elle soit très discutée, n’en est pas moins vivace. Songez que notre Jean-Jacques a inspiré successivement Robespierre, Napoléon, Jean-Paul Richter, Tolstoï, Lénine, Mussolini, le maréchal Pétain…
— Mais, dites-moi, c’est très mélangé, tout ça…
— Oh ! Oui ! Sans compter Schopenhauer, le scoutisme, Louis-Ferdinand Céline, les écologistes…
— Les écologistes aussi ?
— Eux surtout. Il n’y a rien de plus réactionnaire que l’écologie. Bref, c’est un petit génie qui est fort occupé.
— Mais alors, comment ferons-nous… ?
— Nous nous passerons de sa présence. Attendu que notre cher Alfred de Vigny avait l’intention de m’en faire parler dans ma deuxième consultation, j’ai lu attentivement toute l’œuvre du grand Genevois et je peux vous en faire connaître au moins certains aspects. J’espère ne pas vous ennuyer, bien que vous partagiez le préjugé commun…
— N’en tenez aucun compte, docteur ! Ce ne serait là pas la première fois que je reviendrai sur un jugement hâtif, et je ne demande pas mieux que de faire des découvertes !
— Allons-y donc. La carrière de Rousseau commence par un texte assez court, mais bien révélateur, qui est son Discours sur les sciences et les arts. À la question posée par l’académie de Dijon, qui était de savoir si le rétablissement des sciences et des arts (depuis la Renaissance) avait contribué à épurer les mœurs, Jean-Jacques répond tranquillement, avec une belle audace, que certainement, comme tout le monde, il aimerait mieux dire oui, mais qu’en fin de compte, c’est non. Les progrès évidents de la civilisation, des connaissances, des techniques, des belles-lettres et de tout ce qui s’ensuit n’ont réussi qu’à rendre l’homme, non pas pire (car sa nature n’a pas changé), mais plus faux, plus futile, plus hypocrite, plus perfide, plus vain, plus veule, plus lâche, plus vicieux, plus férocement égoïste, plus perversement compliqué, plus sordidement cupide, plus froidement retors, plus déséquilibré, plus angoissé, plus malheureux d’être au monde… bref, complètement pourri !
— Rien que ça !
— Quand vous lirez le texte, vous serez convaincu. Il y dénonce déjà les maux que nous connaissons bien : avilissement et commercialisation de la littérature, démocratisation et donc baisse du niveau de l’enseignement, mépris des professions utiles, promotion des médiocres. Encore ne prévoyait-il pas le massacre de l’environnement, l’empoisonnement des océans et de l’atmosphère terrestre… Mais, sans aller chercher si loin, nous avons vu, sous nos yeux, la civilisation des loisirs déboucher sur les formes les plus agressives de la stupidité : vandalisme, ennui, drogue, violence, avidité primaire, suicide motorisé… L’homme est devenu le roi de la planète, mais en même temps, il est devenu ingouvernable.
— Ce que vous dites est assez effrayant.
— Et cela ne fait que commencer ! Dès son premier ouvrage donc, alors qu’il est encore l’ami de Diderot, notre auteur prend carrément le contrepied de la Philosophie des Lumières : il refuse l’optimisme béat, la croyance au progrès. L’avenir et les idées nouvelles ne lui inspirent que méfiance. Quand on lit ce discours, on éprouve la même impression que quand on lit le Semmelweiss de notre immense Louis-Ferdinand Céline : une telle œuvre est une prophétie sur son auteur lui-même : en l’écrivant, il a déjà scellé son destin.
— Bien sûr, mais n’est-ce pas un peu sa faute ? Il y a dans sa doctrine des erreurs flagrantes. L’homme sauvage, par exemple…
— Ce n’est pas l’homme sauvage qu’on lui a reproché : tout le monde croyait comme lui. Bien entendu, c’était une erreur : nous savons aujourd’hui que l’homme primitif n’était pas plus libre que nous-mêmes : il a toujours été un animal social, avec une organisation tribale, une hiérarchie, des tabous, un mâle dominant… Une autre erreur qu’il partage avec ses contemporains, c’est de considérer le peuple comme un tout, et de ne considérer ce que nous appelons la lutte des classes que comme une exception, alors qu’elle est évidemment la règle, puisqu’elle résulte directement de la division du travail. Ces deux erreurs rendent caduques bien des pages du Discours sur l’inégalité et du Contrat social. Seulement ce n’est pas tout ! Revenez-y, à ce Contrat social, et je vous garantis que vous aurez des surprises !
— J’ai commencé, un jour, à le lire, mais ça m’a ennuyé…
— Eh bien vous avez eu tort ! Au livre II, chapitre 5, il parle de la peine de mort (il est pour, comme de juste), et il dit là-dessus des choses définitives ! Au livre II toujours, mais au chapitre 8, il nie formellement qu’il puisse exister une forme de gouvernement qui convienne à tous les peuples. Il va jusqu’à dire que les peuples vieillissent, que ceux-là même qui ont assez de civisme pour mériter la démocratie finissent par perdre peu à peu leur conscience politique et ne peuvent bientôt plus être menés qu’au bâton ! Suivent quelques lignes sur la Russie, d’une lucidité surprenante…
— Tiens ! Qu’est-ce qu’il en dit ?
— Tout simplement que la Russie tentera de bouffer l’Europe, qu’elle n’y réussira pas, et qu’elle sera bouffée par les Turcs d’Asie centrale, qui nous boufferont peut-être aussi !
— À la bonne heure !
— Passons maintenant au chapitre 4 du livre III : De la démocratie. Cette forme de gouvernement, nous dit l’auteur, n’est possible que dans de petits États, où les citoyens se connaissent les uns les autres, et suppose à la fois la vertu civique, la simplicité des mœurs, l’absence de grandes fortunes et le dédain du luxe. C’est le régime le plus fragile qui soit et, une fois détérioré, il ne peut plus se rétablir.
— Il y a pourtant eu quatre Républiques françaises…
— Non. La première était une dictature policière et une voyoucratie, la deuxième a échoué de façon minable… C’est seulement au bout d’un siècle, après trois rois et deux empereurs, que la Troisième République, peut-être parce qu’elle a commencé par l’écrasement de la Commune, a pu durer soixante-dix ans, qui furent d’ailleurs soixante-dix ans de scandales : en 1939 le régime était moribond. La Quatrième, plus lamentable encore, n’a été qu’un ballon d’oxygène pour le parlementarisme agonisant — supposer que vous croyez à la Cinquième ? et je ne vous ferai pas l’injure de…
— Non, vous avez raison. Depuis 1958, la France est redevenue une monarchie constitutionnelle.
— Nous sommes donc bien d’accord : on ne fait pas une république avec des réformes démocratiques, mais avec une bourgeoisie forte, nationaliste, vertueuse, pour ne pas dire un peu bigote… Même alors le régime ne peut vivre qu’en trichant continuellement avec ses propres principes. Montesquieu, qui préconisait la séparation des trois pouvoirs : le législatif, l’exécutif et le judiciaire, oubliait seulement le pouvoir financier et le pouvoir culturel, c’est-à-dire l’argent et la presse (aujourd’hui les media de masse). Il serait pourtant sacrément urgent de séparer ces deux pouvoirs des autres, et surtout, avant tout, de les séparer l’un de l’autre ! Est-ce possible, seulement ?
— Bien sûr que non ! L’argent domine tout ! En France, il n’y a que deux grandes familles spirituelles, qui ne sont pas, comme on l’a cru, la droite et la gauche, mais qui sont simplement celle des gens à voitures et celle des gens qui utilisent les transports en commun. Entre les deux existe une cloison étanche, infranchissable, hermétique ! Le pouvoir financier, quand il cède, ne cède qu’à la bureaucratie, qui est encore pire ! Mais revenons à Jean-Jacques, et à la religion, cette fois, qui est, ne l’oublions pas, notre sujet principal.
— Ah oui ! La religion !
— Il en parle au chapitre 8 du livre IV, où il distingue trois sortes de religions établies. En premier lieu, celle qu’il appelle la religion de l’homme, ou le christianisme évangélique. C’est à peu de chose près celle du vicaire savoyard de l’ Émile. Bien que cette religion soit la sienne, notre philosophe reconnaît qu’elle n’est pas désirable pour un État soucieux de conserver son indépendance et ses libertés, car elle fait de mauvais guerriers, si elle fait de bons citoyens. Or il faut tenir compte des ennemis à l’extérieur, des ambitieux et des factions à l’intérieur… En d’autres termes un peuple de vrais chrétiens serait vite colonisé, ou ne tarderait pas à tomber sous la coupe d’un dictateur ! Vient ensuite la religion d’État, avec une divinité nationale et un gouvernement théocratique. Celle-là, politiquement parlant, se défend beaucoup mieux. Malheureusement elle est fausse, entachée de formalisme, de superstition, et dangereusement encline à se transformer en tyrannie, à entretenir un état de guerre perpétuel… Vient enfin la troisième formule, qui est la pire de toutes : celle de la séparation de l’Église et de l’État, de la guerre éternelle entre le pouvoir spirituel et le pouvoir politique : c’est le Pape et l’Empereur, c’est la monarchie catholique… Ici encore vous voyez que cette pensée échappe à toute classification.
— Mais enfin… à quoi conclut-il ?
— Il ne conclut à rien, car il refuse l’athéisme, aussi bien que le dogme paulinien. Il recommande simplement la tolérance. Il use à ce propos d’une très jolie formule :
« Il est impossible, dit-il, de vivre en paix avec des gens qu’on croit damnés ».
— C’est joli, en effet.
— C’est même profond, et juste. Mais, définie de cette façon, la tolérance n’est qu’un affaiblissement du sentiment religieux. Il reviendra sur ce sujet dans un délicat passage des Confessions où il parle des idées religieuses de sa tutrice, qui fut aussi sa maîtresse, Mme de Warens. Contrairement aux calvinistes, qui nient le Purgatoire mais croient à l’Enfer, cette brave dame refusait l’Enfer, comme trop dur et injuste. Mais elle tenait tout de même au Purgatoire, car elle trouvait choquant que les méchants allassent tout de suite au ciel. Et Rousseau de conclure :
« Il faut avouer que les méchants sont bien embarrassants ».
— Mais c’est très drôle, ça !
— Qu’est-ce que vous croyez ! Notre homme est parfaitement capable d’être drôle, quand il veut… Bref, j’en ai assez dit, je pense, pour vous faire comprendre que ses pires ennemis, au bout de quelques années, n’étaient pas les conservateurs, mais le parti progressiste, celui de l’Encyclopédie, ce qu’il appelle lui-même « la coterie holbachique ». Je ne nie certes pas le talent de journaliste d’un Voltaire, l’intelligence mathématique d’un Alembert, les éclairs de génie d’un Diderot… Tous ces gens-là, cependant, faisaient partie d’un petit clan mondain, féminin, salonnard, bien parisien, spirituellement sectaire, ingénieusement arriviste, astucieusement combinard et fricard, bref, parfaitement odieux… Ils n’ont guère changé depuis, car ceux d’aujourd’hui sont pareils : même culte de l’idée reçue, même vénération de la formule toute faite, même servilité devant l’intellectuel-flic de service, même goût de l’exclusion, de la discrimination idéologique, de la censure qui ne dit pas son nom… Cette racaille distinguée, proprette, spirituelle, perfide, s’est littéralement acharnée sur Jean-Jacques Rousseau, l’a snobé jusqu’au sang, et pour finir l’a rendu fou.
— Tout de même, est-ce qu’il n’était pas disposé… ?
— Il avait, comme bien d’autres, une disposition à la paranoïa. Il était donc facile de le rendre paranoïaque. Il suffisait, pour cela, d’entretenir autour de lui un climat d’hostilité, de petite guerre, de commérages, de menues perfidies, de menaces voilées. Lui, dans ces conditions, a fait ce qu’on fait toujours en pareil cas : il a voulu se défendre, s’expliquer, se justifier, puis contre-attaquer… Il a, bien entendu, accumulé gaffes sur gaffes, pour aboutir enfin à ce texte navrant, mais génial, qui s’intitule Rousseau juge de Jean-Jacques. C’est peut-être la plus belle description littéraire de la paranoïa, vue de l’intérieur, si l’on met à part, toutefois, Un démon de petite envergure de Sologoub, un admirable roman russe… Et même là, en plein délire de persécution, en pleine frénésie d’auto-justification, même là notre homme ne triche pas, il ne triche jamais ! Je vous le dis, c’est un type merveilleux, magnifique !
— À vous entendre, docteur, j’ai envie de le penser comme vous !
— Croyez-moi ou plutôt non, ne me croyez pas, lisez-le ! Jean-Jacques Rousseau est un exemple, une conscience de penseur et d’écrivain, lucide, sans concession, d’une intégrité absolue. Il va jusqu’au bout de lui-même, c’est un modèle et un avertissement pour tout écrivain de vocation ! Celui qui n’est pas prêt à marcher sur ses traces, quitte à en payer le prix, celui-là n’est pas digne d’écrire : qu’il choisisse tout de suite un autre métier !