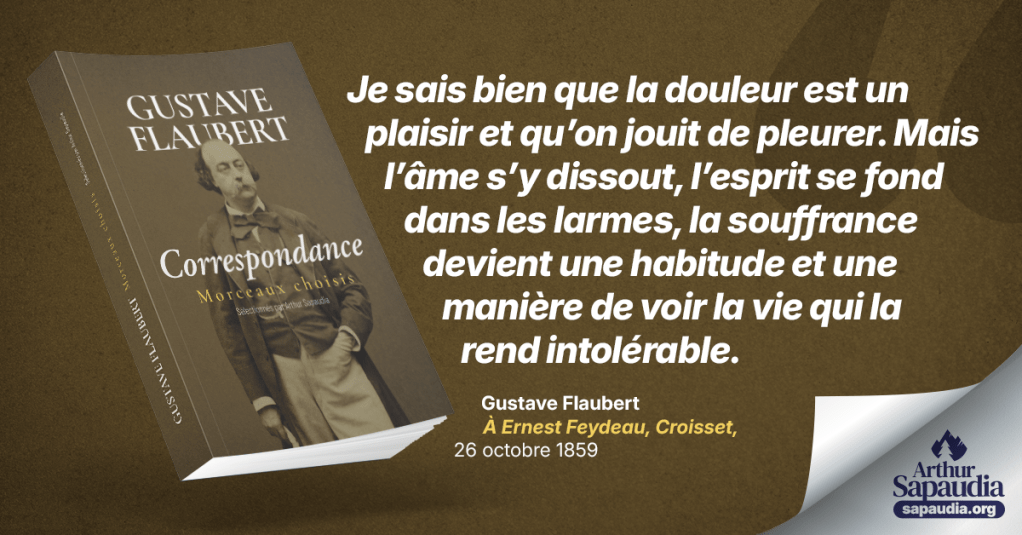Extrait tiré du livre de Louis Rougier, Du paradis à l’utopie, 1979
Agrégé de philosophie en 1915, Louis Rougier est professeur aux lycées de Gap, du Puy-en-Velay, d’Aix-en-Provence. Il enseigne la philosophie et les mathématiques au lycée d’Alger à partir de 1917 ; en 1920, il publie sa thèse de doctorat sous le titre La philosophie géométrique de Poincaré. Il y joint une thèse complémentaire, Les paralogismes du rationalisme. (…) Au milieu des années 1920, il dirige une collection, « Civilisation et Christianisme », chez André Delpeuch. (…) Spécialiste de philosophie des sciences et de logique, marqué par la pensée de Henri Poincaré auquel il consacre sa thèse, Rougier participe en 1934 au Cercle de Vienne, dont il est le seul membre français, avant d’organiser à la Sorbonne, en 1935, le premier Congrès international de philosophie scientifique, où figurent notamment Rudolf Carnap, Bertrand Russell, Alfred Tarski, Moritz Schlick. (…) Rougier et tout particulièrement sa critique du christianisme vont influencer profondément la Droite radicale française. Dès 1963, ses travaux sont cités comme des références incontournables par les rénovateurs du nationalisme d’Europe-Action.
Personne n’a mieux décrit l’angoisse existentielle de l’homme que Pascal :
Je ne sais qui m’a mis au monde, ni ce que c’est que le monde, ni que moi-même ; je suis dans une ignorance terrible de toutes choses… Je vois ces effrayants espaces de l’univers qui m’enferment et je me trouve attaché à un coin de cette vaste étendue, sans que je sache pourquoi je suis plutôt placé en ce lieu qu’en un autre, ni pourquoi ce peu de temps qui m’est donné à vivre m’est assigné à ce point plutôt qu’à un autre de toute l’éternité qui m’a précédé et de toute celle qui me suit… Tout ce que je connais est que je dois bientôt mourir, mais ce que j’ignore le plus est cette mort même que je ne saurais éviter.
Nous sommes éjectés sur une petite planète d’un quelconque système solaire égaré parmi d’innombrables galaxies, sans l’avoir demandé. Nous ne choisissons ni notre patrimoine héréditaire, ni notre sexe, ni nos parents, ni la nationalité à laquelle on nous inscrit, ni l’époque à laquelle nous allons vivre. L’étude de jumeaux issus du même œuf semble prouver que nous sommes génétiquement conditionnés à 80 %. Les circonstances extérieures qui vont favoriser ou inhiber nos potentialités ne dépendent en majeure partie pas de nous. Pascal conclut :
En voyant l’aveuglement et la misère de l’homme, en regardant tout l’univers muet et l’homme sans lumière, abandonné à lui-même et comme égaré dans ce recoin de l’univers, j’admire comment on n’entre pas en désespoir d’un si minable état.
Cette désespérance qui inspire la condition humaine s’exprime dans les plus anciennes littératures en Egypte, dans le Dialogue d’un homme avec son âme, dans le Chant du harpiste, dans la sagesse désabusée de Ipuwer à la fin de l’Ancien Empire, allant jusqu’à souhaiter : « Puisse venir le jour où l’humanité cessera d’exister ; où on n’engendrera plus d’enfants ; où tout bruit cessera sur la terre et où il n’y aura plus à lutter » ; en Babylonie, dans la Plainte du Juste souffrant chez les Hébreux, dans Job et l’Ecclésiaste qui proclame : « Vanité des vanités, tout est vanité ». Chez les Grecs, Théognis, Solon, Pindare et Sophocle proclament que le meilleur sort pour l’homme serait de ne pas naître, ou, une fois né, de mourir le plus tôt possible. Chez les Romains, Lucrèce dit la solitude de l’homme dans un monde infini : « jeté sur une terre nue pour gémir et pleurer ». « Le seul bien qu’offre la vie, c’est la mort », écrit Pline l’Ancien. Sénèque n’est guère plus réjouissant dans sa Lettre à Marcia. Les chrétiens mêmes ne font pas exception : Arnobe déclare : « L’homme peut-il savoir ce qu’il est, d’où il vient, créature bizarre, variée, complexe et ondoyante ? ».
Les Modernes n’échappent pas à cette déréliction. Shakespeare décrit la vie comme « une histoire de fou, pleine de tumulte et de fureur, qui n’a aucun sens ». Schopenhauer s’inspire du pessimisme des religions hindoues : « Toute l’existence humaine implique la souffrance comme sa vraie destination… l’humanité est l’unique stade auquel la volonté soit capable de se renier et de se détourner de la vie… » .
Avec le romantisme, après Chateaubriand, Byron et Léopardi, le sombre poète de l’infélicité et de la mort, Heine et Lenau chantent la Weltschmerz, la douleur du monde. La philosophie de l’absurde, avec Sartre et Camus, le théâtre de l’absurde avec Beckett et Ionesco inspirent nos contemporains. Mais c’est Heidegger qui formule le vrai problème : « Pourquoi y a-t-il un Etant plutôt que rien du tout ? Est-il concevable d’être sans raison d’être ? »
Cette interrogation sur le sens de la vie est à la fois le tourment et la noblesse de l’homme. Si l’homme en était réduit à son paléocortex, issu des reptiliens et des mammifères inférieurs, il obéirait sans complexes aux pulsions de la faim, de l’amour, de la défense du territoire, de l’agressivité et de la peur. La recherche du pourquoi des choses est le résultat de la pensée conceptuelle qu’a rendu possible la formation du néocortex. L’Homo sapiens est conscient de la finalité qu’il donne à ses actions. Il envisage dans l’avenir plusieurs situations possibles et, à partir des expériences acquises et des moyens dont il dispose, il prend ses décisions en vertu d’un choix délibéré.
Par une extrapolation inévitable, il projette cette exigence de motivation à tous les phénomènes naturels, à la vie comme à l’univers, sans se poser la question préalable de savoir si cette exigence est justifiée. Le sempiternel « Pourquoi ? » des enfants semble prouver que ce besoin de compréhension et de justification est codé dans notre patrimoine héréditaire. Si nous vivions en harmonie parfaite avec notre milieu physique et social, nous ne poserions pas de questions. Nous estimerions que tout va de soi. Mais la vie est pavée d’accidents, de contraintes, de déceptions, de souffrances et la mort en est l’issue fatale. C’est à propos de la souffrance et de la mort, considérées comme révoltantes, que l’esprit humain requiert une explication. Telle est l’origine des religions.
Mettant en œuvre ce que Bergson a si judicieusement appelé la fonction fabulatrice de l’esprit, celle-ci sécrète ce qu’il faut de mythes explicatifs, de légendes salutaires, de croyances consolantes pour permettre aux plus malchanceux de supporter le fardeau de la vie ; à l’espèce humaine de poursuivre son immense labeur, de soutenir l’effort obscur qui l’amène à des émergences successives. La foi religieuse est la plus étonnante manifestation de l’instinct vital, sans laquelle l’existence d’un grand nombre ne serait que duperie ; sans laquelle ces miraculeuses réussites que sont les sociétés humaines seraient en perpétuelle contestation.
La métempsychose explique au paria de l’Inde qu’il aurait tort de se révolter, car, en toute justice, il expie dans la vie présente les crimes qu’il a commis dans ses existences antérieures et sa résignation présente est le gage de sa renaissance dans une caste supérieure. Platon, dans le mythe d’Er l’Arménien, explique comment chaque âme est responsable du sort qu’elle a librement choisi et comment, au prix d’une échelle ascendante de réincarnations successives, elle peut rectifier son choix initial et se libérer du tombeau qu’est le corps pour jouir d’une immortalité céleste bienheureuse en compagnie des dieux sidéraux.
Le péché originel dans la Genèse rend compte de l’hostilité de la nature et de la misère de l’homme voué à la concupiscence et à la mort, tandis que le sacrifice rédempteur de Jésus sur la croix le réconcilie avec son créateur, en garantissant aux croyants de ressusciter pour la vie éternelle. À ce titre les religions ont rendu un service incomparable à l’espèce humaine en lui procurant la force de subsister.
Engels, dans une page célèbre, a fait l’éloge de l’esclavage antique sans lequel les civilisations grecque et romaine n’existeraient pas. L’histoire des civilisations les plus avancées repose sur l’exploitation sans merci de masses sacrifiées. Humanum paucis vivit genus, le monde humain vit pour un petit nombre déclare Lucain dans La Pharsale. La religion est le refuge de la créature opprimée. Elle est « l’opium du peuple » selon l’expression de Karl Marx, sans lequel les sociétés humaines eussent été impossibles : elles eussent été en perpétuelles révolutions.
Toutefois, la religion console mais ne guérit pas l’homme de sa misère ici-bas. Le baiser aux lépreux fut un magnifique geste d’amour, mais la découverte des sulfones seule a permis de guérir « les plus déshérités du monde » et de les réinsérer dans la vie sociale. Saint François sanctifie la pauvreté, mais ne l’a pas abolie. Un petit nombre d’esprits tentèrent une autre voie que la foi religieuse, celle de la connaissance. Ils se sont efforcés d’améliorer la condition humaine en se rendant maîtres des phénomènes naturels par la connaissance de leurs lois. À mesure que l’homme, par l’observation et l’expérience, s’est rendu compte que les phénomènes qu’il attribuait à des esprits cachés s’expliquaient par des causes purement naturelles qu’il pouvait reproduire ou modifier à son gré, il a désacralisé la nature. Zeus a cessé de frapper les foules de terreur par son tonnerre et ses éclairs. Les nymphes ont déserté les sources, les dryades les forêts. L’arc-en-ciel a cessé d’être un signe d’alliance ou l’écharpe d’Iris pour se réduire avec Descartes à un simple phénomène optique de réfraction. Les comètes ne sont plus signes de désastres et les maladies ont cessé d’être un châtiment divin. Il était inévitable que la science et la religion entrent tôt ou tard en conflit.
Ce conflit devint manifeste en Occident avec la conception copernicienne et galiléenne du monde qui privait la Terre de sa situation privilégiée au centre du Monde, seule place digne de l’homme qui se considérait comme le roi de la création. Le conflit empira avec ce qu’on a appelé le siècle des Lumières. Les secours que l’on attendait de la religion, les philosophes les escomptèrent, sans recours au surnaturel, de la raison, de la science et de la technique. La vie terrestre cessa d’être considérée comme une épreuve transitoire, n’ayant pas sa finalité en elle-même. Le droit au bonheur ici-bas fut constitutionnellement proclamé. L’humanité, affranchie de la tutelle des dieux et des rois, entendit assumer son propre destin.
Certaines nations, prenant la tête de la caravane humaine, s’engagèrent résolument dans cette voie. Chez d’autres, désireuses de brûler les étapes, le noble idéal des Lumières dégénéra en utopie. L’utopie consiste, au prix d’une révolution violente faisant table rase du passé, à chercher à réaliser une société rigoureusement égalitaire, sans classe dominante ni classe dominée, où chacun, libéré de la loi aliénante du travail imposé, ne connaîtra plus que la joie du travail attractif laissé à son libre choix. Dans un état d’abondance économique ce sera le royaume du dieu des apocalypses judéo-chrétiennes transporté du ciel sur la terre.
Les utopies sont chez les incroyants les substituts des religions.
Elles répondent au même besoin de donner une justification à l’existence, une fin heureuse à l’aventure humaine. Toutefois, entre les utopies et les religions subsiste une différence fondamentale. Le croyant, en pariant comme Pascal pour une autre vie, n’engage que sa personne. L’utopiste, parvenu au pouvoir, engage une société entière. Comme la réalité, fondée sur l’inégalité des aptitudes et la promotion inévitable des élites, résiste à son rêve égalitaire, il attribue son échec non à l’irréalité de son idéal, mais à la malignité de son peuple. Ce qu’il n’a pu obtenir par persuasion, il entend l’obtenir par la contrainte. Au lieu de l’âge d’or, c’est le KGB, l’hôpital psychiatrique et l’archipel du Goulag que l’on obtient.
Sur la lancée du siècle des Lumières, les nations qui ont respecté son héritage, les droits de l’homme, la liberté d’entreprendre, ont réalisé un formidable bond en avant pour augmenter le bien-être des masses laborieuses, rendre les sociétés plus équitables et plus humaines, grâce à une meilleure répartition des acquêts du progrès économique. Néanmoins, à l’optimisme joyeux du siècle des Lumières succède aujourd’hui une morosité, une inquiétude qualifiée de crise de civilisation.
Pour la première fois, l’humanité a pris conscience de sa fragilité. Pour la première fois, elle a acquis le pouvoir de s’autodétruire, soit par une guerre atomique, soit par l’épuisement des ressources de la planète surexploitée, soit par la détérioration à force de pollution de la biosphère qui est la condition de sa survie. Les solutions ne peuvent être que d’ordre planétaire et à long terme ; mais elles se heurtent aujourd’hui au dogme de la souveraineté des Etats dont les gouvernements n’agissent que nationalement et à court terme.
Cette anxiété du monde suscite un renouveau du besoin de croire. La science et la foi sont comme les deux fléaux d’une balance : quand l’un monte, l’autre descend. Tant que subsistera l’angoisse existentielle de l’homme, il y aura des dieux.

À lire : 📘 Paul le Cour : Morceaux choisis