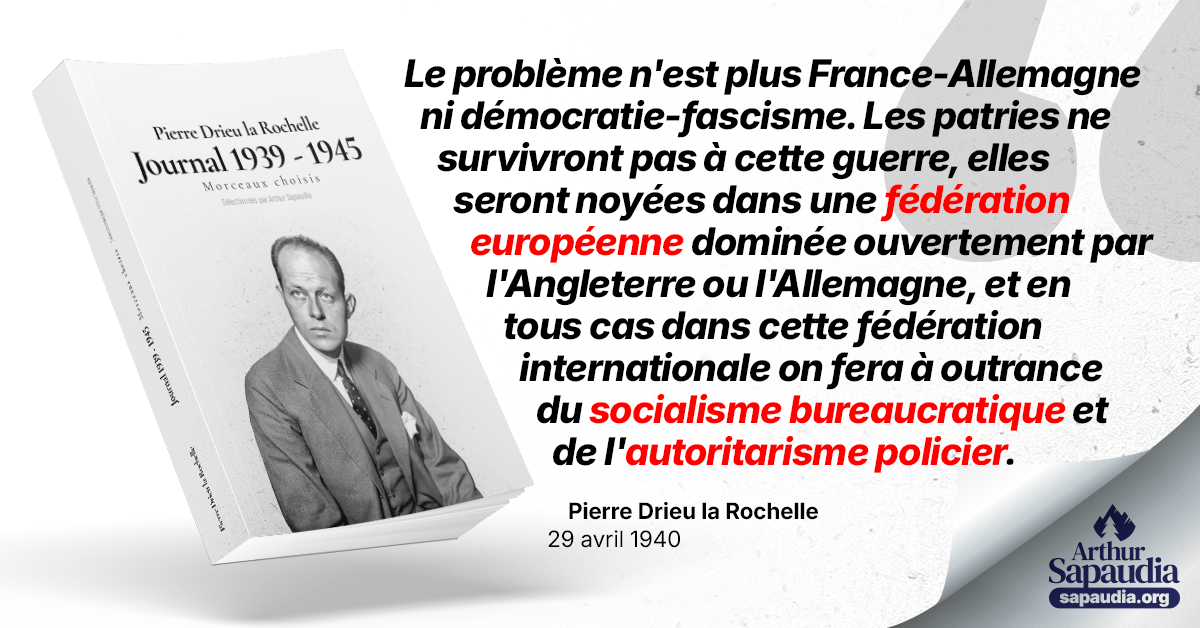Extrait de Socialisme fasciste, Juillet 1934
Rien ne va si mal : pourquoi se plaindre ? La vie est douce. Toujours un peu d’argent, d’amour. Paris est délicieux et la campagne, et les petits voyages. Alors pourquoi ces accès de rage ? Si, à certaines heures, je suis gêné par des fantômes, eh bien, voici l’un d’entre eux.
Ces discussions interminables, cette frénésie d’irrésolution, ce monstre à neuf cents têtes qui ne se voit pas, qui s’imagine n’avoir jamais de témoins, cette irresponsabilité hargneuse et arrogante, ce Palais-Bourbon aussi ignorant et dédaigneux que la cour dans l’ancien Palais des Bourbons — tout cela n’est rien. Ce qui compte pour moi, c’est l’hypocrisie des démagogues. Une trop vieille et profonde hypocrisie dans un pays, c’est le ver dans le fruit.
Ces gens défendent ceux qu’ils semblent attaquer et dont ils paraissent les victimes. Nuls défenseurs plus utiles du capital que les radicaux, parce que secrets, parce qu’effrontément exilés dans le camp adverse.
Hypocrites. Non seulement les chefs, mais la troupe. Oui, j’ai suivi deux ou trois congrès radicaux, et je fus d’abord surpris : que tout un groupe, tout un parti pût être hypocrite. La conspiration de l’hypocrisie peut s’étendre à des milliers de personnes. C’est que l’hypocrisie est souvent une passion furieuse.
Les radicaux, dans leurs entrailles, ne peuvent se résigner à l’aveu qu’ils ont fait leur temps et qu’ils ne peuvent plus que se confondre dans la masse conservatrice. Ils s’acharnent en paroles à différer de ceux dont ils servent ainsi deux fois les pensées.
Conservateurs honteux, conservateurs de néant, conservateurs de ce compromis où rien ne trouve son efficacité, ni leurs idées, ni celles de leurs adversaires.
La contradiction entre la droite et la gauche, c’est une parade où est tout l’art de notre gouvernement. Le despotisme d’Asie ainsi s’appuyait sur un jeu d’oppositions, sur les contrariétés d’intrigues dans la cour. Sous l’Ancien Régime, la Robe semblait s’opposer à la Cour ; et pourtant, dès le second jour de la Révolution, se confondaient dans les complots et les prisons des adversaires qui n’étaient que des complices. Les whigs sont déjà dans le même sac que les tories.
On peut conserver des choses contradictoires. On peut conserver ensemble l’Église et la Franc-Maçonnerie, la grande banque et la démagogie électorale, le militarisme et le pacifisme verbal.
Une condition : faire semblant de se battre. Ainsi un lecteur de l’Écho de Paris ne sait pas qu’il est solidaire en profondeur d’un lecteur du Canard Enchaîné. Pour qu’il l’apprenne, il faudrait un grand bouleversement. Ce grand bouleversement, oh ! si nous le faisions…
Maintenant que les radicaux vont enfin se perdre dans les rangs conservateurs, les socialistes seront à découvert. On va voir qu’ils n’étaient que des radicaux. Sous prétexte de libertés, et particulièrement de libertés ouvrières, ils défendent le Parlement, le lieu du compromis où se sont consumés les radicaux, où ils se consumeront à leur tour.
Derrière eux, les communistes de Moscou. Il n’y aura plus qu’une ombre qui les séparera à leur tour du grand jour. Plus question de socialisme : une vieille gauche libertaire contre une vieille droite réac, toute la vieille France.
Vous me direz que le mensonge radical-socialiste n’a rien de secret, qu’il se voit. Moi, je vous réponds qu’il reste secret. Ce mensonge est enraciné à une profondeur inouïe dans l’inconscience. Mais surtout, dans l’inconscience des complices : les capitalistes. Les corrupteurs aiment encore plus les corrompus, que les corrompus les corrupteurs. Cela, ni les uns ni les autres ne le savent : vous voyez bien que j’ai raison de parler de secret.
Pareils aux radicaux (et aux socialistes) sont leurs complices. Ces députés et journalistes de droite attachés au système parlementaire, et qui n’attaquent la gauche que pour lui prendre une majorité qu’ils veulent seulement fugitive. Le trait d’évidence, là, c’est qu’au pouvoir, les gens de droite ne touchent pas au ministère de l’Intérieur, au mécanisme qui permettra leur prochaine défaite et de nouvelles élections de gauche. L’Action Française est attachée aussi au régime, par la démarche même de son opposition, qui avilit les personnes mais ne rompt point avec la véritable essence du régime : le compromis entre les riches et les démagogues. Je soupçonne l’A.F. à droite de la même collusion que la S.F.I.O. à gauche.
Mais les chefs de la banque, de l’industrie, de la presse chérissent encore mieux les démagogues — tout en souhaitant leur perte à leurs moments perdus. Ils préfèrent cette collusion à jouer cartes sur table, avec un gouvernement de droite. Ils veulent continuer ce régime dont ils se plaignent. Ils crient à l’incohérence, au manque d’autorité. Mais s’il y avait une autorité, elle serait contre eux ; une cohérence, elle les réduirait. Leur irresponsabilité de chefs économiques — qui pourtant disposent du corps et de l’âme de millions d’hommes et de femmes — caresse l’irresponsabilité des chefs politiques qui se gardent bien d’une prise décisive sur l’économique. Ils osent dire qu’ils ne sont pas bien servis par ce régime, mais aussitôt qu’il est menacé, ils le soutiennent par en dessous, y reconnaissant soudain leur meilleure défense. C’est pourquoi ils craignent le fascisme. Ils le haïront à Paris, comme ils le haïssent à Milan et à Essen.
Après le 6 février 1934, en France, tout le monde a volé au secours de la collusion entre la démagogie et l’argent. D’abord l’A.F., qui, le 6 février déjà, ne faisait plus rien. Ensuite les parlementaires de droite qui ont dévié avec l’A.F. sur des querelles poissardes l’entrée en bataille des naïfs. Ensuite le grand capitalisme qui, par sa presse, a doucement enterré l’action des ligues. En même temps, la C.G.T., le parti S.F.I.O. Et enfin les communistes accouraient sur l’ordre de Moscou. « Il ne faut pas déranger la combine sur quoi repose l’ordre dans le grand pays allié. » Le 12 février, on a vu que décidément il n’y avait plus de communisme en Europe, ou plutôt qu’il n’y en avait jamais eu. Et Doumergue s’est élevé, un pied sur le 6, un pied sur le 12, bien balancé sur deux forces qui jouissent de s’annuler.
Pierre de touche. Élevez‑vous devant quelqu’un contre les congrégations économiques, ce complexe de banques, grandes industries, grande presse qui est en collusion avec la haute administration et les états‑majors de tous les partis politiques — mais élevez‑vous ensuite contre les syndicats de fonctionnaires, la C.G.T., la franc‑maçonnerie qui sont les autres congrégations exploiteuses de l’État — cet homme détournera la tête et se courroucera. C’est un homme de gauche. Faites l’expérience en sens inverse, c’est un homme de droite. Et ceci, même si c’est un communiste à gauche — même si c’est un A.F. à droite. Nous sommes contre tous.
Si le fascisme se présente comme un nouveau parti intermédiaire, entre la vieille droite et la vieille gauche — entre le capitalisme, la paysannerie, le prolétariat et les classes moyennes — quand il est au pouvoir, sa méthode n’est pourtant pas celle du radicalisme, c’est la méthode contraire. Ce n’est pas une politique d’équilibre, ce n’est pas balance et balançoire, c’est une politique de fusion. Les forces entre lesquelles se joue le radicalisme, le fascisme les oblige à s’affronter enfin. À l’intérieur d’un fascisme, il y a dans le grand feu une dernière lutte privée, sournoise, lente, féroce, sans merci entre les éléments combustibles. Regardez Rome et Berlin.
Les gens de gauche ne savent de quoi il retourne. Ils disent : « Le fascisme, c’est la dernière défense du capitalisme. C’est un dernier triomphe du capitalisme. » Mais non, comme à Moscou, il s’agit à Berlin et à Rome d’une réaction beaucoup plus pure. D’une réaction comme on n’en avait pas rêvé depuis M. de Maistre. La réaction pure et simple. Et même comme on n’en avait pas rêvé depuis la lutte du sacerdoce et de l’Empire. Car on nous donne une pure théocratie où le spirituel et le temporel enfin se confondent. C’est la grande réaction qu’a connue déjà la Rome impériale. Et pourtant je veux cela. La liberté est épuisée, l’homme doit se retremper dans son fond noir. Je dis cela, moi l’intellectuel, l’éternel libertaire.
Quand ce serait le seul mérite du fascisme, d’arracher ces masques, tous ces masques. On ne dit plus gauche et droite en pays fasciste. Il n’y a plus que le capitalisme contre le socialisme, enlacés pour la lutte à mort.
Ce qu’aurait fait le capitalisme dans une Russie démocratique en quinze ans : l’immense et brusque développement après la guerre comme aux États‑Unis. Le bien qui en aurait résulté pour l’Amérique et l’Europe, pour tous les humains : la crise actuelle évitée, les prolétariats européens et américains auraient eu du travail jusqu’au point d’une dénatalité suffisante. Mais ainsi va l’ironique et cruelle Histoire. Je les aime de n’avoir pas pris le plus court chemin.
Vous savez bien qu’il est difficile de garder des châteaux et des grandes maisons particulières. Quand vous en avez, vous allez ailleurs : dans des hôtels, des bateaux, vous voyagez. Vous aimez les cafés, les bars, les restaurants, les cinémas, les sports d’hiver et les sports d’été, tous les lieux de confusion. Vous savez bien que le commerce de détail est miséreux. Vaut‑il mieux être petit commerçant ou employé dans un grand magasin ? Médiocrité pour médiocrité, l’employé, après ses huit heures de travail, est plus libre. Le mécano de village est‑il libre ? Le chef du dépôt local d’épicerie l’est‑il moins que lui ? Un journaliste est‑il moins libre dans une presse d’État que dans une presse de monopole ? Le littérateur qui « écrit pour le grand public » et celui qui écrit pour l’État, c’est‑à‑dire encore pour le grand public, voyez-vous une différence dans son avantage calculé ?
Mais si j’invente, si je crée une nouvelle industrie ? Certes, mon débouché sera difficile. Mais, bah ! l’homme a besoin d’autre chose aujourd’hui que d’inventer des machines. Il a besoin de se recueillir, de chanter et de danser. Une grande danse méditée, une descente dans la profondeur.
Les gens ne savent plus s’ils doivent encore travailler ou ne plus rien faire. Ils ne savent pas s’ils doivent jouir ou s’abstenir. Je dis qu’individus épuisés, ils ne peuvent plus jouir que des grandes figures de l’esprit dessinées par le corps social. Regardez les abeilles, les fourmis, que pouvons-nous faire d’autre ? Qu’avons-nous jamais fait d’autre ? Notre seule plénitude, c’est une civilisation vue de loin, où les joies et les chagrins se mêlent. Il n’en reste que le dessin. Tout est dans le dessin.
La qualité. La qualité se retrouvera, le jour où la quantité sera limitée.
Le socialisme en Russie veut dire course à la production, parce qu’il y est venu avant son temps, qu’il imite péniblement la course du capitalisme qui aurait dû le précéder. En Europe, le socialisme ne peut dire que repos réfléchi après cette longue fatigue folle du capitalisme qui, d’ailleurs, de lui-même tombe dans la langueur. Un capitalisme qui renonce à sa grandeur, à ses vices et à ses vertus ; voilà le socialisme qui est derrière le fascisme, un socialisme pour vieux Européens.
C’est comique de voir les capitalistes alléguer la liberté. Quelle liberté représente aujourd’hui le capitalisme ? Dans l’ordre économique, politique, culturel, quels débris ? Ou alors, de quel capitalisme parle-t-on ? Revenir à l’ancien est une utopie.
C’est comique de voir la C.G.T. et la S.F.I.O. défendre la liberté, ce même débris inutile qu’agitent les capitalistes. C’est d’une autre liberté dont devraient parler cette confédération et cette section.
La liberté. De quelle liberté voulez-vous ? Où est-elle ? Où a-t-elle jamais été ? Où sera-t-elle jamais ? Si ce n’est dans la satisfaction des désirs réels à un moment donné. Or que désirons-nous ? Un ordre reposant. Nous voulons jouir du rythme qui pourrait être enfin si doux des machines.
Corporatistes, vous dites que vous représentez et que vous imposerez la Troisième Force ; que votre Ordre Nouveau s’instaurera à la fois contre ces deux manifestations secrètement jumelles de la contrainte — le monopole capitaliste et l’État marxiste ; que la France de demain renaîtra de la fédération spontanée des familles et des métiers, des corporations et des régions. Je ne peux guère vous croire, mais je veux vous suivre.
Je ne peux guère croire que l’État ne doive intervenir dans le premier mouvement de cette spontanéité. Mais alors, s’en ira-t-il jamais ? Il arrivera à vos corporations ce qui est arrivé aux soviets : la tutelle de Staline n’est pas près de finir. Ni pour les corporations italiennes, la tutelle de Mussolini.
Mais les dictateurs passent et il faudra bien que les hommes se débrouillent de nouveau par eux-mêmes ; alors, vous aurez raison.
Et en tous cas, ce détour corporatiste, c’est notre manière à nous, petites gens, entre toutes les classes, toutes les doctrines.
Est-ce que je suis effrayé par l’Étatisme ? Tout nous y porte. Nous y sommes déjà engagés plus qu’à moitié. La grande banque, la grande industrie, la Presse sont déjà à demi confondues avec l’État. Elles assiègent l’État, mais que demain un homme et un parti fort se trouvent soudain à la tête de l’État et toutes les avenues que le capitalisme a ouvertes vers le pouvoir seront vivement remontées en sens inverse contre lui. Le banquier qui assaille le cabinet du ministère et qui ainsi prouve déjà sa faiblesse y revient bientôt pour prendre des ordres.
Mais si l’Étatisme est une fatalité, n’est-ce pas assez pour que je me raidisse contre elle ? Le propre de l’esprit n’est-il point de s’opposer à toute fatalité ? Je suis incliné plutôt à vaincre cette fatalité en l’épuisant. Tuer l’Étatisme à force d’user de l’État, mettre tout dans l’État, si bien que l’État soit la nation. Il profitera du sursaut des instincts qu’il aura englobés. On peut tuer une partie de la vie, mais non pas toute la vie. Peu à peu, l’État totalitaire se disloque, devient souple et vivant.
Nous sommes trop faibles pour davantage laisser faire, laisser passer, tout va à hue et à dia. Oui, c’est parce que nous sommes faibles que nous sommes socialistes. Osez nous le reprocher. Mais le nouveau mal que révèle une époque annonce le bien qu’il engendrera. Quelle force collective sort de l’aveu de ses faiblesses individuelles. Nous nous trempons dans cet aveu comme le métal dans l’eau.
Beaucoup se réfugient dans l’État, mais cela n’est dangereux que dans la mesure où tous n’y ont pas encore accédé ; ainsi ceux qui y sont déjà profitent d’une inégalité par rapport à ceux qui n’y sont pas encore. Mais quand tous y seront ? Et quand tous sont dans l’État, chacun devient responsable. Mille responsables s’improvisent et s’activent. Le corps social devient sensible à mille points de sa superficie, c’est un corps de mieux en mieux innervé. On nous parle des corporations. Eh bien, si nous allons à l’État par ce chemin, les Russes viennent à la corporation par l’État.
L’homme ne peut penser que par groupes. Ne vous effrayez donc pas d’un État qui déjà s’articule.
Les paysans ? Y aura-t-il encore demain des paysans ? Y aura‑t-il éternellement des paysans ? Non. C’est pourquoi le socialisme a raison. Le kolkhoze réussit en Russie, mais sans doute va‑t‑il trouver son indépendance relative vis-à-vis de l’État.
Le paysan, en Europe, est de plus en plus réduit, exploité. Il est la proie des trusts comme l’ouvrier et le bourgeois : trust du blé, trust des engrais, rafle du lait, etc. Il ne peut se sauver qu’en fondant l’usine agricole.
Faut‑il sauver l’artisan ? Peut‑on le sauver ? Sa part sera réduite comme celle du paysan. Ne vaut‑il pas mieux tout abandonner du passé ? Et reporter tout l’effort d’amélioration dans une autre ligue ? Pour revenir à la qualité, ne faut‑il pas faire confiance aux mesures entières du socialisme qui d’elles‑mêmes ensuite se ramifient dans des mesures plus nuancées ?
Le chemin de Mussolini et celui de Staline vont l’un vers l’autre.
Le prolétariat, est‑ce que je le connais ? Je ne connais pas les ouvriers, pas plus que les paysans. Mais y a‑t‑il là quelque chose de spécifique à connaître ? Je ne le saurai jamais. Est‑ce qu’il y a des classes ? Je ne le crois pas. Pourquoi est-ce que je ne le crois pas ? Parce que je suis un petit bourgeois. Je tiens à toutes les classes et à aucune. Je les déteste et les apprécie toutes. Mais, après tout, pourquoi est‑ce que je n’aurais pas le droit de parler ? Pourquoi n’aurai‑je pas raison ? Est‑ce que dans ma moyenne je ne suis pas tout ? Je suis tout. Je parle : qu’on m’écoute.
Je ne veux pas qu’on abuse davantage de ce mot « travailleur ». Nous aussi, nous sommes des travailleurs. Les paysans et les bourgeois sont aussi des travailleurs — tout comme les ouvriers. Certes, si le travail de l’ouvrier paraît le travail par excellence, c’est qu’il est le plus affreux, le travail de la machine. Mais le travail de bureau ne l’est pas moins.
Je veux défendre l’ouvrier comme une partie de mon sang, comme une partie du peuple. Je veux le défendre contre la grande ville. Je dis que la grande ville, c’est le capitalisme.
Pourquoi ne suis-je pas communiste ? Mais pourquoi ne suis-je pas réactionnaire ? Parce que je suis un petit bourgeois et que je ne crois qu’aux petits bourgeois. Cette espèce de petits bourgeois qui tient du petit noble, du bourgeois des professions libérales, du paysan, de l’artisan. Mais qui n’aime ni le fonctionnaire, ni l’employé, ni l’ouvrier d’usine quand ils ont oublié leur origine concrète. Rien n’a jamais été fait que par nous. Et le socialisme sera fait par nous ou ne sera pas fait. Nous craignons tout et nous n’avons peur de rien. Nous craignons l’Église et la Franc‑Maçonnerie, le prolétariat et le capitalisme, la France et l’Europe, l’Allemagne et la Russie, mais nous persistons. Nous avons déjà fait ce régime qui se casse, nous en referons un autre. Nous sommes la masse des individus, le liant de toutes les classes. Nous sommes les hors‑classe, les hommes libres.
Je ne veux me décider pour rien, parce que tout est contre moi. Je veux ce qui résulte de mon attachement à moi‑même. Les autres y trouveront leur bien : nous le leur imposerons ainsi.
Nos hommes : Maurras, qui n’est ni royal ni aristocrate — Jaurès, qui n’est pas marxiste — Clemenceau, qui est démocrate à coups de botte comme Cromwell puritain — Thiers, Fouché, qui survivent à dix régimes — Bonaparte, qui n’est pas roi — Cromwell — et sans doute, Mussolini, Hitler, Staline. Ennemis de toutes les classes, traîtres à toutes les classes. Fidèles à nous‑même. Les rois ont tué les nobles, les riches n’ont jamais été des chefs : il n’y a que nous.
J’écris dans la grande presse, je suis édité chez un grand éditeur. Je dîne chez quelques personnes riches. Mais cela ne trompe personne. Moi, cela ne me trompe plus. Je me fous de l’égalité. Ou plutôt je la déteste comme toutes les choses qui n’existent pas. Dès 1918, j’ai flairé dans le communisme russe le moyen de produire une nouvelle aristocratie. Je ne m’étais pas trompé. Je cherche dans le socialisme de forme européenne, le fascisme, cette nouvelle aristocratie.
Une jeune aristocratie n’est point fondée sur l’argent, mais sur le mérite. L’hérédité, qui vient après, est une convention comme une autre. Et qui, d’ailleurs, fait souvent défaut, faute de…
Moi, personnellement, je n’ai peur de rien, parce que je ne veux rien. Qui m’empêchera jamais de parler ? Ma plume subtile se dérobera toujours à toutes les étreintes. Et comme, par ailleurs, on ne pourra se passer d’elle (de la mienne ou d’une autre, toute pareille)…
J’ai besoin de si peu de choses. 60 000 francs par an. Deux chambres et une salle de bains. Quelques taxis. Deux costumes, un peu d’argent de poche. Un ou deux voyages en Europe. J’ai renoncé à l’Asie et aux enfants. Je suis un moine. Contemplatif, je jouirai fort bien d’une belle machine étatique comme pauvre, je jouis du capitalisme. Je n’ai même pas besoin d’être près des chefs pour jouir d’un mécanisme que je devine.
Je peux me placer à un point de vue esthétique, il recoupera le plan moral. Ce qui me gêne : cette pauvreté physique et morale, cette absence de liens entre le physique et le moral. Je voudrais bien qu’il y eût des esclaves, si cela faisait plus de bien que de mal. Mais dans les esclaves de la grande ville meurt la race. Je me sens un lien antique avec les ouvriers et les paysans : je voudrais les rencontrer quelque part. Sur la place du village ou de la ville. Comment, bourgeois, pouvez-vous vivre sans eux ?
« Ils ne sont pas intéressants », disent ceux qui les connaissent. Bien sûr, ainsi va-t-il de toute connaissance. Un lien de chef. Je me rappelle ma gêne au régiment. Ma souffrante démagogie. Mon horreur de les tromper et mon besoin de les protéger.
Je ne suis pas sceptique, je suis espiègle. J’ai tellement lu Nietzsche : le pessimisme me semble la plus grande joie. Merci, Nietzsche.
Ce qui me pointe, c’est la santé physique et morale des hommes. Je souffre pour le corps des hommes. Le corps des hommes est ignoble, en France du moins. Horrible, de se promener dans les rues et de rencontrer tant de déchéances, de laideurs, ou d’inachèvements. Ces dos voûtés, ces épaules tombantes, ces ventres gonflés, ces petites cuisses, ces faces veules. Non, je souffre trop, moi l’élite, il faut que je réagisse contre cela.
Et ces gens, à quoi croient-ils ? On les a fait croire à eux-mêmes ; c’est idiot. Il faut leur donner un dieu. Puisqu’il n’est plus de dieu dans le ciel, donnons-leur un dieu sur la terre. Les dieux naissent sur la terre ; puis montent au ciel.
Nous ne voulons plus de ces maîtres qui ne sont pas des maîtres entiers. Qui partagent le pouvoir secrètement avec leurs ennemis. Qui ne s’occupent pas du tiers ou du quart de ce qui devrait les préoccuper. Du corps et de l’âme des gens.
Ces Français, ce sont des abandonnés. On ne peut pas les laisser plus longtemps dans la négligence de leur corps et de leur âme. Catholiques, ou protestants, ou francs-maçons, ils le sont si peu. Et ces Juifs, mon cœur se serre à la pensée de ces pauvres âmes au carrefour. Les êtres les plus abandonnés que j’aie rencontrés étaient des Juifs.
Sans chefs, sans amis. Il ne leur reste que leur femme : deux célibataires qui vivent ensemble. Leur patrie est méchante. Quelle est votre religion ? Votre lien ?
Communistes, qu’espérez-vous ? Vous ne pourrez plus longtemps nous vanter la Russie. La Russie sera faite, et à ce moment, on s’apercevra que ce n’était point ce que vous nous disiez. De gré ou de force, il faudra bien vous replier sur vous-même, ne compter que sur vous-même, sur nous-mêmes.
Je suis pour Staline, Mussolini, Hitler, Pilsudski, etc. Je suis toujours pour ceux qui « mettent la main à la pâte », comme disait Fouché. Je ne pardonne l’opposition éternelle qu’aux naïfs, aux vieux anges — ou aux intellectuels. Mais pas à Trotsky, un vaincu, un raté, un Chateaubriand.
Quelle différence entre mussolinisme ou hitlérisme et stalinisme ? Aucune. Des élections brusquées selon la méthode napoléonienne. Une camarilla éternelle. Le machiavélisme le plus vulgaire. Et pourtant, un renouvellement de la vie humaine : ces grandes fêtes, cette perpétuelle danse sacrée de tout un peuple devant l’autel d’une idée muette et ambiguë, devant une face divinisée.
Cependant que nous autres, pêcheurs à la ligne… J’aime les analogies, les simplifications. En les multipliant, je retrouve la subtilité.
Vous me demanderez si je participerai à la prochaine guerre. Mais est-ce qu’on demande à un homme s’il participera au prochain tremblement de terre ? Le tourbillon sera tel que l’objecteur de conscience n’aura même pas le temps de prendre position. Et ceci n’est pas une image : le chaos sera dès le premier jour. Paris et Berlin seront dès le premier jour comme fut Pétrograd au début de 1917 : une maison de fous sans gardiens.
La patrie. Peut-être nous en tiendrons-nous là. La Grèce est bien morte dans ses cités.
S’il y a une Europe, cela ne présentera aucun intérêt au point de vue de l’ancienne originalité, du fin dessin exquis. Qu’a donné la Pax Romana en fait d’art ? Une grande figure belle à voir de loin, des étoiles ou de notre temps.
… Toutefois, elle se voyait dans la glace et jouissait d’elle-même, cette grande figure : la statue de Rome sur la place d’une petite ville gauloise ou arménienne. La statue des divins empereurs. Tombeaux de Lénine, de Staline, de Mussolini, de Hitler. Voici revenu le temps des grandes foules faibles, des divins empereurs. Ainsi tel est notre étrange devoir, à nous qui sommes des hommes, et plus les meilleurs des hommes. Nous ne nous battrons pas pour la dictature du prolétariat, ni pour une dictature de droite. Nous, les petits bourgeois, les ouvriers d’élite, les paysans fins, les bourgeois qui ont le sens de la responsabilité. Nous ne nous battrons pas pour des capitalistes patriotes qui nous retirent notre bien. Nous ne nous battrons pas pour des communistes qui vivent comme des jésuites, des ultramontains, sur le mystère d’ordres lointains et qui n’osent pas nous avouer cyniquement ce qu’est la dictature de la Guépéou. Nous ne nous battrons pas non plus pour défendre des patries qui n’ont plus besoin d’être défendues, qui sont immortelles — avec des armes qui nous haïssent. Nous ne nous battrons pas pour ceci ou pour cela. Nous nous battrons contre tout le monde. C’est cela, le fascisme.
Je parle en hâte. J’ai soif d’intimité comme sur la place d’un village, ou d’Athènes au temps de Socrate. À quoi bon vivre, si l’on ne joue pas la farce à plein, si l’on ne s’avance pas vers le public dans un délire de prostitution et de sincérité, jusqu’à bousculer les chandelles.
Les hommes comme moi sont dans l’ordre de la pensée, le pendant des véritables hommes d’action qui transcendent les partis dont ils partent, par opportunisme supérieur. Rien de plus hésitant que l’homme d’action — jusqu’à la dernière minute. Sa pensée est ambiguë comme l’action. Seules sont claires : les théories, seuls sont droits : les fanatismes devant les douze fusils. Mais nous autres, les conciliateurs, les faiseurs de nœuds, il y a des balles pour nous aussi — et tant d’injures que c’en est une plénitude.