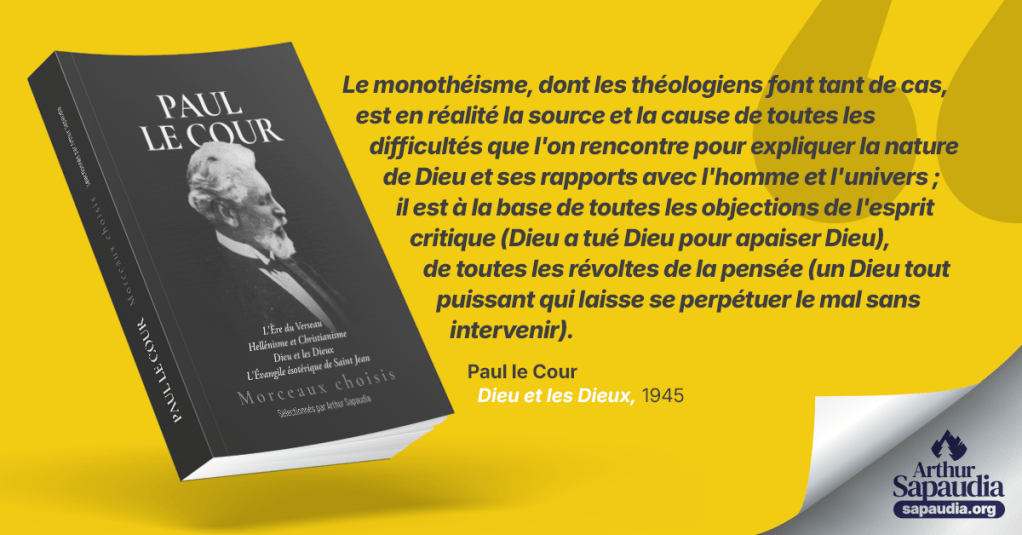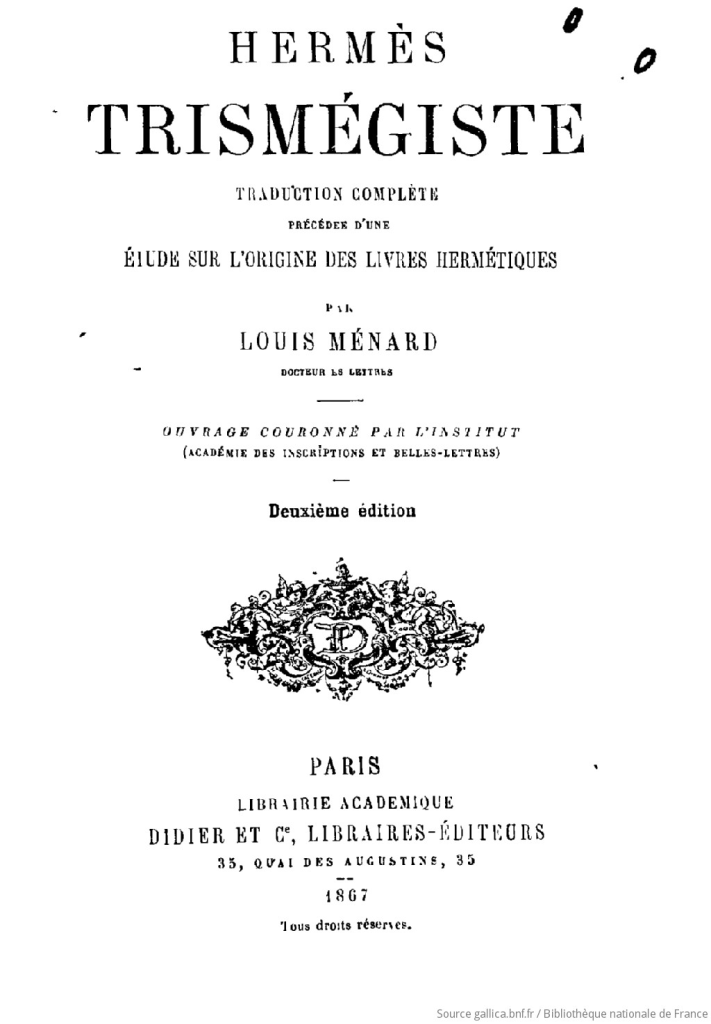Publié dans La Revue des Deux Mondes, 1866 – Partie 1
Les ténèbres qui enveloppent d’ordinaire la naissance des religions reparaissent presque toujours lorsqu’on veut en étudier la chute. Jouffroy, en quelques pages éloquentes où se retrouvent toutes les qualités de ce délicat et puissant esprit, a cru expliquer comment les dogmes finissent. Le développement qu’ont pris depuis quelque temps les études d’histoire religieuse donne un intérêt particulier à cette obscure question. Bien peu de documens permettent d’en donner une solution vraiment scientifique. Le paganisme, en entendant par ce mot l’espèce de compromis qui s’était établi entre les croyances des divers peuples de l’empire romain, nous offre presque le seul exemple d’une religion qui soit tout à fait morte, du moins en apparence : au IVe siècle de notre ère, l’histoire en constate la chute officielle ; mais n’y eut-il pas, en dehors de Julien et de son entourage, des dévots païens qui protestèrent contre l’avènement des nouvelles croyances ? La vieille foi expirante n’a-t-elle pas fait entendre au moins une plainte qui nous aide à connaître l’état des âmes à ce moment solennel ? Enfin les dogmes qui allaient mourir n’ont-ils pas contribué, dans une certaine mesure, à l’élaboration des dogmes nouveaux ? Ces problèmes tiennent aux origines du christianisme lui-même, et les rares monumens qui les soulèvent méritent à ce titre l’attention la plus sérieuse de la critique moderne.
Sans doute l’avènement du christianisme présente, au premier abord, l’aspect d’une révolution radicale dans les mœurs et dans les croyances du monde occidental ; mais l’histoire n’a pas de brusques changemens ni de transformations imprévues. Pour comprendre le passage d’une religion à une autre, il ne faut pas opposer entre eux deux termes extrêmes, la mythologie homérique et le symbole de Nicée ; il faut étudier les monumens intermédiaires, produits multiples d’une époque de transition où l’hellénisme primitif, discuté par la philosophie, s’altérait chaque jour davantage par son mélange avec les religions de l’Orient, qui débordaient confusément sur l’Europe. Le christianisme représente le dernier terme de cette invasion des idées orientales en Grèce. Il n’est pas tombé comme un coup de foudre au milieu du vieux monde surpris et effaré. Il a eu sa période d’incubation, et pendant qu’il cherchait la forme définitive de ses dogmes, les problèmes dont il poursuivait la solution préoccupaient aussi les esprits en Grèce, en Asie, en Égypte. Il y avait dans l’air des idées errantes qui se combinaient en toute sorte de proportions.
La multiplicité des sectes qui se sont produites de nos jours sous le nom de socialisme ne peut donner qu’une faible idée de cette étonnante chimie intellectuelle qui avait établi son principal laboratoire à Alexandrie. L’humanité avait mis au concours de grandes questions philosophiques et morales, l’origine du mal, la destinée des âmes, leur chute et leur rédemption : le prix proposé était le gouvernement des consciences. La solution chrétienne a prévalu et a fait oublier les autres, qui se sont englouties pour la plupart dans le naufrage du passé. Quand nous en retrouvons une épave, reconnaissons l’œuvre d’un concurrent vaincu et non d’un plagiaire. Le triomphe du christianisme a été préparé par ceux même qui se croyaient ses rivaux et qui n’étaient que ses précurseurs ; ce titre leur convient, quoique plusieurs soient contemporains de l’ère chrétienne, d’autres un peu postérieurs, car l’avènement d’une religion ne date que du jour où elle est acceptée par les peuples, comme le règne d’un prétendant date de sa victoire. C’est l’humanité qui donne aux idées leur droit de cité dans le monde, et la science doit rendre à ceux qui ont travaillé à une révolution, même en voulant la combattre, la place qui leur appartient dans l’histoire de la pensée humaine.
De savans travaux ont été publiés sur la grande école philosophique d’Alexandrie. On a également étudié des ouvrages très divers qui peuvent éclairer l’histoire des origines chrétiennes, par exemple les fragmens de la polémique de Celse et de l’empereur Julien contre le christianisme, les livres de Philon, la vie d’Apollonius de Tyane par Philostrate. Enfin un savant commentaire a fixé la date des différentes séries des oracles sibyllins, œuvre en partie juive, en partie chrétienne, dont les apologistes chrétiens, dupes eux-mêmes de la fraude de leurs devanciers, invoquent très souvent le témoignage pour convaincre les païens de la vérité du christianisme. Il y a d’autres ouvrages apocryphes, d’un caractère tout différent, qui jouissaient auprès des pères de l’église d’une autorité au moins égale à celle des oracles sibyllins, et qui pourtant laissent encore aux érudits comme aux penseurs plus d’une question à résoudre : ce sont les livres qui portent le nom d’Hermès Trismégiste. Marsile Ficin, Patrizzi et les autres érudits de la renaissance qui ont traduit ou commenté ces livres n’hésitaient pas à les présenter, conformément à l’opinion de Lactance et d’autres docteurs de l’église chrétienne, comme des monumens de l’antique théologie des Égyptiens. On regardait alors Hermès comme une sorte de révélateur inspiré, un peu antérieur à Moïse, et ses écrits comme la source première des initiations orphiques, de la philosophie de Pythagore et de celle de Platon. Des doutes néanmoins ne tardèrent pas à s’élever, et les progrès de la critique firent classer les livres hermétiques parmi les dernières productions de la philosophie grecque. Casaubon les attribua même à un juif ou à un chrétien. L’auteur du Panthéon Ægyptiorum, Jablonski, crut y reconnaître l’œuvre d’un gnostique. Enfin Creuzer et son savant traducteur, M. Guigniaut, inclinent à penser qu’au milieu des idées alexandrines qui forment le fond des livres hermétiques on peut trouver quelques traces des dogmes religieux de l’ancienne Égypte.
Dans un travail récent où l’état de la question est exposé avec beaucoup de clarté, M. Egger émet le vœu qu’un philologue exercé publie une bonne édition de tous les textes d’Hermès en les accompagnant d’un commentaire. Ce vœu a déjà été en partie réalisé. M. Parthey a publié à Berlin une édition excellente des quatorze morceaux dont on possède le texte grec complet. Il les réunit, comme on le fait ordinairement, sous le titre de Pœmander ; mais ce titre, selon la remarque de Patrizzi, ne convient qu’à un seul d’entre eux, celui que les manuscrits placent le premier. Il existe de plus un long dialogue intitulé Asclèpios, dont nous ne possédons qu’une traduction latine faussement attribuée à Apulée, enfin de nombreux fragmens conservés par Stobée, Cyrille, Lactance et Suidas ; les trois principaux sont tirés d’un dialogue intitulé le Livre sacré. M. Parthey annonce la publication de ces divers fragmens ; malheureusement cette partie de son travail n’a pas encore paru. Pour quelques morceaux, on peut y suppléer par le texte de Stobée ; mais pour d’autres, notamment pour les définitions, on en est réduit a l’édition très incorrecte de Patrizzi. Le Poimandrès et l’Asclèpios ont été traduits en vieux français ; il n’existe aucune traduction du Livre sacré ni des autres fragmens. En attendant qu’une publication qui se prépare comble cette lacune, il y aurait intérêt, ce nous semble, à rechercher dès à présent quelle est la véritable portée des livres hermétiques. On essaierait de déterminer l’âge et les origines de ces livres en les comparant avec les documens que les auteurs grecs nous ont laissés sur la religion égyptienne et avec les faits que l’on peut considérer comme acquis à la science des hiéroglyphes. Le développement des études égyptiennes donne un intérêt particulier à cette comparaison. Les races, comme les individus, conservent à travers le temps leur caractère propre et originel. Les philosophes grecs ont souvent reproduit dans leurs systèmes la physique des poètes mythologiques, peut-être sans s’en apercevoir. On trouve de même entre la période religieuse de l’Égypte et sa période philosophique quelques-uns de ces rapports généraux qui donnent un air de famille à toutes les expressions de la pensée d’un peuple. Personne n’admet plus aujourd’hui la prétendue immobilité de l’Égypte ; elle n’a pu rester stationnaire entre le temps des pyramides et l’ère chrétienne. Tout ce qui est vivant se transforme, les sociétés théocratiques comme les autres, quoique plus lentement, parce que leur vie est moins active. Pour faire l’histoire de la religion égyptienne comme on a fait celle de la religion grecque, il faut tenir compte de ses transformations. Les plus anciennes ne peuvent être connues que par une chronologie exacte des monumens hiéroglyphiques ; les dernières nous sont attestées par la manière différente dont les auteurs grecs en parlent à différentes époques. Enfin de la rencontre des doctrines religieuses de l’Égypte et des doctrines philosophiques de la Grèce sortit la philosophie égyptienne, qui n’a laissé d’autres monumens que les livres d’Hermès, et dans laquelle on reconnaît, sous une forme abstraite, les idées et les tendances qui s’étaient produites auparavant sous une forme mythologique.
Une autre comparaison qui nous intéresse plus directement est celle qu’on peut établir entre quelques-uns des écrits hermétiques et les monumens juifs ou chrétiens, notamment la Genèse, les ouvrages de Philon, le Pasteur d’Hermas, le quatrième Évangile. Seulement il est nécessaire de déterminer avec précision ce qui appartient soit à l’Égypte, soit à la Judée, dans les livres d’Hermès Trismégiste. Quand on rencontre dans ces livres des idées platoniciennes ou pythagoriciennes, on peut se demander si l’auteur les a retrouvées à des sources antiques où Pythagore et Platon auraient puisé avant lui, ou s’il y faut reconnaître un élément purement grec. Il y a donc lieu de discuter d’abord l’influence réelle ou supposée de l’Orient sur la philosophie hellénique. On est trop porté en général, sur la foi des Grecs eux-mêmes, à exagérer cette influence et surtout à en reculer la date. C’est seulement après la fondation d’Alexandrie qu’il s’établit des rapports permanens et quotidiens entre la pensée de la Grèce et celle des autres peuples, et dans ces échanges d’idées la Grèce avait beaucoup plus à donner qu’à recevoir. Les peuples orientaux, ceux du moins qui se trouvèrent en contact avec les Grecs, ne paraissent pas avoir jamais eu de philosophie proprement dite. L’analyse des facultés de l’âme, la recherche des fondemens de la connaissance, des lois morales et de leur application à la vie des sociétés, sont choses absolument inconnues à l’Orient avant la conquête d’Alexandre. Le mot que Platon attribue aux prêtres égyptiens sur ses compatriotes : « ô Grecs, vous n’êtes que des enfans, et il n’y a pas de vieillards parmi vous, » pourrait être renvoyé à l’Orient et à l’Égypte elle-même. L’esprit scientifique est aussi étranger à ces peuples que le sens politique. Ils peuvent durer de longs siècles, ils n’atteignent jamais l’âge viril ; ce sont de vieux enfans, toujours menés par les lisières, aussi incapables de chercher la vérité que de conquérir la justice.
Initié à la philosophie par la Grèce, l’Orient ne pouvait lui donner que ce qu’il avait, l’exaltation du sentiment religieux. La Grèce accepta l’échange ; lasse du scepticisme qu’avait produit la lutte de ses écoles, elle se jeta par réaction dans des élans mystiques précurseurs d’un renouvellement des croyances. Les livres d’Hermès Trismégiste sont un trait d’union entre les dogmes du passé et ceux de l’avenir, et c’est par là qu’ils se rattachent à des questions toujours vivantes et actuelles. S’ils appartiennent encore au paganisme, c’est au paganisme de la dernière heure, toujours plein de dédain pour la nouvelle religion et refusant d’abdiquer devant elle, parce qu’il garde le dépôt de la civilisation antique qui va s’éteindre avec lui, mais déjà fatigué d’une lutte sans espérance, résigné à sa destinée et revenant s’endormir pour l’éternité dans son premier berceau, la vieille Égypte, la terre des morts.