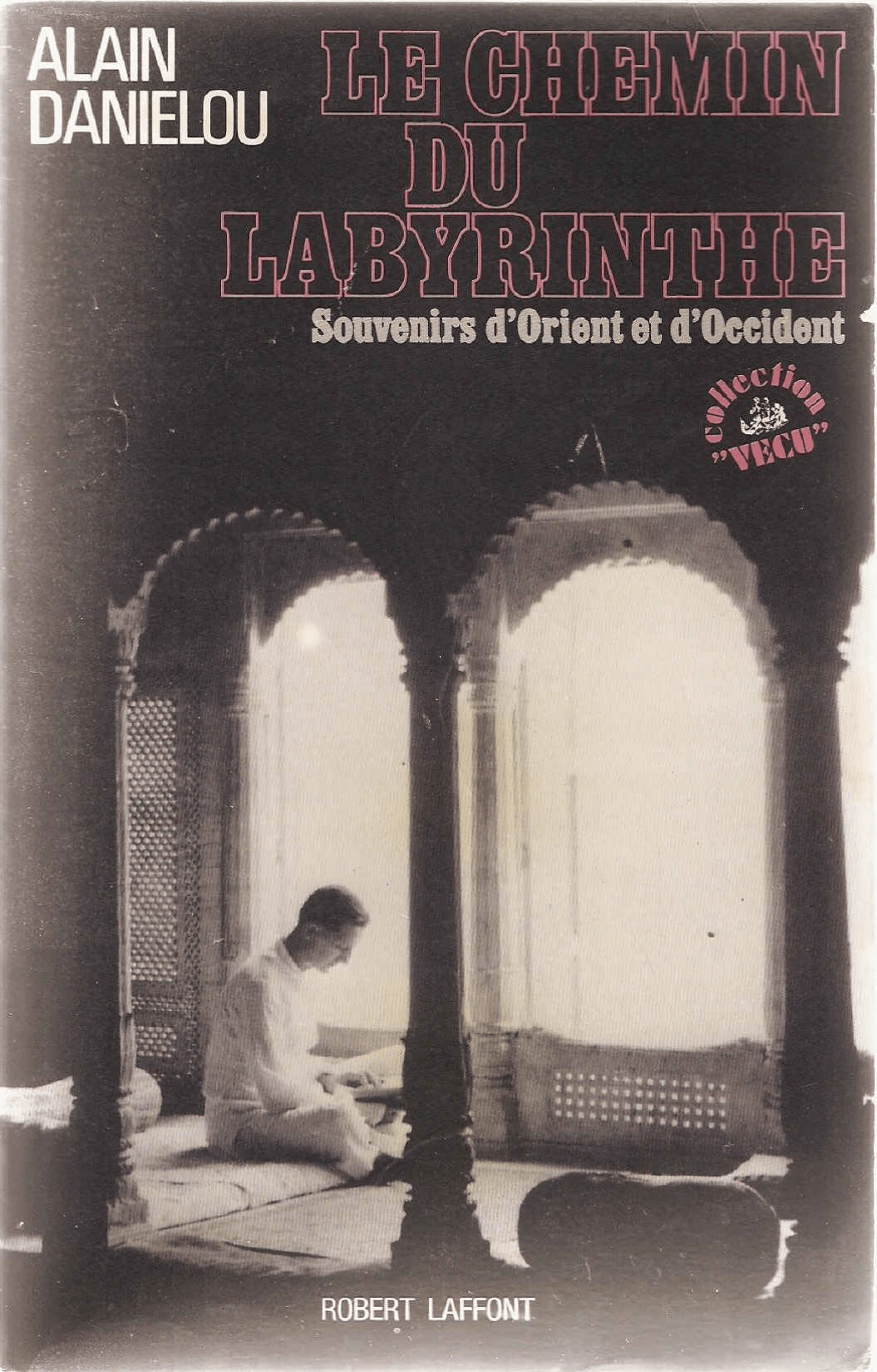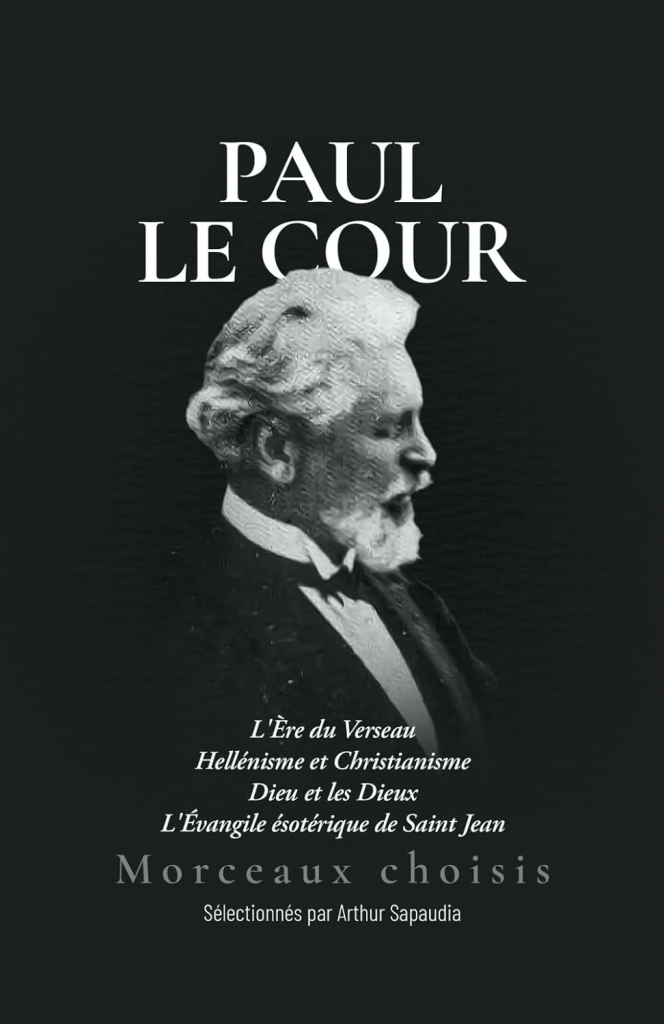Alain Daniélou, fils d’un ministre de la République française et frère d’un cardinal de l’Église catholique, musicologue et converti à l’hindouisme, tient une place toute particulière dans la nébuleuse traditionaliste française. Une place que l’on pourrait qualifier de marginale, non pas parce qu’elle serait insignifiante mais parce que, stricto sensu, Alain Daniélou se situe bien à la marge du mouvement pérennialiste. Pourtant, notre homme mérite d’être lu et médité car il présente la meilleure approche qui soit de l’Inde, de sa Tradition, de la possibilité d’un rattachement à celle-ci et, aussi, parce qu’il effectue une critique acérée du nationalisme indien dans ses versions laïques ou religieuses conçues comme un anti-traditionalisme.
Alain Daniélou nait en 1907, à Neuilly-sur-Seine, d’un couple mal assorti : alors que sa mère, catholique fervente, est la fondatrice d’un ordre religieux, son père, homme politique de gauche et anticlérical est plusieurs fois ministre sous la III° République.
Réfléchir et agir, février 2012
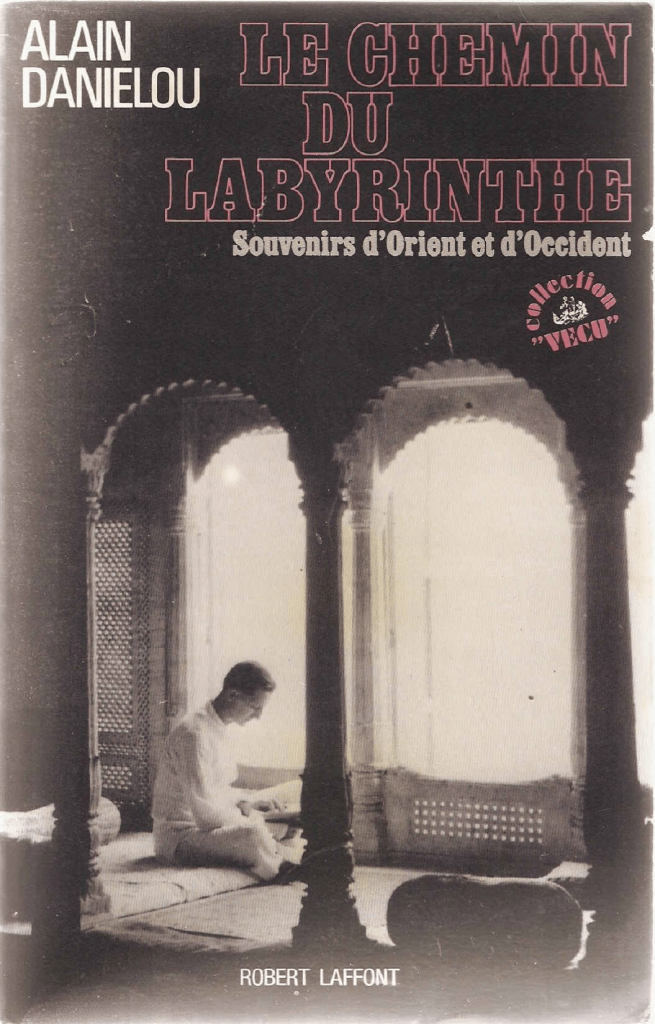
Extrait du livre d’Alain Daniélou, Le chemin du Labyrinthe, 1981
Enfant, je rendais souvent visite à ma grand-mère qui me témoignait beaucoup d’affection. Elle racontait des histoires de « pirates » qui enlevaient les femmes européennes et les torturaient en les suspendant par les orteils jusqu’à ce qu’ils aient obtenu une rançon. Quand ils étaient faits prisonniers, on attachait solidement à des échelles ces dangereux irréductibles pour les empêcher de fuir.
Non loin d’elle, habitait dans un atelier misérable, sous les combles, l’un de ses deux fils survivants, Pierre, peintre sensible et musicien. Il avait été gazé durant la guerre de 1914 et avait les poumons en lambeaux. J’allais le voir lui aussi quelquefois. On lui avait trouvé un emploi comme conservateur du musée Jacquemart André mais sa santé rendait tout travail difficile.
L’autre fils était Paul qui s’était fait prêtre et fut longtemps curé d’un quartier populaire avant d’être nommé chanoine de Saint-Pierre de Chaillot. C’était un homme ascétique et dur. Il était le confident de ma mère et fut certainement en grande partie responsable de son intransigeance. Il était odieux envers moi, m’accusant avec perfidie de fautes que je n’avais pas commises et me traitant de menteur quand je cherchais à me justifier. Il avait perfidement deviné mes penchants. Convaincu que certaines tendances ne sont pas innées mais sont le résultat d’expériences et se transmettent comme une maladie, il avait une manière méprisante de dire : « Vous êtes tous les mêmes », alors que de « tous » je n’avais jusqu’alors rencontré que moi-même et étais, en pratique, innocent des mœurs dont il m’accusait. (…)
Je ne fus pas surpris de l’attitude de mon oncle. J’avais déjà compris que les gens pour qui la morale est presque uniquement une histoire de frustration sexuelle sont sur les autres plans sans principes et dangereux.
La chasteté, quand elle n’est pas un masque, est une forme de masochisme. Il est normal qu’elle aboutisse à une sorte de sadisme et à un dérèglement pervers des valeurs. Chez les hindous on ne peut pas faire vœu de chasteté si l’on n’a pas eu d’expérience sexuelle. On ne peut renoncer à quelque chose que l’on ne connaît pas. Le renoncement d’un homme pauvre à la richesse n’est pas une vertu.
L’oncle Paul avait parmi ses fonctions celle de grand exorciste du diocèse de Paris. Il se mêlait donc de diableries et jetait de l’eau bénite sur de pauvres filles hystériques que l’on disait « possédées ». Ce prêtre, admiré pour son dévouement, son dénuement, sa vie de sacrifices, me terrifiait par sa tranquille cruauté. Il était le type même de l’inquisiteur, froid, dominateur, calme, sûr de lui. Je savais qu’en d’autres temps il m’eût envoyé sur le bûcher pour le bien de mon âme et la plus grande gloire de Dieu. J’ai eu l’occasion plus tard de rencontrer des sadiques qui avaient exactement le même comportement mais qui, du moins, ne mêlaient pas la gloire de Dieu à leurs étranges rites. (…)
L’un des problèmes que cette femme entière [sa mère] dut affronter était le fait que, pour elle, ses enfants étaient des bâtards. Elle ne voulut jamais les introduire dans « son » monde et, par ailleurs, ne supportait pas qu’ils fréquentent le monde de son mari, des politiciens qu’elle trouvait vulgaires et corrompus. Elle quitta une fois la table, chez elle en Bretagne, parce que mon père avait à l’improviste, avec quelques amis, invité une femme « divorcée ». (…)
Ma mère avait été reçue première à l’agrégation à une époque où les femmes ne faisaient guère d’études. Elle était d’une rare intelligence et d’une vaste culture auxquelles s’ajoutait une exceptionnelle capacité d’organisation. Elle ne présentait aucune trace de cet aspect masculin qui marque souvent les femmes directeurs d’entreprises. Elle avait un grand charme et savait en jouer. Passionnée, peut-être même sensuelle, et profondément dominatrice, son ambition était de « façonner » les êtres. Elle aimait être comparée non pas à Thérèse d’Avila mais à Mme de Maintenon.
À une époque où, bien que fille de général, elle avait été violemment dreyfusarde, elle avait épousé un jeune Breton, assez mauvais poète, qui devint un homme politique connu, souvent ministre, et qui était fortement gauchisant voire anticlérical.
Ce fut une curieuse union dont elle sut tirer beaucoup d’avantages, alors que, pour mon père, elle présentait certainement de graves inconvénients.
Ma mère attachait une grande importance à sa toilette avec une prétention de sobriété excessive. Elle ressemblait un peu au personnage de Silvana Mangano dans Mort à Venise, charmante, digne, irréprochable. Ses anciennes robes, qu’elle conservait dans le « cabinet des robes » où l’on m’enfermait pour me punir quand j’étais tout petit, étaient très élégantes. Je me souviens d’une robe en satin bleu ciel avec des dentelles dont j’ai récupéré plus tard le tissu pour me faire un costume de théâtre. Toutefois, les vêtements féminins n’ont jamais éveillé en moi un élément trouble. Je n’imaginais pas qu’il pût exister une sensualité féminine ni une sexualité ou la femme et ses artifices aient pu jouer un rôle quelconque. Je n’avais rien d’œdipien. Jusqu’à mon adolescence, et bien que quatre enfants soient nés après moi, je n’ai jamais eu la moindre notion de l’existence de rapports sexuels ou même affectifs entre mes parents. Cet aspect ne transparaissait pas dans l’univers familial. Mon père n’était donc pas un rival. Je n’ai jamais eu la moindre idée que les deux oreillers dans le vaste lit de ma mère, entre lesquels j’aimais venir me blottir, pouvaient être destinés à deux personnes ; j’ai toujours conservé le goût d’avoir deux oreillers dans mon lit.
Bien que j’aie, en somme, peu vécu auprès d’elle, j’avais pour ma mère un attachement profond, peut-être plus que normal, qui fut durement mis à l’épreuve.
Comme tous les gens qui aiment dominer, manier les êtres, elle dispensait ses faveurs avec une habile injustice. Je connus une amère jalousie par suite de la préférence marquée, presque indécente, dont ma mère faisait preuve envers un de ses fils, François-Jehan, plus jeune que moi de cinq ans. Cela se manifestait par des détails. On fêtait peu les anniversaires, mais plutôt ceux des saints dont on portait le nom. Il n’y avait pas de saint Alain dans le calendrier reconnu par l’Église. Je n’avais donc pas de fête et, de plus, mon anniversaire tombait le jour de la Saint-François. Ma mère couvrait mon jeune frère de cadeaux et m’oubliait régulièrement. J’attendais chaque année, avec amertume, l’inévitable.
L’aspect central du caractère de ma mère était sa passion pour « Dieu ». Ce personnage énigmatique avait la priorité sur toutes ses affections humaines. Elle n’agissait que selon ses désirs, ses instructions sur lesquels elle ne semblait entretenir aucun doute. Comme une femme qui a un amant, son mari, ses enfants n’avaient que la seconde place. Pourquoi s’était-elle mariée ? Je ne l’ai jamais tout à fait compris. Ses rapports avec son mari étaient corrects mais ne laissaient transparaître aucune tendresse visible. Elle eut six enfants probablement par devoir plutôt que par désir. Son amour de Dieu primait tout, Du moins semblait-elle convaincue que tout ce qu’elle entreprenait et réussissait remarquablement était la volonté et pour la gloire de ce personnage.
J’étais profondément troublé par la présence de cet intrus invisible. Peut-être était-ce de ma part une jalousie excessive, mais la foi de ma mère me semblait une aberration monstrueuse et, en tous les cas, une trahison. Les chrétiens, comme les marxistes ou les fascistes convaincus, en arrivent à trahir leurs amis, leurs enfants ou leurs frères hérétiques. Je pensais qu’en d’autres temps ma mère m’aurait, avec une profonde et admirable douleur, livré au justicier.
J’avais entendu ma mère, citant je crois la mère de saint Augustin, dire avec componction mais, en fait, avec une légèreté et un manque de psychologie remarquables : « J’aimerais mieux voir mon enfant mort que de le voir commettre un péché mortel. » Dieu apparaissait clairement comme une sorte de beau-père, d’amant, aux fantaisies duquel ma mère était prête à sacrifier son fils. Ayant trop lu la Vie des saints, le côté théâtral et mélodramatique de telles assertions ne semblait pas la gêner. Et si ce Dieu avait ordonné de m’égorger comme Isaac, l’eût-elle fait ? Ou bien mentait-elle pour mieux tenir en main ses fils ? D’une manière comme d’une autre, elle apparaissait dangereuse. Elle s’était livrée corps et âme à ce personnage étrange qui semblait uniquement sexophobe ; le péché mortel, c’était de toucher son sexe, ce qui était pourtant fort agréable. L’obsession de ma mère était de conserver le plus longtemps possible la « pureté » des enfants. Il suffisait donc de créer une enceinte prophylactique en évitant aux enfants tout contact avec la réalité du monde. Cette attitude négative permettait à cette femme, par ailleurs très occupée, de considérer son devoir accompli. Sauf peut-être dans le cas de Jean qu’elle avait su plier à sa volonté, elle échoua singulièrement dans l’éducation de ses enfants. La raison de cet échec fut probablement l’alibi qu’elle donna à sa passion dominatrice. Agir au nom d’un idéal est une méthode efficace en politique comme dans toute forme d’action. Que cet idéal s’appelle Christ, pape, patrie, peuple, marxisme, civilisation, voire humanité, les ambitieux se cachent toujours derrière un mythe. C’est ainsi que l’on fait marcher les masses toujours plus sottement idéalistes que leurs dirigeants.
Mais entre une mère et ses enfants, il n’y a pas de place pour un mythe. Aucune interférence, aucune allégeance n’est admissible. La confiance de l’enfant est totale. La dévotion, la protection maternelle doivent être sans faille, sans restrictions. La mère reste celle qui défend ses petits, fussent-ils crétins, pervers, criminels, auprès de laquelle ils trouveront toujours refuge et protection. Ce ne fut que bien des années plus tard que je découvris, en Italie, dans le peuple, car la bourgeoisie, comme partout, est hypocrite et patriarcale, qu’il existait encore en Occident des mères, des femmes solides et travailleuses qui gèrent la tribu familiale, la nourrissent, l’administrent, la protègent. La maison, fût-elle une baraque ou un réduit, est une forteresse où l’on se réfugie après les mauvais coups ou les bonnes fortunes, où l’enfant prodigue est toujours le bienvenu. La « mamma », comme une tigresse, défend ses petits contre l’État, contre la loi, contre l’Église, contre la société. Une fois passées ses coquetteries de jeune fille ou d’épousée, elle devient la femme, la mère, le pilier de la société. Elle ne va pas chez le coiffeur, elle ne se maquille pas. Elle est le chef qui n’a pas besoin d’artifices. Quelle triste figure font auprès d’elle les féministes qui cherchent à parodier le rôle futile des hommes.
La raison de l’échec de mes relations avec ma mère fut donc essentiellement un conflit avec « Dieu » et avec les principes qu’elle prétendait tenir de lui. Elle cessait soudain d’être mère pour devenir prêtresse. Sa passion pour ce dieu-amant avait toujours la priorité sur le sentiment maternel. Cela fut marque pour moi par de nombreux petits événements apparemment sans importance mais qui laissèrent des blessures profondes.
Enfant tuberculeux, j’avais des crises pulmonaires terribles, des bronchites, des pleurésies. On croyait chaque fois que je ne survivrais pas. Je devais avoir une dizaine d’années lorsque, après m’avoir torturé avec des ventouses et des cataplasmes, le brave Dr Tolmer crut nécessaire d’avertir ma mère qu’il n’y avait plus d’espoir. Maman vint près de mon lit, embrassa son petit tendrement, plus longuement qu’à l’ordinaire, avec des larmes dans les yeux. Puis elle alla à la chapelle de son couvent qui touchait à la maison. Elle en revint après quelque temps calme, tendre et presque souriante. J’eus soudain le sentiment que cette mère admirable avait fait à Dieu le sacrifice de son bien le plus cher, son enfant. J’en conçus une fureur telle que j’en guéris contre toute attente. Mais quelque chose avait changé. Ce salaud d’enfant avait frustré la sainte de son sublime sacrifice. Il était bien normal qu’elle en conçût quelque ressentiment. Je guettais ses signes d’humeur. Peut-être avais-je imaginé toute cette mise en scène. Je n’en ai parlé à personne mais j’y ai songé très longtemps.
On était en Auvergne dans un vieux château Renaissance, je devais avoir quatorze ans, on me soignait en me faisant prendre des bains dans une baignoire en zinc chauffée au soleil, remède suggéré par quelque charlatan naturiste. Je lisais tard le soir, en cachette dans mon lit, avec une lampe électrique, des livres défendus trouvés dans la bibliothèque du château. Avec ma sœur Catherine, nous avions inventé de jouer au jeu des vilains mots. On inventait des mots que l’on croyait grossiers et vulgaires. C’était un jeu idiot, secret, qui fleurait du fruit défendu mais était visiblement sans conséquences. Prise de remords, Catherine alla tout raconter à maman qui prit la chose très au sérieux. Elle me convoqua dans le jardin et me fit un long discours : combien elle était attristée, blessée par ce comportement inqualifiable qui offensait Dieu et mettait en danger l’âme et le salut de ses enfants. Elle insista sur l’influence néfaste du coupable Alain sur sa sœur innocente. Je fus très affecté par cette entrevue. Ma mère avait vraiment joué le grand jeu, la tristesse, la douceur, la confiance trahie. Mais quelques jours plus tard arriva Jean, mon frère aîné, élève des jésuites. Par hasard, j’entendis ma mère lui raconter la chose en riant : « Les enfants disaient des sottises. J’ai dû les mettre un peu au pas. » Je restais effondré. Ma mère m’avait donc menti, s’était jouée de mes sentiments ; ma seule amie, ma sœur m’avait trahi. Jean était un étranger vivant dans un monde inconnu. On se riait de moi avec lui.
Je me retrouvais seul, sans appui, sans amis, sans pouvoir me fier à personne. L’antre maternel, ce refuge absolu que je m’efforçais chaque fois de reconstruire s’était de nouveau effondré. Ma mère, sa morale et son dieu n’étaient que fausseté et perfidie. C’est probablement à partir de ce jour que j’ai cessé de considérer la religion de ma mère comme une valeur possible, son dieu comme une éventuelle réalité. J’ai conservé tout au long de ma vie un souvenir très vif de cet événement insignifiant. Il me fut cependant très utile car j’ai cessé désormais d’avoir des problèmes de religion ou de morale.
À seize ans, on m’interdisait de lire le Lys dans la vallée, livre obscène où l’on parlait trop éloquemment, paraît-il, des seins d’une dame. Je suivais pour quelques mois des cours au collège Sainte-Croix pour préparer mon « bachot ». J’y avais rencontré le fils d’une protégée de ma mère (qui devait devenir le peintre Maillart) qui m’avait prêté les Contes de La Fontaine, livre fort ennuyeux. Ma mère le découvrit et ce fut un scandale. Eplorée, elle me traîna chez mon confesseur, un gros jésuite appelé le père Jalabert. J’ai juré sans effort que je n’avais pas lu le livre et j’ai entendu, peu après, le confesseur rassurer ma mère : « Soyez tranquille ! Il ne l’a pas lu. » Le rite obligatoire de la confession devint une comédie de mensonges sans issue, la communion un perpétuel sacrilège. Mais cela ne me troubla pas, mon lien avec l’Église était rompu. Le brave Maillart qui m’avait quelque peu protégé de la cruauté des autres garçons me tourna le dos désormais.
J’avais vingt et un ans. Je travaillais avec passion la danse et le chant. Expulsé de la maison familiale, j’habitais un minuscule studio sur le boulevard Gouvion-Saint-Cyr dont ma mère avait accepté de payer le loyer en m’exilant. J’avais quelques aventures, quelques amis.
Un jour, ma mère me convoqua pour me dire : « J’ai longuement parlé avec ton oncle Paul. Étant donné la vie que tu mènes, les milieux que tu fréquentes, je n’ai pas le droit moral de t’y aider. » Le mythe divin s’opposait à nouveau à la réalité maternelle, l’Olympe à la terre, la morale se réduisait aux préjugés sociaux dont les hommes attribuent l’origine au diktat d’un dieu mythique ignorant de la réalité du monde. Ce fut une rupture sans heurts, sans esclandre.
Il n’y eut jamais d’éclats entre moi et ma mère, jamais de scène. Elle agissait selon un plan préétabli, théorique et abstrait, qui constituait ce qu’elle considérait comme son devoir et qui était probablement contraire à ses sentiments qu’elle dominait par vertu. Ce qui pouvait paraître une attitude inhumaine était en réalité un sacrifice. Ses rapports avec moi restèrent toujours affectueux même lorsque, selon des principes inflexibles, elle me refusait toute aide, tout moyen de vivre et de me nourrir. Elle aurait éventuellement laissé l’enfant prodigue mourir de faim selon ce principe de vertu héroïque qui passe dans le monde chrétien pour la sainteté (…).
Il a été question de béatifier ma mère. Cela se fera un jour. Elle poussait jusqu’à l’héroïsme, jusqu’à l’inhumanité, la logique de sa foi, souvent contre sa propre nature. Elle fut certainement une sainte femme. Ce qu’elle fut pour moi est autre chose. Elle appartenait à un monde de croyances et d’idées qui n’était pas celui auquel j’étais destiné. En ce sens, elle me rendit certainement un grand service en me libérant du monde où j’étais né.
Pourtant, à la fin de ses jours, elle disait volontiers : « Alain est le plus intelligent de mes enfants. Il sait ce qu’il veut. Il est celui qui me ressemble le plus. » Elle était fière, au fond, du seul de ses enfants qui avait su lui résister.
Récemment, pour quelques remarques sur mon enfance dans une interview, j’ai reçu des lettres d’injures de dames « bien » dont les enfants sont « bien » (disent-elles) et ne sont pas comme moi, le déshonneur de leur famille et le désespoir d’une mère qui a tant souffert par ma faute. Quelle faute ? Je suis ce que je suis. Je n’ai pas demandé à naître. J’ai fait ma vie de mon mieux sans vouloir de mal à personne. Ce n’est visiblement pas le point de vue de ces dragons que sont parfois les mères froides de la bourgeoisie chrétienne.
Yves Navarre, lui aussi ne dans une « bonne famille » de Neuilly, voulut, bien des années plus tard, me rencontrer. Il me dit : « J’étais le canard noir de ma famille. Mais on disait, pour se consoler, il y a des canards noirs dans les meilleures familles, voyez Alain Daniélou. »
L’admiration qu’inspirait ma mère n’était pourtant pas unanime.. Un jour, au cours d’une réception chez l’éditeur Pierre Bérès, dans son appartement de l’avenue Foch, une femme très élégante s’approcha de moi et me dit : « Vous êtes Alain Daniélou, eh bien! je tiens à vous dire que votre mère était une horrible femme. » J’en suis resté quelque peu abasourdi. J’ai appris plus tard que, lorsqu’elle avait voulu divorcer d’un mari particulière ment odieux, ma mère lui avait conseillé de s’arranger, de prendre au besoin un amant, mais d’éviter à tout prix le divorce, le scandale. Cela avait été pour elle visiblement un terrible choc.
J’avais dû me défendre contre ma mère, mais il n’y a jamais eu d’inimitié véritable entre nous. Elle ne manquait pas de tendresse envers moi et j’avais une profonde affection pour elle. Ses dernières lettres sont pleines de douceur. Elle était prisonnière d’une idéologie totalitaire, celle de l‘Église, et je crois que subconsciemment elle était heureuse que j’aie su lui échapper. L’attitude hostile que j’avais dû prendre envers elle s’effaça peu à peu à mesure que je m’intégrais dans un autre mode de pensée, une autre religion, une autre conception de la vie et de la mort, et disparut complètement lorsqu’il ne resta plus aucune trace en moi de l’héritage chrétien. Si cela avait été nécessaire, j’aurais pu la protéger, la bercer sans tenir aucun compte de ses idées comme on ignore les sottises d’un enfant. Je ne me rendis compte que trop tard de ma force, de ma sécurité intérieure. Elle avait déjà disparu. Elle mourut le 13 octobre 1956. J’étais alors à Pondichéry. Je ne suis jamais allé sur sa tombe.
Bonus :