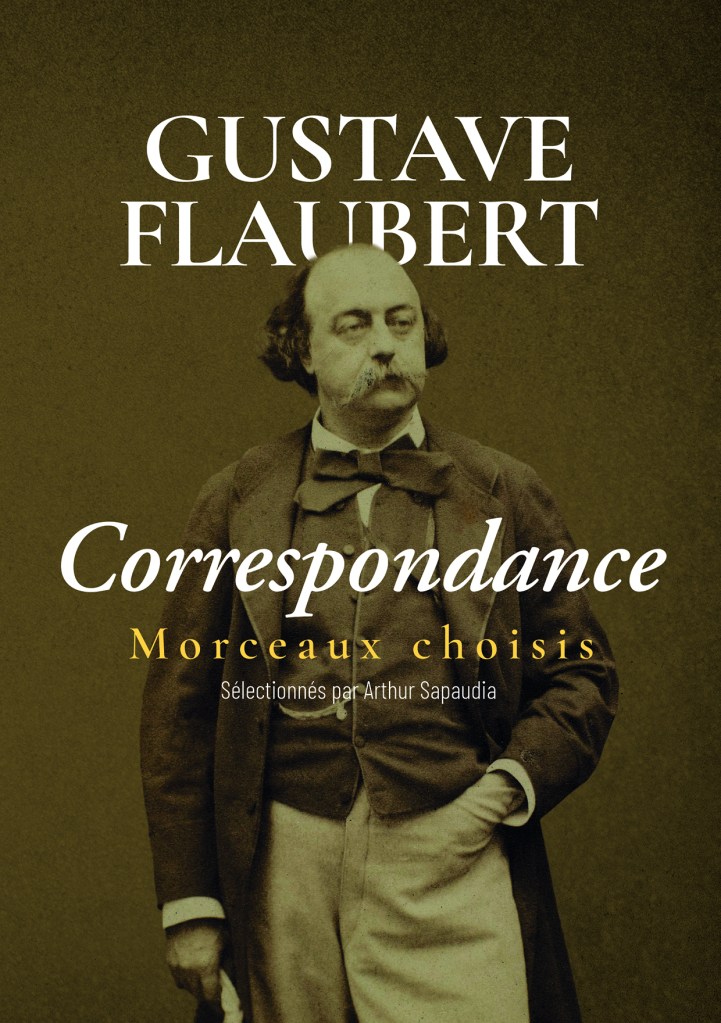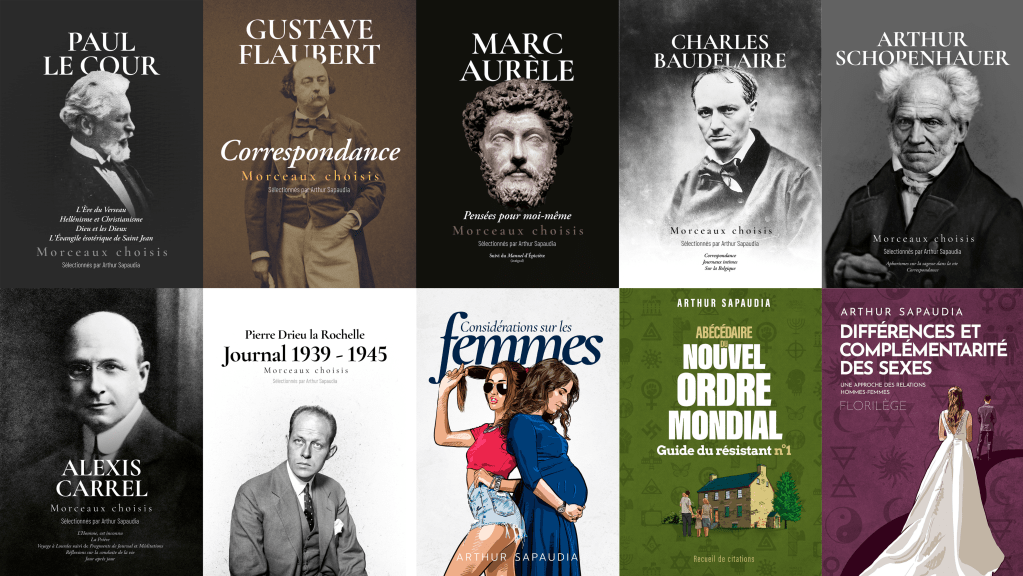Extrait de mon livre Gustave Flaubert, Correspondance, Morceaux choisis
À sa mère, Le Caire, 14 décembre 1849 ( âge : 28 ans)
(…) Le soleil s’est enfin décidé à me culotter la peau, je passe au bronze antique (ce qui me satisfait), j’engraisse (ce qui me désole), ma barbe pousse comme une savane d’Amérique. Je dors des 12 heures de suite sans me réveiller, enfin j’ai l’air d’un vieux roquentin, d’un vieux mâtin. J’ai une bonne boule et suis satisfait de moi. Quant à la vanité, rassure-toi, pauvre vieille ; je ne suis pas encore ivre d’encens et je crois qu’au retour je ne ferai pas semblant de ne pas te reconnaître. (…)
Voilà donc 6 jours que nous avons passés à peu près entièrement dans le désert, couchant sous la tente, vivant avec les Bédouins (lesquels sont très gais et les meilleurs gens du monde), mangeant des tourterelles, buvant du lait de buffle, et entendant la nuit glapir ces vieux chacals, que nous voyons le soir et le matin galoper entre les monticules de sables voisins.
J’adore le désert ; l’air y est sec et vif comme celui des bords de la mer : rapprochement d’autant plus juste qu’en passant la langue sur sa moustache, on se sale le palais ; on y respire à pleins poumons. (…)
Pour te rassurer dès à présent quant au désert (relativement à notre voyage du Sinaï que nous ferons vers le mois d’avril probablement), apprends, pauvre vieille, qu’il n’y a, dans le désert, ni ophtalmie, ni dysenterie, ni fièvre. Il n’y a rien et puis c’est tout. Le seul danger sérieux est d’y crever de faim ou de soif, quand on n’a pas de provisions. (…)
Nous sommes arrivés au bas de la colline où se trouvent les Pyramides, il y a aujourd’hui huit jours (vendredi), à 4 heures du soir. C’est là que commence le désert. Ç’a été plus fort que moi, j’ai lancé mon cheval à fond de train, Maxime m’a imité, et je suis arrivé au pied du Sphinx. En voyant cela (qui est indescriptible, il faudrait 10 pages, et quelles pages !), la tête m’a un moment tourné, et mon compagnon était blanc comme le papier sur lequel j’écris. Au coucher du soleil, le Sphinx et les trois Pyramides toutes roses semblaient noyés dans la lumière ; le vieux monstre nous regardait d’un air terrifiant et immobile. Jamais je n’oublierai cette singulière impression. Nous y avons couché trois nuits, au pied de ces vieilles bougresses de Pyramides, et franchement c’est chouette. Plus on les voit, plus elles paraissent grandes.
⁂
À Louis Bouilhet, au-delà de Syène [Assouan], 13 mars 1850
(…) Si tu t’attends à une lettre un peu propre, tu te trompes. Je t’avertis très sérieusement que mon intelligence a beaucoup baissé. Cela m’inquiète, ce n’est pas une plaisanterie, je me sens très vide, très aplati, très stérile. Qu’est-ce que je vais faire une fois rentré au gite, publierais-je, ne publierais-je ? (…)
Nous vivons, comme tu le vois, dans une paresse crasse, passant toutes nos journées couchés sur nos divans à regarder ce qui se passe, depuis les chameaux et les troupeaux de bœufs du Sennaâr jusqu’aux barques qui descendent vers Le Caire chargées de négresses et de dents d’éléphants. Nous sommes maintenant, mon cher Monsieur, dans un pays où les femmes sont nues, et l’on peut dire avec le poète « comme la main », car pour tout costume elles n’ont que des bagues.
J’ai baisé des filles de Nubie qui avaient des colliers de piastres d’or leur descendant jusque sur les cuisses, et qui portaient sur leur ventre noir des ceintures de perles de couleur. Et leur danse ! sacré nom de Dieu !!! (…)
À Medinet-el-Fayoun nous avons logé chez un chrétien de Damas qui nous a donné l’hospitalité. Il y avait chez lui, logeant comme commensal habituel, un prêtre catholique qui m’a tout l’air de piner la dame du lieu. Ô les prêtres ! D’abord i se nourrissent mieux que nous. Si celui-là ne se nourrissait pas mal, il buvait mieux. Sous prétexte que les musulmans ne prennent pas de vin, ces braves chrétiens se gorgent d’eau-de-vie. La quantité de petits verres que l’on siffle par confraternité religieuse est incroyable. Notre hôte était un homme un peu lettré, et comme nous étions dans le pays de saint Antoine nous avons causé de lui, d’Arius, de saint Athanase, etc. Le brave homme était ravi. (…)
Quand on voyage ainsi par terre, le soir vous couchez dans des maisons de boue desséchée, dont le toit en cannes à sucre vous laisse contempler les étoiles. À votre arrivée, le sheik chez lequel vous logez fait tuer un mouton, les principaux du pays viennent vous faire une visite, et vous baiser les mains l’un après l’autre. On se laisse faire avec un aplomb de grand sultan, puis on se met à table, c’est-à-dire le cul par terre tous en rond autour du plat commun, dans lequel on plonge les mains, déchiquetant, mâchant, et rotant à qui mieux mieux. C’est une politesse du pays, il faut roter après les repas. Je m’en acquitte mal. En revanche je pète beaucoup et vesse encore plus.
De retour à Benisouëf nous avons tiré un coup (ainsi qu’à Siout) dans une hutte si basse qu’il fallait ramper pour y entrer. On ne pouvait s’y tenir que courbé ou à genoux. On baisait sur une natte de paille, entre quatre murs de limon du Nil sous un toit de bottes de roseaux, à la lumière d’une lampe posée dans l’épaisseur de la muraille. (…)
Sur le haut d’une montagne dominant le Nil se trouve un couvent de Coptes. Ils ont l’habitude, dès qu’ils aperçoivent une cange de Voyageurs, de descendre de leur montagne, de se foutre à l’eau et de venir à la nage vous demander l’aumône. On en est assailli. Vous voyez ces gaillards tout nus descendre les rochers à pic, et nager vers vous à toute force de jarret en criant tant qu’ils peuvent : « batchis, batchis, cawadja christiani » = « Donnez-nous de l’argent. Monsieur chrétien », et comme en cet endroit il y a beaucoup de cavernes, l’écho répète avec un bruit de canon : cawadja, cawadja… Les vautours et les aigles volent sur vos têtes, le bateau file sur l’eau avec ses deux grandes voiles étendues.
En ce moment-là, un de nos matelots (le grotesque du bord) dansait tout nu une danse lascive qui consistait à essayer de s’enculer soi-même. Pour chasser les moines chrétiens, il leur a présenté son vi et son cul en faisant mine de leur pisser et chier sur la tête (ils étaient cramponnés au bordage de la cange). Les autres matelots leur criaient des injures avec les noms répétés d’Allah et de Mohammed. Les uns leur foutaient des coups de bâton, d’autres des coups de cordes, Joseph tapait dessus avec les pincettes de la cuisine. C’était un tutti de calottes, de vis, de culs nus, de gueulades et de rires. Dès qu’on leur a donné quelque argent, ils le mettent dans leur bouche et remontent chez eux par le même chemin. – Si on ne leur administrait ainsi de bonnes rossées, on se trouverait assailli d’une telle quantité qu’il y aurait danger de faire chavirer la cange. (…)
J’ai fait à Keneh quelque chose de convenable et qui, je l’espère, obtiendra ton approbation : nous avions mis pied à terre pour faire quelques provisions et nous marchions tranquillement dans les bazars, le nez en l’air, respirant l’odeur de santal qui circulait autour de nous, quand, au détour d’une rue, voilà tout à coup que nous tombons dans le quartier des garces. Figure-toi, ami, cinq ou six rues courbes avec des maisons hautes de 4 pieds environ, bâties de limon gris desséché. Sur les portes, des femmes debout, ou se tenant assises sur des nattes.
Les négresses avaient des robes bleu ciel, d’autres étaient en jaune, en blanc, en rouge, – larges vêtements qui flottent au vent chaud. Des senteurs d’épices avec tout cela ; et sur leurs gorges découvertes de longs colliers de piastres d’or, qui font que, lorsqu’elles se remuent, ça claque comme des charrettes. Elles vous appellent avec des voix traînantes: « Cawadja, Cawadja » ; leurs dents blanches luisent sous leurs lèvres rouges et noires ; leurs yeux d’étain roulent comme des roues qui tournent. – Je me suis promené en ces lieux et repromené, leur donnant à toutes des batchis, me faisant appeler et raccrocher ; elles me prenaient à bras-le-corps et voulaient m’entraîner dans leurs maisons… Mets du soleil par là-dessus. Eh bien ! je n’ai pas baisé (le jeune Du Camp ne fit pas ainsi), exprès, par parti pris, afin de garder la mélancolie de ce tableau et faire qu’il restât plus profondément en moi. Aussi je suis parti avec un grand éblouissement, et que j’ai gardé. Il n’y a rien de plus beau que ces femmes vous appelant. Si j’eusse baisé, une autre image serait venue par-dessus celle-là et en aurait atténué la splendeur.
Je n’ai pas toujours mené avec moi un artistisme si stoïque. À Esneh j’ai en un jour tiré 5 coups et gamahuché 3 fois. Je le dis sans ambage ni circonlocution. J’ajoute que ça m’a fait plaisir. Kuchuk-Hanem est une courtisane fort célèbre. Quand nous arrivâmes chez elle (il était 2 heures de l’après-midi), elle nous attendait, sa confidente était venue le matin à la cange, escortée d’un mouton familier tout tacheté de henné jaune, avec une muselière de velours noir sur le nez et qui la suivait comme un chien. C’était très farce. (…)
C’est une impériale bougresse, tétonneuse, viandée, avec des narines fendues, des yeux démesurés, des genoux magnifiques, et qui avait en dansant de crânes plis de chair sur son ventre. Elle a commencé par nous parfumer les mains avec de l’eau de rose. Sa gorge sentait une odeur de térébenthine sucrée. Un triple collier d’or était dessus. On a fait venir les musiciens et l’on a dansé. (…) En général les belles femmes dansent mal. J’en excepte une Nubienne que nous avons vue à Assouan. Mais ce n’est plus la danse arabe, c’est plus féroce, plus emporté. Ça sent le tigre et le nègre.
Le soir, nous sommes revenus chez Kuchuk-Hanem. Il y avait 4 femmes danseuses et chanteuses, almées (le mot almée veut dire savante, bas-bleu. Comme qui dirait putain, ce qui prouve, Monsieur, que dans tous les pays les femmes de lettres !!…).
La feste a duré depuis 6 heures jusqu’à 10 heures 1/2, le tout entremêlé de coups pendant les entractes. (…) Quand il a fallu partir, je ne suis pas parti. Kuchuk ne se souciait guère de nous garder la nuit chez elle, de peur des voleurs qui auraient bien pu venir, sachant qu’il y avait des étrangers dans sa maison. Maxime est resté tout seul sur un divan, et moi je suis descendu au rez-de-chaussée dans la chambre de Kuchuk. Nous nous sommes couchés sur son lit fait de cannes de palmier. Une mèche brûlait dans une lampe de forme antique suspendue à la muraille. Dans une pièce voisine, les gardes causaient à voix basse avec la servante, négresse d’Abyssinie qui portait sur les deux bras des traces de peste. Son petit chien dormait sur ma veste de soie.
Je l’ai sucée avec rage ; son corps était en sueur, elle était fatiguée d’avoir dansé, elle avait froid. Je l’ai couverte de ma pelisse de fourrure, et elle s’est endormie, les doigts passés dans les miens. Pour moi, je n’ai guère fermé l’œil. J’ai passé la nuit dans des intensités rêveuses infinies. C’est pour cela que j’étais resté. En contemplant dormir cette belle créature qui ronflait la tête appuyée sur mon bras, je pensais à mes nuits de bordel à Paris, à un tas de vieux souvenirs… et à celle-là, à sa danse, à sa voix qui chantait des chansons sans signification ni mots distinguables pour moi. Cela a duré ainsi toute la nuit. À 3 heures je me suis levé pour aller pisser dans la rue ; les étoiles brillaient. Le ciel était clair et très haut. (…)
Nous sommes arrêtés dans ce moment faute de vent. Les mouches me piquent la figure ; le jeune Du Camp est parti faire une épreuve ; il réussit assez bien ; nous aurons, je crois, un album assez gentil. Quant au vice, il se calme. Il nous semble que j’hérite de ses qualités, car je deviens cochon. Je le sens profondément. Si le cerveau baisse, la pine se relève. (…)
Si tu veux savoir l’état de nos boules, nous sommes couleur de pipe culottée. Nous engraissons, la barbe nous pousse.
⁂
À Théophile Gautier, Jérusalem, lundi 13 août 1850
Je vous embrasse, cher maître, tout le long de cette page blanche que Maxime me laisse. (…)
De Beyrouth à Jaffa il y a des bois de lauriers roses poussés tout au bord de la mer.
Au Caire j’ai vu un singe masturber un âne. L’âne se débattait, le singe grinçait des dents, la foule regardait, c’était fort.
Demain matin au soleil levant nous partons pour Jéricho et la mer Morte. Nous allons donc voir la place où fut Sodome. Quelles idées ça va faire naître en nous ! ?
⁂
À Louis Bouilhet, Constantinople, 14 novembre 1850
Si je pouvais t’écrire tout ce que je réfléchis à propos de mon voyage, c’est-à-dire que si je retrouvais quand je prends la plume les choses qui me passent dans la tête et qui me font dire, à part moi : « je lui écrirai ça », tu aurais vraiment peut-être des lettres amusantes. Mais, va te faire foutre, cela s’en va aussitôt que j’ouvre mon carton. N’importe, au hasard de la fourchette, comme ça viendra. (…)
Nous avons passé (rien de plus) dans la rue des bordels d’hommes. J’ai vu des bardaches qui achetaient des dragées, sans doute avec l’argent de leur cul, l’anus allait rendre à l’estomac ce que celui-ci lui procure d’ordinaire. (…)
Mon genre d’observation est surtout moral. Je n’aurais jamais soupçonné ce côté au Voyage. Le côté psychologique, humain, comique y est abondant. (…)
De temps à autre, dans les villes, j’ouvre un journal. Il me semble que nous allons rondement. Nous dansons non pas sur un volcan, mais sur la planche d’une latrine qui m’a l’air passablement pourrie. La société prochainement ira se noyer dans la merde de dix-neuf siècles, et l’on gueulera raide. L’idée d’étudier la question me préoccupe. J’ai envie (passe-moi la présomption) de serrer tout cela dans mes mains, comme un citron, afin d’en aciduler mon verre. À mon retour j’ai envie de m’enfoncer dans les socialistes et de faire sous la forme théâtrale quelque chose de très brutal de très farce et d’impartial bien entendu. J’ai le mot sur le bout de la langue et la couleur au bout des doigts. (…)
Pourquoi la mort de Balzac m’a-t-elle vivement affecté ? Quand meurt un homme que l’on admire on est toujours triste. – On espérait le connaître plus tard et s’en faire aimer. Oui, c’était un homme fort et qui avait crânement compris son temps. – Lui qui avait si bien étudié les femmes, il est mort dès qu’il a été marié, et quand la société qu’il savait a commencé son dénouement.
Voir également : Gustave Flaubert – Correspondance