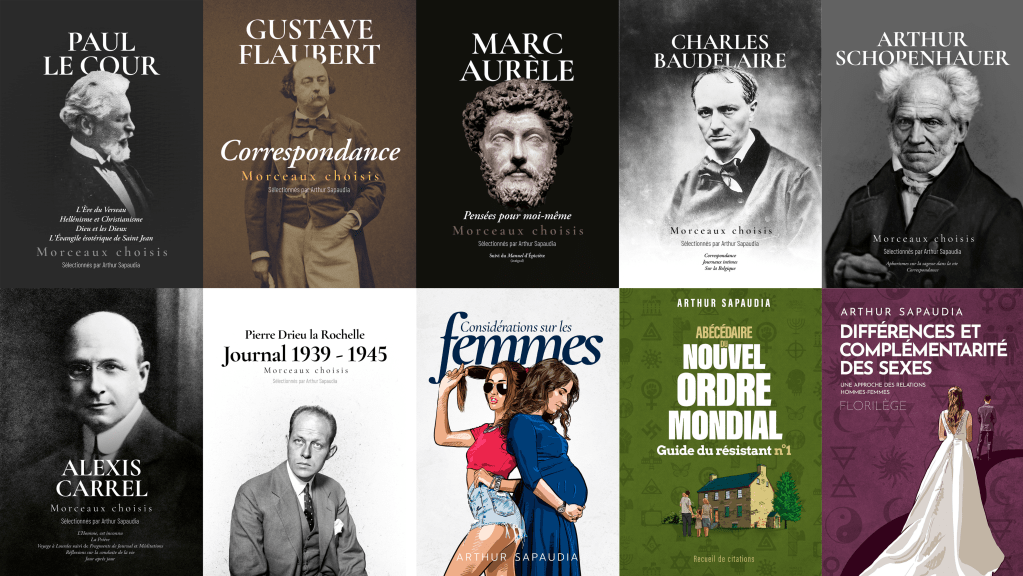Revue Totalité n°8, 1979. Article paru initialement dans Vie della Tradizione, III, N°12, 1973. Traduit de l’italien par Philippe Baillet.
On raconte que dans une terre non européenne, mais de vieille culture, une entreprise américaine, déplorant le maigre concours des habitants du lieu recrutés pour les travaux, pensa avoir trouvé le moyen apte à les pousser au travail : elle leur doubla les salaires horaires. Peine perdue : la plupart des ouvriers se présentèrent au travail pour moitié moins d’heures qu’avant. Jugeant le premier salaire suffisant pour les besoins normaux de leur vie, ils pensaient donc qu’il était complètement absurde de devoir travailler plus que ce qui suffisait, sur la base du nouveau tarif, pour gagner sa vie.
C’est là l’antithèse de ce qui a été appelé récemment, chez nous, le stakhanovisme. Cette anecdote peut servir d’instrument de comparaison entre deux mondes, deux mentalités, deux civilisations, qu’il faut juger saine et normale l’une, déviée et psychotique l’autre.
Parce que nous nous sommes référés à une région non européenne, qu’on ne nous oppose pas ici les lieux communs sur l’inertie ou l’indolence de races qui diffèrent de la race occidentale activiste s et dynamique. Ici comme en d’autres domaines, ces objections n’ont aucune raison d’être : il suffit de se détacher de la civilisation « moderne » pour retrouver chez nous également, en Occident, les mêmes conceptions de la vie, la même attitude, la même appréciation du gain et du travail.
Avant l’avènement en Europe de ce qui a été appelé officiellement et de manière significative l’ « économie marchande » (significative car on sait quel cas l’on fit, dans la hiérarchie sociale traditionnelle, des types du marchand et du prêteur d’argent), à partir de laquelle le capitalisme moderne devait se développer rapidement, le critère fondamental dans l’économie était que les biens extérieurs doivent être sujets à une certaine mesure, que la recherche du gain n’est excusable et licite que si elle sert à assurer une subsistance correspondant au rang. Par conséquent, l’économie normale était essentiellement une économie de consommation. Telle était aussi la conception thomiste ; et telle fut, plus tard, la conception luthérienne elle-même.
L’important était que l’individu reconnût son appartenance à un groupe donné et l’existence de limites ou de cadres déterminés et fixes, à l’intérieur desquels il devait développer ses possibilités, réaliser sa vocation, tendre à une perfection partielle spécifique. L’ancienne éthique corporative également n’était pas différente, dans laquelle étaient mises en relief les valeurs de la personnalité et de la qualité et où, de toute façon, la quantité de travail était toujours fonction d’un degré déterminé de besoins normaux. En général, le concept de progrès était alors appliqué à un plan essentiellement intérieur, et non au fait de sortir de son rang pour rechercher le gain et de multiplier la quantité de travail pour atteindre une position extérieure, économique et sociale, qui ne fût pas celle qu’on avait en propre.
Toutes ces vues furent donc des vues parfaitement occidentales : les vues de l’homme européen, quand il était encore sain, non encore mordu par la tarentule, non encore succube de l’agitation insensée et de l’hypnose de l’ « économie » qui devaient le conduire jusqu’aux désordres, aux crises et aux paroxysmes de la civilisation actuelle. Aujourd’hui, on abandonne tel ou tel système, on cherche tel ou tel palliatif, mais personne ne se reporte à l’origine. Le fait de reconnaitre que, dans l’économie également, les facteurs premiers sont les facteurs spirituels ; qu’un changement d’attitude, qu’une véritable metanoia est le seul moyen efficace si l’on veut encore concevoir un arrêt sur la pente, tout cela va au-delà de l’intellect des technocrates, qui en sont désormais arrivés à proclamer que « l’économie c’est notre destin ».
Mais où mène donc la voie par laquelle l’homme se trahit, renverse toute juste hiérarchie de valeurs et d’intérêts, se concentre sur l’extériorité et la recherche du profit, de la production, fait du facteur économique en général le thème prédominant de son âme ? On ne le sait que trop bien. Peut-être Sombart est-il celui qui, mieux qu’aucun autre, a analysé le processus dans son ensemble. Celui-ci débouche fatalement dans ces formes du grand capitalisme industriel, où l’on est condamné à une course sans trêve et à une expansion illimitée de la production, parce que tout arrêt signifierait immédiatement revenir en arrière et reviendrait souvent à être déséquilibré ou renversé. D’où des processus économiques en chaîne, qui prennent le grand entrepreneur corps et âme, qui le lient plus que le dernier de ses ouvriers, tandis que le courant, devenu quasiment autonome, entraine avec lui des milliers d’êtres et finit par dicter ses lois aux peuples et aux gouvernements. Fiat productio, pereat homo, comme l’écrivit justement Sombart.
Ceci dévoile, entre autres choses, les coulisses même de l’œuvre de « libération » et d’aide américaine au monde. Nous en sommes au point quatre de Truman qui, débordant d’amour désintéressé, veut « l‘élévation économique des zones les plus arriérées de la terr » -, en d’autres termes : conduire à terme les nouvelles invasions barbares, l’abrutissement dans les activités triviales de l’économie de ces pays qu’un heureux concours de circonstances a encore préservés de la morsure de la tarentule, a encore conservés dans une ambiance traditionnelle de vie, a encore écartés de l’exploitation économique et a productive à outrance de chaque possibilité de l’homme et de la nature.
Mutatis mutandis, se poursuit le système de ces premières compagnies commerciales qui se faisaient accompagner de canons pour persuader du commerce ceux qui n’y avaient aucun intérêt.
L’éthique se résumant dans le principe abstine et substine a été occidentale ; mais la trahison de cette éthique a également été occidentale, trahison au profit d’une conception de la vie qui, au lieu de maintenir le besoin dans des limites naturelles en vue de la poursuite de ce qui est vraiment digne de l’effort humain, a pour l’idéal l’accroissement et la multiplication artificielle du besoin lui-même, et par conséquent des moyens pour le satisfaire, sans égard pour l’esclavage croissant que cela va représenter, d’abord pour l’individu, ensuite pour la collectivité, par la force d’une loi inéluctable. Que, sur cette base, il n’y ait plus aucune stabilité, que tout se désintègre et que ce qu’on appelle la « question sociale », déjà faussée au départ par d’impossibles prémisses, s’exaspère autant que communisme et bolchévisme le désirent, cela ne doit donc pas surprendre.
Par ailleurs, on en est aujourd’hui arrivé à un point tel que toute autre vision semble « anachronique », « anti-historique ». Les belles paroles, les impayables paroles ! Mais que l’on revienne seulement à la normalité, et il serait alors évident que, pour l’individu, il n’y a pas d’accroissement extérieur, « économique », qui vaille la peine, et à la flatterie duquel il ne doive résister de façon absolue, quand la contrepartie en est la réduction essentielle de sa liberté ; qu’il n’y a aucun prix qui puisse payer un espace libre, une respiration libre, capables de permettre de se retrouver soi-même, d’être soi-même, d’atteindre ce que chacun peut atteindre par-delà la sphère conditionnée par la matière et par les besoins de la vie ordinaire.
Il en va de même des nations, spécialement lorsque leurs ressources sont limitées. Ici, l’ « autarcie » est un principe éthique, parce que, pour un individu et pour un Etat, ce qui pèse le plus sur la balance des valeurs doit être identique : mieux vaut renoncer au fantasme d’une amélioration illusoire des conditions générales et adopter, là où il le faut, un système d’austerity, plutôt que de se mettre sous le joug d’intérêts étrangers, de se laisser entrainer dans les processus mondiaux d’une hégémonie et d’une productivité économique lancées sans retenue et qui, à la fin, lorsqu’elles ne trouveront plus prise, se retourneront contre ceux-là mêmes qui leur ont donné naissance.
Tout cela devient évident pour celui qui réfléchit sur la morale comprise dans la simple anecdote rapportée au début. Deux mondes, deux mentalités, deux destins. Face aux « mordus par la tarentule » se tiennent ceux qui savent encore se souvenir de ce qui est activité juste, effort droit, chose digne d’être poursuivie, fidélité à soi-même. Les « réalisateurs », les êtres vraiment debout, ce sont eux, et eux seuls.