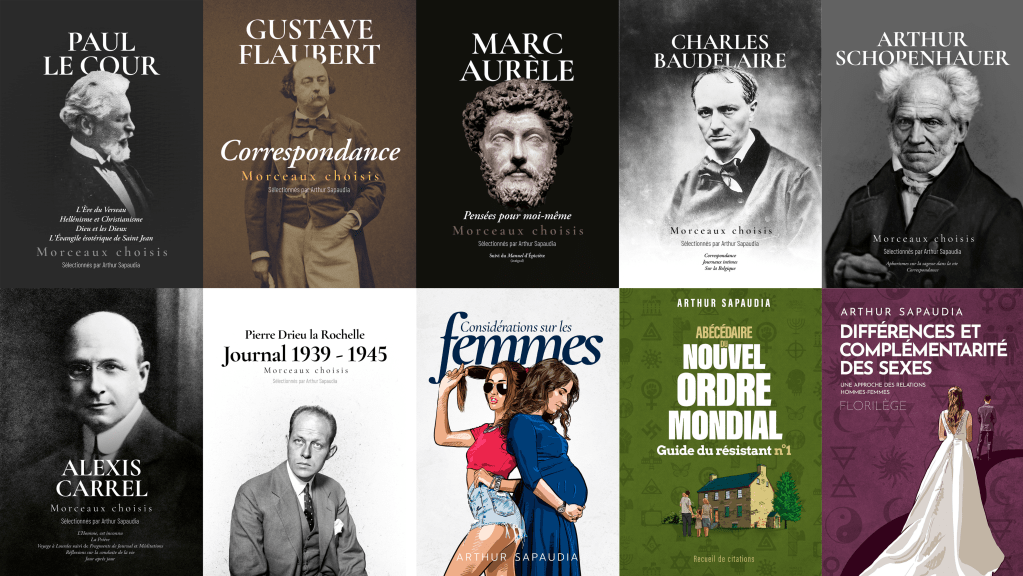Extrait de Histoire et tradition des Européens, 2011

Genèse du nihilisme
Les Anciens croyaient que l’homme ajoute à sa part « animale » une part « divine » qui le distingue et dirige la première. Dans le Timée (§70-71), Platon identifie trois parties de l’âme et du corps, analogues aux trois classes de sa République. En cela il est fidèle à la tradition indo-européenne de l’équilibre hiérarchique entre trois fonctions fondamentales qui règlent l’ordre du cosmos. La première fonction s’incarne dans la partie divine, placée dans la tête, acropole de la connaissance et de la spiritualité. Elle est supérieure aux deux autres parties. L’une, localisée dans le cœur, se rapporte à l’action et au courage guerrier. Elle est l’alliée de la première pour maintenir sous le joug la troisième fonction, localisée dans le ventre, siège des appétits et des désirs. Platon la décrit par l’image d’une bête sauvage enchaînée à sa mangeoire.
À la suite d’un renversement complet, cette partie « désirante » est devenue dominante dans le monde du nihilisme, dictant sa loi aux deux premières fonctions qui n’existent plus que pour mémoire. Dans la hiérarchie des valeurs, l’inférieur commande donc au supérieur.
Cela ne s’est pas fait en un jour. Ce fut l’effet imprévisible d’une fracture fondamentale dans notre histoire.
Si l’on tentait de reconstituer la lente évolution ayant conduit au nihilisme, l’une des étapes serait associée à Thomas d’Aquin. L’œuvre considérable du Docteur angélique eut une double conséquence.
Poursuivant l’effort des Pères de l’Église, il a perverti l’esprit de la philosophie antique qui proposait une sagesse de vie. Il en a fait l’auxiliaire de la théologie. Simultanément, il a introduit la logique rationnelle d’Aristote dans la pensée chrétienne. Innovation qui allait engendrer le rationalisme moderne. Le principe de raison, mis en évidence depuis la philosophie milésienne, n’avait pas eu les mêmes conséquences dans l’Antiquité. Ayant pour vocation de découvrir les lois de la nature afin d’atteindre à la sagesse par la connaissance, la raison antique ne prétendait nullement détenir la Vérité, a fortiori l’imposer. Dans un monde catholique, fondé, lui, sur la croyance en une seule Vérité, et soumis spirituellement à l’autorité absolue de l’Église, il en allait autrement. Pour comprendre le télescopage intellectuel qui s’ensuivit, il faut revenir en arrière.
Aux premiers siècles de notre ère, quand ils furent confrontés au christianisme naissant, les Romains dénoncèrent dans cette religion une forme d’athéisme. Cela nous surprend parce que nous avons oublié la logique du polythéisme. Nier l’existence des dieux multiples et nombreux présents dans la nature au profit d’un seul, étranger de surcroît au cosmos, cela revenait pourtant à détruire la présence foisonnante du divin dans le monde, dans les sources et les bois, l’amour et l’action. Cela conduisait à ne plus voir dans la nature et la vie que leur matérialité. En concentrant tout le sacré dans un seul Dieu extérieur à la création, en pourchassant les anciens cultes réputés idolâtres, le christianisme fit de l’ancienne Europe comme une table rase. Ne subsistait plus que le Dieu unique et abstrait. Et du jour où l’existence de ce Dieu devint dépendante de la raison — effet involontaire du thomisme —, le risque s’ouvrit de le voir réfuter par la raison, ne laissant derrière lui que le vide.
L’étape suivante fut le cartésianisme. Chez saint Thomas d’Aquin, la raison s’associait étroitement à la foi pour en démontrer la justesse.
Chez Descartes, elle se satisfait d’elle-même. « Je pense, donc je suis. » L’homme se pense comme « sujet » central de l’univers. Préparée par la désacralisation chrétienne de la nature, la voie était ouverte à la raison calculatrice, à la volonté de puissance des sciences et de la technique, à la religion du Progrès, substitut profane de la Providence.
Après la mise à mort des dieux et de la sagesse antique, après l’évacuation ultérieure du Dieu chrétien, il ne restait plus que le néant, c’est-à-dire le nihilisme. Par un paradoxe saisissant, la religion du Dieu unique avait conduit à la forme la plus négative de l’athéisme.
De Machiavel à Hobbes
Parallèlement au mouvement des idées, s’était dessinée une transformation de l’ordre politique féodal qu’avait longtemps irrigué une éthique sacrée sans lien avec la religion officielle. Parmi les causes multiples du changement, on ne peut ignorer la lutte menée par l’Église contre le principe spirituel incarné par l’Empire et la chevalerie (…). Dans ce conflit, la papauté soutint les communes italiennes et les monarchies indépendantes. Celles-ci se révélèrent des alliées dangereuses, dans la mesure où elles cherchaient à se donner des fondements propres en dehors de la foi. La France montra la voie dès le XIVe siècle avec l’élaboration par ses légistes d’une légitimation rationnelle de la souveraineté. Du changement qui s’opéra dans l’esprit du temps, Le Prince de Machiavel (1513) est un signe qui fait date.
Mais, il est porteur de deux significations contradictoires. Le prince, c’est-à-dire l’État moderne, manifeste un retour à la religiosité antique de la cité, ce qui est louable. Inversement, comme l’État paraît être à lui-même sa propre justification, cela semble autoriser toutes les fourberies, toutes les violences, tous les crimes. Prendre cette interprétation courante au pied de la lettre serait cependant une erreur. Une autre considération a pesé sur la pensée du conseiller florentin.
Les princes, chrétiens ou non, n’avaient pas attendu Machiavel pour être parjures ou cruels. Mais pour la première fois les vices du pouvoir semblaient être érigés en principes. C’était une conséquence imprévue de la vision chrétienne qui, à la différence de la pensée antique, associait la nature humaine au mal, fruit du péché. Bien que lui-même détaché du christianisme, Machiavel restait imprégné de pessimisme chrétien : « Il faut que le fondateur d’État et le législateur supposent par avance que tous les hommes sont méchants et sont prêts à mettre en œuvre leur méchanceté toutes les fois qu’ils en auront l’occasion. » C’est pourquoi les hommes étant fourbes, « jamais à un prince n’ont manqué des motifs légitimes de farder son manque de parole ».
Ni Aristote ni aucun des Anciens n’ignoraient les bassesses humaines, mais ils ne croyaient pas que tout, chez les hommes, se résumait à ces bassesses et que sur elles seules devaient se fonder les lois et la cité.
Enregistrons l’interprétation de Machiavel sans pour autant le méjuger. La hauteur des intentions du conseiller florentin n’est pas en cause. Vivant dans une époque de chaos et de mort, songeant aux glorieux souvenirs de l’Antiquité, aimant sa patrie « plus que son âme », il rêvait de voir surgir le « rédempteur » de l’Italie. Il savait qu’« un homme qui veut être bon, toujours bon, court à sa perte, au milieu de tant d’hommes qui ne le sont pas ». De son pessimisme et de l’étude historique, il tira un réalisme politique qui fait écho à la conception nouvelle et laïque du droit des États et du droit des gens européens conçu à la même époque et que n’auraient reniée ni Platon ni Aristote (…). Ce droit des gens s’imposa en Europe après la guerre de Trente Ans, et se maintint jusqu’aux catastrophes du XXe siècle. L’éloge du cynisme et de la volonté de puissance contenu dans Le Prince restait implicitement subordonné à la finalité supérieure du bien public, celui de la cité ou de l’État.
Le basculement vers le nihilisme s’effectua au siècle suivant à travers l’œuvre de Thomas Hobbes et de ses successeurs. L’auteur du Léviathan s’inscrivait dans une double filiation, celle du rationalisme de Descartes et celle du calvinisme. « Ma doctrine, écrit-il dans son Autobiographie (1679), diffère de la pratique des pays qui ont reçu d’Athènes et de Rome leur éducation morale. » Allant jusqu’au bout de la rupture avec la sagesse antique qui postulait la conformité du bien avec la nature et de celle-ci avec la perfection, il écrit dès l’ouverture du Léviathan (1651) : «La nature est une création artificielle de Dieu. » Hormis le Dieu biblique, étranger par définition à la nature, tout est artificialité, donc tout est révocable. L’homme n’est pas un être social par nature comme l’avait établi Aristote. Selon Hobbes l’état de nature est le chaos, la guerre de tous contre tous. Dès lors, la conservation de soi est la valeur suprême et chaque individu agit égoïstement pour sa conservation. Il n’y a pas de norme supérieure à cet égoïsme fondamental.
Comme chez Machiavel, on rejoint ici le pessimisme chrétien à l’égard de la nature humaine. Mais chez Hobbes, en un autre temps, sous d’autres influences, ce pessimisme renversé donne naissance à la morale utilitariste, antichambre du matérialisme moderne. L’homme, dit-il, n’agit que pour rechercher le plaisir et fuir la douleur. Ses sentiments moraux ne sont que le maquillage de son égoïsme, et il faut s’en féliciter.
Le stade ultérieur de cette évolution nihiliste sera illustré par Adam Smith, Jeremy Bentham, Stuart Mill et Karl Marx, qui théoriseront chacun à leur façon que l’intérêt et donc le désir, celui des individus ou des classes, sont à la fois le ressort et la norme du comportement humain, de l’histoire et de l’organisation sociale. En fin de cycle, s’épanouit l’idée que la matière détermine la conscience. Ainsi, après que se fut accompli le parcours imprévu du pessimisme chrétien au matérialisme, le moment allait venir où serait sacralisé l’homme vil et avili.
Est-ce à dire que le nihilisme avait changé la nature des hommes ? Par ses travaux, Mircea Eliade a apporté une réponse. Il a renouvelé l’interprétation des mythes et des religions, montrant que les hommes, quelles que soient leurs origines ou leur culture, se distinguent des animaux les plus évolués par leur besoin de sens, par le besoin de donner une signification à leur existence et à celle du monde. Autrement dit, les hommes ne peuvent vivre dans le chaos ou le néant. Même quand ils affichent la plus complète indifférence, ils éprouvent le besoin irrépressible d’interpréter et d’ordonner l’univers, le cosmos des Anciens, même si cela se fait sous des travestissements inattendus. Avant même d’être un homo habilis, l’homme est un homo religiosus.
Mythes, religions et besoin de sens
Pendant des dizaines de milliers d’années, les hommes des contrées européennes ont vécu de la sorte dans un monde religieux qu’ils avaient créé. Les bois, les vallons, les rivières, les pierres elles-mêmes, étaient habités par les dieux, les nymphes ou les fées. Tout était rite : travail, pêche, chasse, amour, fêtes, danses, art et jusqu’aux tâches les plus infimes de la vie. De même, la pensée symbolique ouvrait l’esprit au monde et permettait de l’interpréter. C’est ce qu’avait exprimé le philosophe grec Protagoras au Ve siècle avant notre ère, par cet aphorisme : « L’homme est la mesure de toute chose. » Il voulait dire par là qu’il n’y a pas de réalité en soi. Il n’y a de réalité qu’à travers l’interprétation qu’en donnent les hommes. Et les mythes étaient parmi les interprétations les plus fortes qu’ils aient données.
Malgré lui, l’homme laïcisé de l’univers du nihilisme conserve les traces de l’ancien homo religiosus qu’il ne peut cesser d’être. Même quand il nie son passé, il continue d’être habité par lui. Une partie de son existence est nourrie de pulsions qui viennent de cette zone mal connue que l’on appelle l’inconscient et qui commande aussi bien le fonctionnement des viscères que celui de la sexualité, de la sympathie ou de l’antipathie, les attraits et les répulsions. C’est pourquoi l’homme uniquement rationnel, quoi qu’en aient pensé Descartes ou Condorcet, ne se rencontre jamais dans la réalité.
La majorité des « sans-religion » continuent de porter en eux des restes de religiosité. Ils sacrifient inconsciemment à des rites et des symboles qui appartiennent à la structure mentale religieuse. N’en témoignent pas seulement le retour en force de diverses superstitions, mais aussi la multiplication des sectes et des religions de remplacement, fussent-elles politiques ou sportives. Sans le savoir, dans la vie courante, l’homme moderne continue d’ordonner son existence autour de ritualisations dégradées dont le sens est oublié : fêtes et réjouissances saisonnières, rites du mariage, de la naissance ou de la mort, épreuves de passage, rites militaires ou cynégétiques, bizutages, examens, professions de foi maintenues par les familles les plus détachées du christianisme…